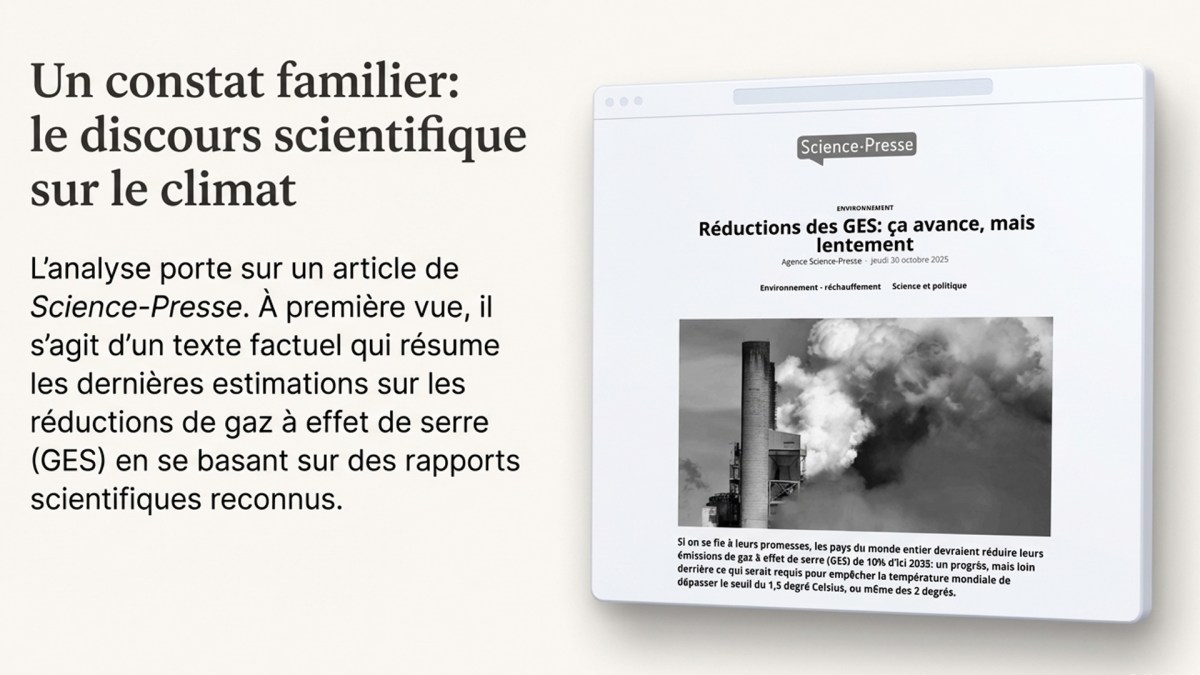Une vidéo d’archives ravive le souvenir de l’inondation spectaculaire qui a englouti Paris en janvier 1910. Des semaines de pluie sans relâche – comme si le ciel avait décidé de laver la capitale de ses péchés – ont fait déborder la Seine avec un enthousiasme que même les plus optimistes n’avaient pas prévu. Résultat : des quartiers entiers noyés sous les eaux, de Grenelle au faubourg Saint-Antoine, où les habitants, contraints de troquer leurs trottoirs pour des radeaux de fortune, ont redécouvert à leurs dépens les joies de la navigation urbaine. Mais au-delà des anecdotes pittoresques – la barque du boulanger, le coiffeur en bottes de pêche – c’est une autre vérité qui émerge lentement, cent quinze ans plus tard, malgré notre technologie rutilante, nos satellites, nos modèles climatiques prédictifs et nos alertes en push, nous ne sommes toujours pas, jamais vraiment, prêts.
C’est là que le bât blesse. En 1910, on pouvait excuser l’impréparation par un manque d’outils : pas de bulletins météo fiables, pas de système d’évacuation centralisé, pas de plan d’urgence digne de ce nom. Mais aujourd’hui ? Nous avons des capteurs dans les égouts, des drones qui survolent les zones à risque, des intelligences artificielles qui nous prédisent l’avenir climatique à dix jours près – et pourtant, une crue soudaine continue de nous prendre de court comme une mauvaise blague. L’eau monte, les réseaux tombent, les plans d’évacuation restent dans les tiroirs. On regarde nos téléphones saturés d’alertes météo tout en se demandant s’il reste encore des bougies dans le tiroir de la cuisine. Comme si l’avenir nous avertissait… mais qu’on préférait ne pas entendre.
Pas pour l’imprévu. Pas pour la crue qui monte pendant la nuit. Pas pour l’eau qui infiltre, submerge, et rappelle à chacun que la nature, elle, n’envoie pas de préavis.
Car c’est bien cela, le cœur du problème : nous vivons dans l’illusion d’un monde parfaitement anticipable, comme si chaque événement devait gentiment s’inscrire dans notre agenda numérique. Mais la nature, elle, n’a pas de compte Google. Elle ne nous laisse pas trois jours pour nous préparer, ni le temps de négocier un délai. Elle arrive, parfois au beau milieu de la nuit, quand tout est calme, quand la ville dort. Et elle infiltre, goutte à goutte, fissure par fissure, jusqu’à faire céder ce que l’on croyait solide. L’eau ne frappe pas à la porte : elle la fait sauter. Et soudain, le salon devient piscine, la cave un puits, et l’idée même de confort moderne… une plaisanterie humide.
Paris 1910, donc, comme un miroir tremblotant de nos faiblesses contemporaines. L’eau grimpe, les réseaux cèdent, l’angoisse s’installe. Le silence qui s’abat sur la ville à mesure que les cloches s’éteignent et que les lampadaires s’éclipsent n’est pas seulement celui d’un monde mis sur pause. C’est le bruit sourd d’une leçon que l’on feint d’apprendre – encore et toujours.
Chaque catastrophe devient un test, et chaque fois, on échoue avec une certaine élégance tragique. Les sirènes retentissent, les habitants évacuent en désordre, les autorités s’agitent devant les caméras, puis s’excusent de ne pas avoir su, pas avoir pu. Et le silence qui suit – ce silence si particulier, presque sacré – n’est pas celui de la paix retrouvée. C’est celui du vide, du regret, de l’incompréhension. C’est une suspension du temps, où tout le monde se regarde sans trop savoir qui accuser : le fleuve ? Le maire ? Le destin ? Et puis, petit à petit, la ville se relève. Mais sans trop se souvenir, surtout. Car le souvenir gêne. Il oblige à changer.
Et pendant que les rats nagent entre les rails inondés, on commence à murmurer le mot crise, à pointer du doigt les autorités, à invoquer la fatalité. Car bien sûr, il est toujours plus rassurant de penser que l’on ne pouvait rien faire. Et surtout, que cela ne se reproduira pas. Jusqu’à la prochaine fois.
La presse, les experts, les voisins s’animent. On cherche l’erreur. On veut des responsables, des visages, des coupables. Mais au fond, tout le monde sait : il n’y a pas un coupable, il y a une habitude, une négligence systémique. Il est plus facile de se dire que c’est « la faute à pas de chance », que « c’est arrivé une fois tous les cent ans ». Jusqu’à ce que ce soit tous les dix ans. Puis tous les deux ans. Mais, chaque fois, on réinvente la surprise, on rejoue l’étonnement, comme des acteurs dans une pièce que l’on connaît trop bien. La crue revient, inlassable, et nous, fidèles à nous-mêmes, lui offrons toujours la même scène, les mêmes dialogues, la même fin. Rideau. Jusqu’à l’acte suivant.
© Photo|Société, 2025