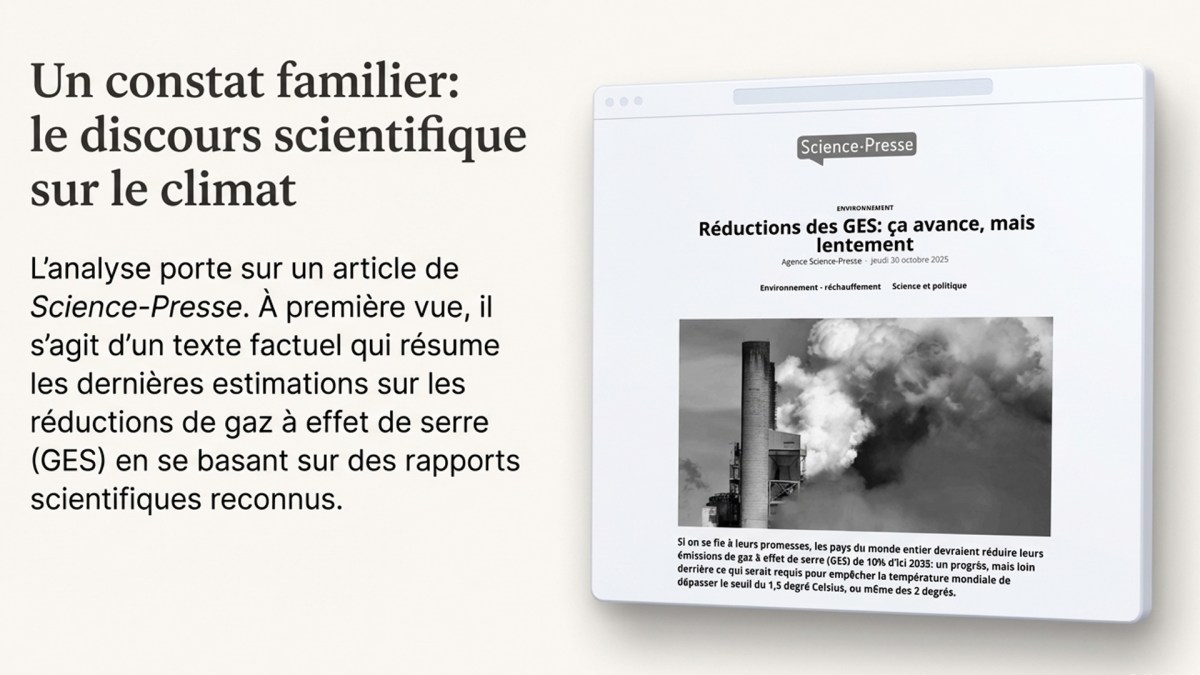Kafka au musée
Prenez l’urinoir de Duchamp. Cet objet, à l’origine simple outil d’évacuation, est désormais promu au rang de totem culturel. Il ne sert plus, il signifie. Et il signifie justement parce qu’il a cessé de servir. Le monde de Kafka était peuplé de portes qui ne s’ouvrent pas, de tribunaux sans cause. Ici, l’on contemple un objet qui fut utilitaire, mais qui ne l’est plus. On ne l’utilise pas, on le regarde. Et le pire, c’est qu’on le regarde avec un respect inquiet, comme si un rire ou une moue sceptique risquait d’en annuler la valeur. Ce n’est pas seulement une inversion des usages, c’est une glorification du déplacement, de la décontextualisation comme valeur suprême, une esthétique du malentendu érigée en norme.

Il y a, dans notre société, une fascination tenace pour le vide érigé en dogme. Non plus un vide contemplatif, propice au silence ou à la rêverie, mais un vide muséifié, institutionnalisé, balisé par des flèches au sol, comme un itinéraire kafkaïen dans un palais où chaque salle serait une impasse. Ce vide n’est pas absence : il est désigné, revendiqué, vendu comme concept. On ne montre plus rien, mais on expose cette absence avec le faste d’un sacre, et on le fait payer cher, comme s’il s’agissait d’acheter un ticket pour contempler l’incompréhensible.
L’absurde est devenu la norme, mais il n’a plus la poésie du surréalisme ni la révolte du dadaïsme. Il est géré, institutionnalisé, mis en scène dans des espaces climatisés où l’on surveille les réactions du public avec la même attention que dans un bureau d’enregistrement des plaintes, où l’on coche les cases de l’indignation. Le moindre regard trop appuyé, trop ironique, peut être perçu comme une offense à la pensée critique. L’absurde, chez Kafka, étouffe l’homme ; ici, il l’invite à l’applaudir.
L’art contemporain, du moins celui qui s’exhibe dans ces temples blancs, ne montre plus le monde : il le désigne comme un symptôme. Tout est devenu prétexte à surinterprétation. Une pierre au sol ? Une métaphore du déclin occidental. Un carton froissé ? L’effondrement des récits. Un objet trouvé dans la rue ? Une critique de la consommation. Et si ce n’était que des objets, justement ? Si l’on avait perdu la capacité à simplement voir sans être pris en otage par un cartel explicatif ? Le monde devient texte, sans fin, à la manière du Procès où tout est codé mais rien n’est lisible.
Le regard moderne est guidé, contraint, soumis à la grammaire muséale. Il suit les flèches, respecte la distance, consomme les idées comme il consommerait des produits bio : avec le sentiment vaguement rassurant de faire partie d’une élite sensible. Mais cette sensibilité est rituelle, convenue, presque administrative. On ne ressent plus, on confirme avoir ressenti. Le sentiment vécu est remplacé par un compte-rendu de sentiment.
Ce que notre époque expulse avec détermination, c’est la sincérité du geste, l’ambiguïté du regard, le doute fertile. Là où l’art devait ébranler, il rassure. Il rassure par son conformisme radical, son audace prévisible, sa subversion apprivoisée. Même l’absurde, jadis insupportable, est devenu objet d’exposition, balisé, analysé, digéré. On l’a domestiqué. On a placé une vitrine entre lui et nous, comme un insecte rare à étudier sans jamais le toucher.
Nous vivons dans une esthétique de la procédure. Ce n’est plus l’objet qui compte, mais le fait qu’il ait été déposé ici, dans ce lieu sanctifié, par une main autoproclamée artiste. Et ce geste est suffisante justification. La démarche a remplacé l’œuvre. Le discours s’est substitué à l’expérience. Comme dans les arcanes kafkaïens, l’action réelle importe peu : ce qui compte, c’est le dossier qu’on ouvre à son sujet.
Ce que ce culte du vide révèle, c’est peut-être une fatigue collective. Fatigue de comprendre, de se confronter à la matière, au travail, à la lenteur. On préfère la fulgurance de l’idée, la légèreté du concept, l’effet de réflexion plutôt que le réflexe d’émotion. Le musée, dans ce contexte, devient un miroir où l’on ne cherche plus à voir autre chose que soi-même validé. L’accès est autorisé, le sens verrouillé.
Kafka, s’il nous regardait aujourd’hui, ne reconnaîtrait plus la topographie de l’absurde. Ce n’est plus le bureau, le tribunal, la bureaucratie tentaculaire. C’est le temple blanc, le socle vide, la parole trop pleine. C’est le monde où l’on expose des urinoirs pour mieux masquer l’impossibilité de créer encore un récit qui tienne debout. Le cauchemar administratif de Kafka a été remplacé par une liturgie esthétique à entrées multiples, mais sans sortie.
Et peut-être, justement, qu’il n’y a rien à raconter. Que le silence, désormais, est l’ultime provocation. Mais même ce silence-là, on l’encadrera. On le nommera. On l’expliquera. Jusqu’à ce qu’il se dissipe, avalé par la mécanique bien huilée de la parole creuse, comme un accusé qui n’a jamais su ce qu’on lui reprochait.
© Photo|Société, 2025