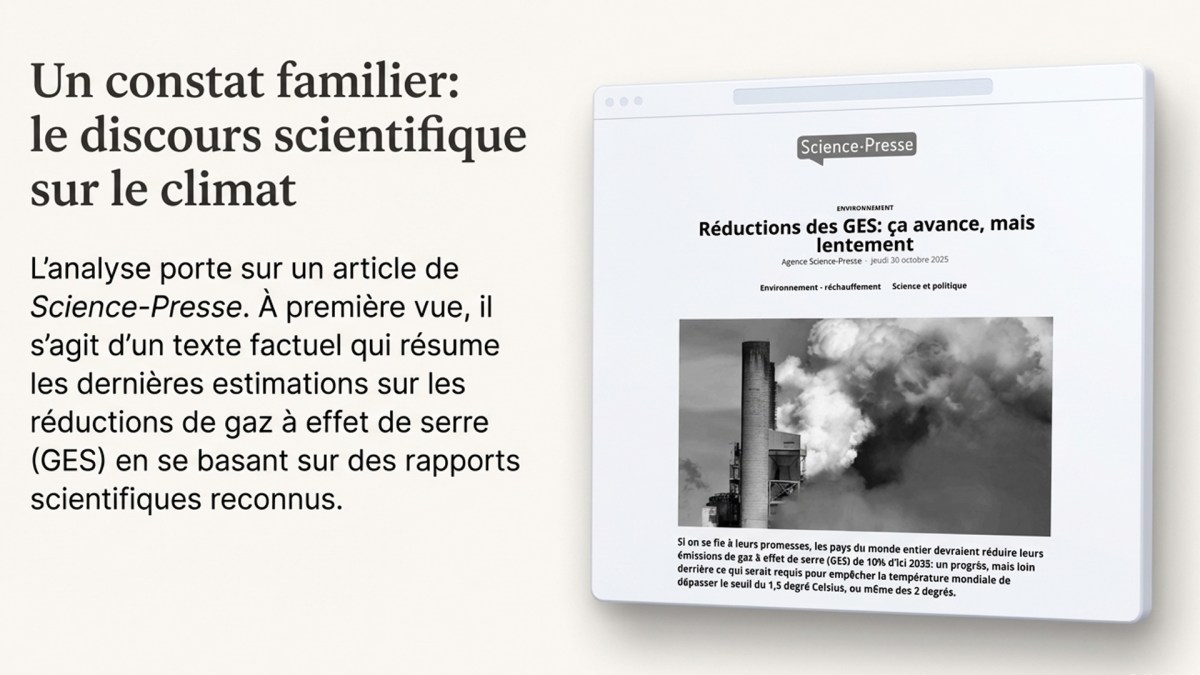Le roman québécois en rupture des normes
Selon l’historien Pierre Hébert, le roman québécois entre les années 1950 et 1970 opère une véritable rupture avec les normes littéraires établies, délaissant les formes convenues du récit pour s’aventurer dans des territoires plus instables, plus incarnés. Trois éléments clés jalonnent cette transformation : l’irruption de la langue populaire, la déconstruction des codes narratifs, et l’exploration du « je » comme espace d’expérimentation identitaire.
Le premier bouleversement est linguistique : en intégrant le joual – langue populaire, vivante, rugueuse – au cœur même de la narration, certains auteurs brisent le pacte classique qui séparait la langue noble de la fiction littéraire et la langue parlée du quotidien. Ce n’est plus seulement un personnage qui parle en joual : c’est le narrateur lui-même qui adopte cette voix, installant une proximité nouvelle, directe, presque brutale avec le lecteur. Ce choix n’est pas anodin : il fait éclater les hiérarchies culturelles et impose une légitimité littéraire à une langue jusque-là marginalisée.

À cette révolution langagière s’ajoute ce que Hébert appelle la « dénudation du procédé » : une interférence consciente entre les niveaux de narration, où l’auteur ne cherche plus à dissimuler les rouages de son récit mais, au contraire, les expose, les commente, les interroge. Le roman ne cache plus sa fabrique, il en fait un objet de réflexion, une surface trouée, instable, où le récit se montre en train de se faire – et parfois de se défaire.
Trois romans emblématiques incarnent cette dynamique : Le libraire de Gérard Bessette, Prochain épisode d’Hubert Aquin, et L’amélanchier de Jacques Ferron. Tous trois sont des récits marqués par l’autobiographie, mais chacun construit son « je » narratif de manière singulière. Chez Bessette, le « je » est ironique, désabusé, un simple agent d’observation d’un monde sclérosé. Chez Aquin, il devient voix hallucinée, éclatée, prise dans une spirale réflexive et politique. Chez Ferron, enfin, le « je » se double d’un imaginaire foisonnant, entre rêve et délire poétique, dans un récit où la frontière entre réel et fiction s’efface.
C’est que l’exploration du « je » devient elle aussi une forme de rupture. Dans les romans des années 1950, le « je » se limitait souvent à une instance narratrice, stable, organisatrice du récit. Dans les années 1960, ce « je » se démultiplie, se retourne sur lui-même, devient locuteur réflexif, sujet en crise, parfois même en conflit avec sa propre parole. Le narrateur n’est plus garant du sens : il en est le lieu d’éclatement.
En somme, la modernité du roman québécois, telle que la lit Pierre Hébert, repose sur cette série de déplacements majeurs : la langue se fait voix populaire, la narration se fait processus exposé, et le sujet narrateur se fait champ d’instabilité. Le roman devient ainsi un laboratoire d’écriture, un espace de réinvention identitaire et linguistique, à l’image d’une société elle-même en mutation.
© Photo|Société, 2025