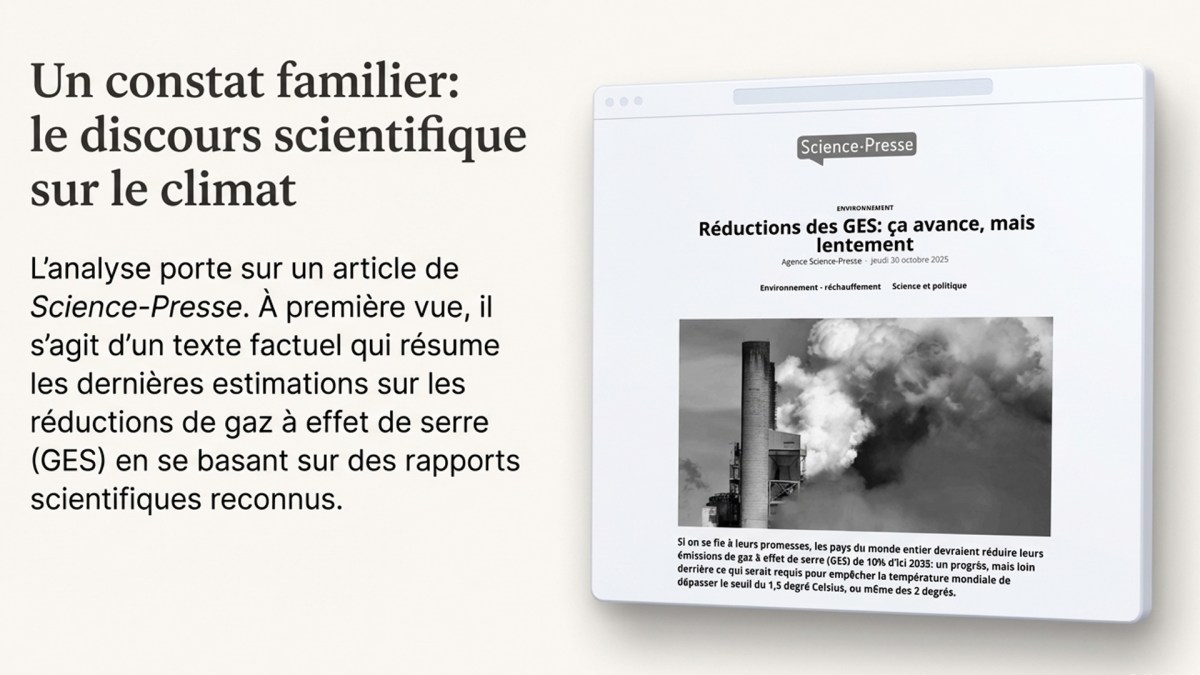Introduction à la sociologie visuelle
Citer cet article
Vignaux, G., Fraser, P. (2018). « Une sociologie qui se veut visuelle ». Revue Sociologie Visuelle, n° 1, seconde édition. Éds. Georges Vignaux et Pierre Fraser. pp. 64-68.

Depuis sa naissance au XIXe siècle, la sociologie s’est surtout exprimée par le biais du texte. Durkheim écrivait avec la précision d’un juriste, Weber construisait ses réflexions comme un érudit des lettres, et Marx forgeait sa pensée dans la tension du discours dialectique. Tous avaient en commun une confiance inébranlable dans la capacité de l’écriture à dévoiler les structures du monde social. Mots, chiffres, graphiques : voilà les outils traditionnels de la discipline. Mais cette focalisation textuelle, aussi rigoureuse soit-elle, a souvent laissé de côté une part essentielle du réel : ce que l’on voit, ce qui s’impose à nos sens, ce qui fait image. C’est dans cet espace laissé en friche — celui du sensible, du perceptible, du symbolique — qu’est venue s’inscrire une autre manière de faire de la sociologie.
Nous vivons désormais dans un monde saturé d’images. À chaque instant, des millions de photos et de vidéos circulent : sur les réseaux sociaux, dans nos téléphones, dans l’espace public. Caméras de surveillance, écrans omniprésents, flux visuels incessants : tout concourt à redéfinir notre manière de percevoir le réel. L’image n’est plus un simple complément, elle est devenue une forme d’existence du social. Susan Sontag l’avait déjà pressenti : « photographier, c’est conférer de l’importance » (On Photography, 1977). Aujourd’hui, prendre une photo, partager un instant, archiver une scène, sont devenus des gestes ordinaires — et pourtant lourds de sens, car cette banalisation modifie en profondeur notre rapport au monde, elle transforme notre mémoire, notre manière de comprendre, d’interpréter, de croire. Dans ce grand basculement du visible, la sociologie ne peut rester aveugle.
La sociologie visuelle s’inscrit donc dans ce renversement du regard. Elle n’est pas un simple ajout ou une spécialisation, mais bien une reconfiguration des manières de penser et d’enquêter et appelle à une ouverture à d’autres langages : ceux de l’image fixe ou de la vidéo, de la carte sensible, du dessin, du modèle 3D, etc. Autant de formes qui permettent de rendre compte autrement — et parfois plus finement — de la complexité du monde social. Howard Becker, l’un des pionniers du domaine, ne disait pas autre chose : « La photographie est une manière de poser des questions sociologiques, pas seulement d’y répondre » (Visual Sociology, 1974). L’image, dans cette perspective, devient outil, vecteur, interrogation.
Toutefois, il ne suffit pas de placer des images au cœur d’une recherche pour en faire une démarche visuelle. Encore faut-il penser leur usage, leur rôle, leur poids. Sont-elles là pour prouver ? Pour raconter ? Pour révéler ? Pour construire ? La sociologie visuelle, en ce sens, exige une réflexivité constante : elle pousse à questionner ce qui est montré, les cadres qui le rendent visible, les gestes de monstration, les évidences trompeuses du regard et rejoint en cela les analyses de John Berger, qui écrivait dans Ways of Seeing (1972) que toute image est déjà une lecture, une construction, un acte de pouvoir. Regarder, c’est déjà interpréter.
En fait, bien avant l’émergence institutionnelle de la sociologie visuelle, certains photographes ont amorcé, sans le savoir, une forme d’enquête sensible sur les conditions de vie et les structures sociales. C’est le cas de Peter Henry Emerson, photographe anglo-américain du XIXe siècle, dont les travaux sur la vie rurale dans les Fens d’Angleterre peuvent être lus aujourd’hui comme une préfiguration de la démarche ethnographique. Convaincu que la photographie devait refléter la réalité telle qu’elle était perçue par l’œil humain, Emerson rejetait les artifices du pictorialisme au profit d’un réalisme poétique. Dans Life and Landscape on the Norfolk Broads (1886), il cherche à capturer la quotidienneté des communautés rurales, leurs gestes, leurs habitats, leur rapport à l’environnement. Ce souci du réel, cette attention portée aux formes de vie ordinaires, annoncent à bien des égards les préoccupations de la sociologie visuelle contemporaine. En ce sens, Emerson incarne l’un de ces « ancêtres oubliés » du regard sociologique par l’image.
Autrement, on trouve les premières traces de cette approche dès les années 1930, dans les travaux issus de l’École de Chicago. Des sociologues comme Paul Cressey ou les frères Lind utilisaient déjà la photographie pour documenter les transformations urbaines ou les conditions de vie ouvrière. Des images discrètes, mais révélatrices, venues enrichir les enquêtes de terrain. Ce n’est que dans les années 1970-1980 que la sociologie visuelle prendra réellement son essor, avec la naissance de revues spécialisées comme Visual Studies et l’influence grandissante de chercheurs comme Douglas Harper. Celui-ci définira la sociologie visuelle comme une pratique à part entière, mobilisant les images non seulement pour illustrer, mais pour penser, analyser, construire des savoirs (Visual Sociology, 1988).
Aujourd’hui, avec l’essor du numérique, cette approche s’est considérablement élargie. Montage vidéo, baladodiffusion, visualisation interactive, captation ethnographique collaborative : autant de formes qui changent la manière de faire de la recherche et de diffuser les résultats. Il est désormais possible qu’un court documentaire sociologique, bien conçu et diffusé en ligne, touche plus de publics et suscite plus de débats qu’un article scientifique. Ce bouleversement pousse les chercheuses et chercheurs à repenser leur rapport à la forme, à l’esthétique, à la transmission. Dans ce contexte, l’image n’est plus un simple support : elle devient un élément actif de la démonstration, une part intégrante du raisonnement sociologique.
De là, la méthodologie de la sociologie visuelle repose sur trois axes forts. D’abord, une attention aiguë à ce qui est donné à voir : les gestes, les espaces, les objets, les atmosphères. Ensuite, une analyse des contextes de production de ces images : qui les a créées, pourquoi, comment. Enfin, une interprétation critique de ce qu’elles suggèrent, de ce qu’elles occultent, de ce qu’elles construisent. Voir, situer, interpréter : ces trois étapes permettent de faire de l’image bien plus qu’un document illustratif, voire un véritable levier de connaissance. Comme le souligne Sarah Pink : « The visual is not simply a supplement to verbal data. It is a mode of knowing in its own right » (Doing Visual Ethnography, 2013).
Mais, s’emparer de l’image, c’est aussi prendre position. Photographier, filmer, exposer : autant de gestes jamais neutres. Qui tient la caméra ? Qui est montré ? Qui autorise ? Qui choisit le cadrage ? Ces questions ne sont pas secondaires, elles touchent au cœur de l’enquête. Elles imposent au chercheur ou à la chercheuse une vigilance éthique constante. Pierre Bourdieu le rappelait déjà dans Un art moyen – Essai sur les usages sociaux de la photographie (1965) : la photographie, loin d’être un art innocent, est traversée par des logiques sociales et culturelles. Toute image est un acte de sélection, de hiérarchisation, de pouvoir. C’est pourquoi la sociologie visuelle ne montre pas simplement : elle interroge, elle révèle, elle déconstruit.
Et cette dynamique déborde largement le cadre universitaire. La sociologie visuelle dialogue avec le cinéma documentaire, les arts visuels, la cartographie, l’anthropologie, les humanités numériques. Elle est à la croisée des langages et des disciplines. Son ambition ? Non pas seulement représenter le monde social, mais en déplier les agencements symboliques, les régimes perceptifs, les formes esthétiques. Elle renouvelle les manières de voir, de comprendre, de raconter. Elle réactive une promesse fondatrice de la sociologie : rendre visible ce qui, d’ordinaire, reste dans l’ombre.
Au fond, la question n’est plus celle de sa légitimité. Dans un monde envahi d’images, la sociologie ne peut rester sourde à ce langage devenu central. Les images sont des traces du présent, des fragments d’archive en formation. Elles exigent qu’on les interroge, qu’on en perce la grammaire, qu’on les restitue dans leur force expressive. Elles permettent, si l’on sait les lire, de mieux comprendre les mutations sociales en cours. Bruno Latour le disait avec clarté : « il faut redonner un corps au social » (Reassembling the Social, 2005). Et peut-être que ce corps, aujourd’hui, passe par les images.