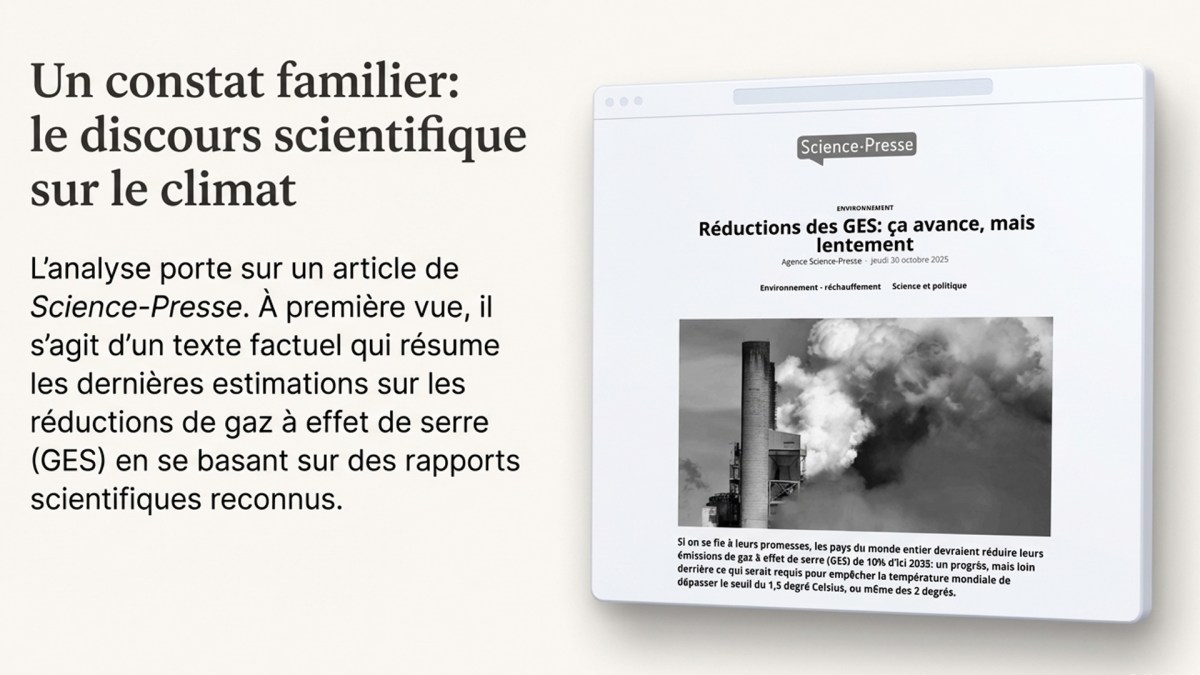Depuis quelques années, le Québec est le théâtre d’une forme nouvelle de censure, moins verticale qu’autrefois, mais plus insidieuse et virulente, car issue de groupes militants organisés. Pierre Hébert, spécialiste reconnu de la censure littéraire, s’est penché sur cette mutation en analysant un cas emblématique : celui de l’auteur Yvan Godbout. Accusé à tort de production de pornographie juvénile pour un passage fictif dans un roman d’horreur, Godbout a été au cœur d’une chasse aux sorcières moderne qui en dit long sur l’état de la liberté d’expression au Québec.
Histoire de la censure littéraire au Québec
Hébert insiste sur la distinction entre les censures historiques — institutionnelles, religieuses, ou étatiques — et cette nouvelle censure « militante », décentralisée, souvent propulsée par les réseaux sociaux. Il ne s’agit plus de comités de lecture ou de lois officielles, mais d’individus ou de groupes qui se mobilisent en ligne pour réclamer le retrait d’une œuvre, la démission d’un auteur ou l’annulation d’un événement. Cette pression publique, bien qu’extérieure à l’État, exerce une forme de coercition tout aussi réelle.
Ce nouveau régime de censure s’inscrit dans le contexte plus large de la montée de l’idéologie néoprogressiste, qui défend des principes de justice sociale et de sensibilité aux discriminations, mais qui, poussée à l’extrême, engendre une intolérance paradoxale. Ainsi, certains militants en viennent à censurer des fictions au nom de normes morales ou politiques contemporaines, confondant l’auteur et ses personnages, la fiction et le réel, la représentation et la promotion.
Le cas d’Yvan Godbout illustre avec force cette confusion. En présentant un personnage de bourreau dans une scène choquante — comme le fait toute littérature d’horreur —, l’auteur s’est vu accuser d’être lui-même coupable de ce qu’il décrivait. Une telle lecture moraliste de la fiction menace l’autonomie même de la création artistique. Hébert rappelle que c’est justement dans la capacité à représenter l’inhumain que la littérature accomplit son rôle critique. Dans la foulée, bien qu’innocenté par la cour, l’auteur mettra fin à sa carrière.
Victoire pour l’auteur d’une œuvre jugée pédopornographique par les forces de l’ordre
Un autre danger réside dans ce que Hébert appelle le « présentisme » : cette tendance à juger les œuvres du passé à l’aune des sensibilités d’aujourd’hui. Ce biais temporel conduit à l’effacement progressif de tout un pan du patrimoine culturel, déclaré offensant, raciste, sexiste ou inadéquat. Or, la fonction de l’histoire, et de la littérature historique, est précisément de refléter d’autres systèmes de valeurs, d’autres imaginaires, d’autres codes.
La censure militante transforme alors les institutions culturelles en lieux de relecture morale. On déprogramme des spectacles, on retire des livres des écoles, on réécrit des dialogues pour les rendre « acceptables ». Ce ne sont plus des autorités centralisées qui décident, mais une coalition mouvante de voix indignées. Et pourtant, l’effet est le même : une normalisation rampante, une peur grandissante chez les créateurs, un climat de soupçon permanent.
Dans ce climat, l’art devient stratégique : il faut peser chaque mot, anticiper les accusations, se conformer à des normes mouvantes. La littérature perd alors ce qui faisait sa force : sa capacité à heurter, à troubler, à provoquer. Hébert plaide pour le maintien de zones de fiction où tout peut être pensé, imaginé, représenté — même l’abject. Car sans cela, c’est la pensée critique elle-même qui se fige.
L’enjeu ne concerne pas que les écrivains. Il touche à l’ensemble de la sphère publique : universités, musées, bibliothèques, médias. Partout, la tentation de l’autocensure progresse. Par peur d’une controverse, on renonce à programmer une conférence, à inviter un penseur controversé, à publier un texte dérangeant. L’espace public se replie sur lui-même, appauvri par la peur d’offenser.
Hébert appelle donc à une vigilance active. Défendre la liberté de création, ce n’est pas cautionner tous les contenus ; c’est protéger le droit de représenter même l’impensable. Il faut rouvrir des espaces de débat, restaurer la présomption de fiction, distinguer entre représentation et apologie. C’est à ce prix que la culture pourra redevenir un lieu de complexité et de pluralité.
Enfin, cette défense de la littérature doit s’accompagner d’une éducation critique à la lecture. Apprendre à lire, c’est apprendre à interpréter, à faire la part des choses, à contextualiser. Sans cela, l’acte même de lire devient dangereux, suspect, voire criminel. Hébert, en rappelant ces principes simples, mais essentiels, nous invite à reconstruire un espace littéraire où la liberté n’est pas un luxe, mais une condition de pensée.
© Photo|Société, 2025