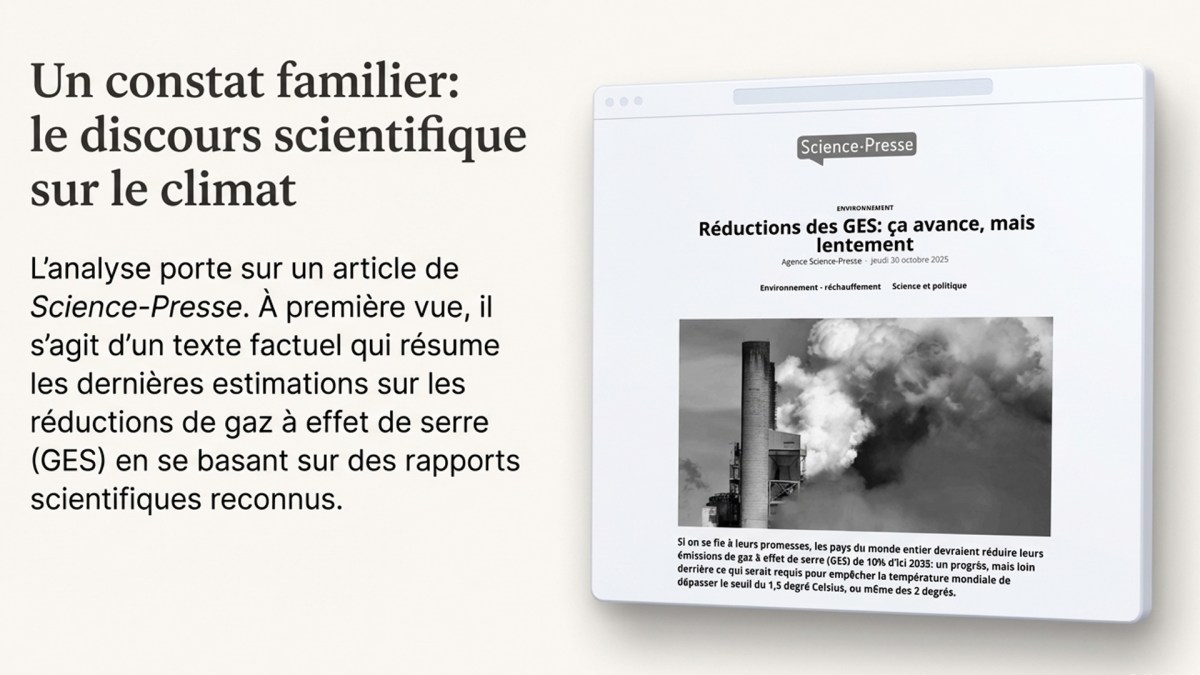Au Québec, la saisie de Nègres blancs d’Amérique en 1968 n’a rien d’un banal épisode judiciaire. Elle incarne un moment de panique morale où les institutions, sentant leur autorité vaciller, s’empressent de brandir la censure comme dernier rempart contre l’insubordination intellectuelle. L’œuvre de Pierre Vallières, à la fois pamphlet politique et cri de rage, avait le malheur de pointer du doigt les fractures coloniales du Québec en des termes bien trop crus pour l’élite bien-pensante. Interdire ce livre, c’était moins vouloir protéger les lecteurs que les empêcher de penser trop fort, ou pire, de faire des parallèles un peu trop éclairants avec d’autres luttes de libération.
Quelques années plus tard, Les Fées ont soif de Denise Boucher déclenche une levée de boucliers d’un tout autre ordre. On aurait pu croire que le théâtre, refuge de la transgression élégante, pouvait accueillir sans sourciller trois figures féminines en quête de parole. Mais non. Le clergé, les tribunaux et certaines institutions culturelles s’unissent pour sonner l’alarme : ce texte ose s’attaquer à la Sainte Trinité du patriarcat — la Vierge, la mère et la putain — avec un humour un peu trop corrosif. La pièce dérange, et donc, elle doit être muselée. On ne badine pas avec les archétypes, surtout quand ils ont été sculptés à coups de dogmes et d’habitudes.
Ce que Pierre Hébert met en lumière, c’est la formidable ironie du sort : ces deux œuvres, autrefois frappées du sceau de l’indésirabilité, trônent aujourd’hui dans le panthéon des classiques québécois. On les étudie, on les cite, on les révère même. Comme si la censure n’avait servi qu’à les canoniser plus vite. À vouloir faire taire les voix discordantes, on leur a offert un mégaphone. Voilà peut-être l’unique vertu de la répression culturelle : celle de précipiter l’entrée dans la postérité de ceux qu’elle croyait étouffer.
Et pourtant, malgré les hommages tardifs, les prix littéraires posthumes et les expositions rétrospectives, la gêne persiste. Car ces œuvres ne sont pas devenues sages avec le temps. Leur rugosité initiale continue de gratter sous la surface du consensus contemporain. Elles rappellent que la liberté d’expression, dans une société qui se veut progressiste, n’est jamais acquise mais sans cesse renégociée — au tribunal, dans les médias ou au détour d’un conseil d’administration.
On aurait tort de croire que ces censures appartiennent à une époque révolue. Elles mutent, se camouflent, prennent la forme de prudences éditoriales, de déprogrammations feutrées, ou de boycotts organisés au nom du « bien commun ». Aujourd’hui encore, toute œuvre qui désaxe les repères rassurants ou bouscule les hiérarchies établies s’expose à une mise à l’écart — parfois plus insidieuse, mais non moins efficace. La différence, c’est que les procès se font désormais sur les réseaux sociaux, et les autodafés, dans les algorithmes.
En définitive, l’histoire de Nègres blancs d’Amérique et de Les Fées ont soif nous tend un miroir embarrassant : celui d’une société qui peine à concilier liberté artistique et confort idéologique. Et si l’on devait en tirer une leçon, ce serait peut-être celle-ci : méfions-nous de ce que nous cherchons à faire taire. Car ce que nous censurons aujourd’hui sera peut-être, demain, la voix même de notre mémoire collective. Ou pire encore, la preuve éclatante de nos renoncements.
© Photo|Société, 2025