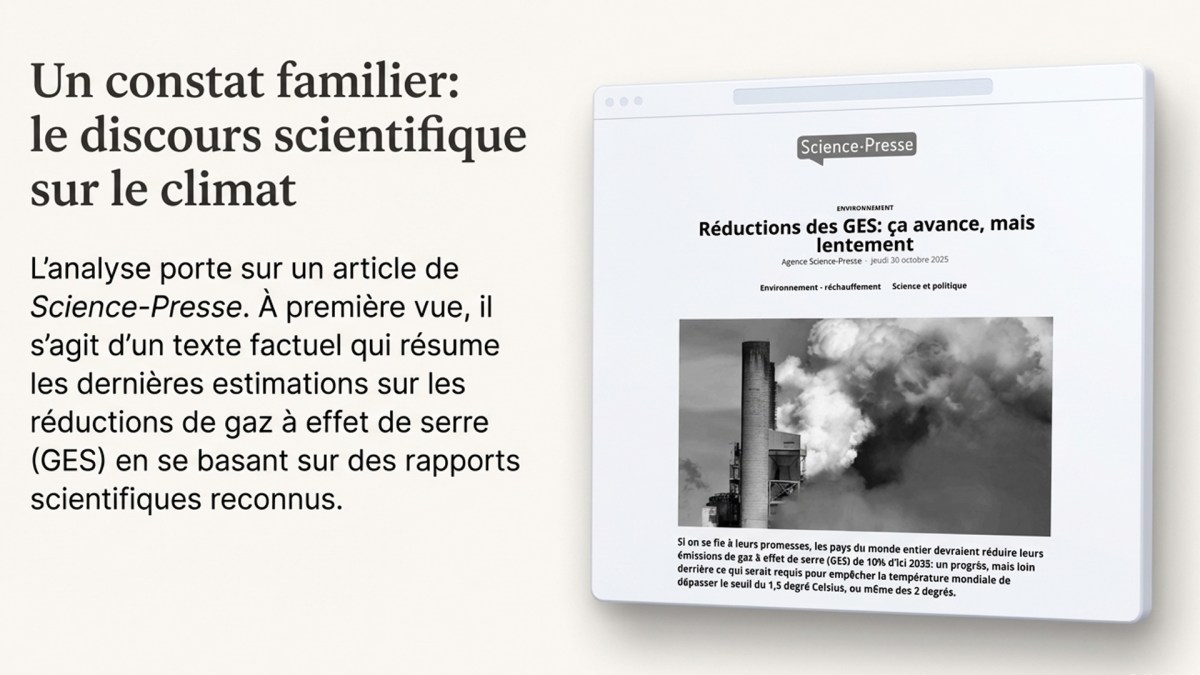Diagnostiquer ou vivre en mode avant-maladie ?
* Réflexion tirée des conclusions de ma thèse de doctorat.

Lord Kelvin, grand prêtre d’une modernité sûre d’elle, voulait compter et compter encore, afin que les choses accèdent au droit d’exister. Les empires ont suivi, dociles et méthodiques. Hectares, tonnes, calories, pulsations. La règle et le cadran ont dressé le monde, parfois pour le mieux. On a sauvé des vies et allongé l’espérance, discipliné les bactéries, corrigé les carences. Pourtant l’abstraction s’est assise à notre table et, tandis qu’elle émiettait le réel en unités commodes, elle oubliait que le jambon ibérique et un verre de vin rouge forment déjà des civilisations entières.
Voici maintenant un vizir nouveau, l’IA prédictive. Elle feuillette nos dossiers comme un palimpseste et murmure des probabilités à long terme : « Dans vingt ans voici ce qui vous guette, peut-être… » À l’horizon apparaît une prophylaxie durable, presque une assurance ontologique qui nous invite à remodeler nos habitudes dès aujourd’hui pour dérouter les maladies en coulisse. Le rêve fascine. On voudrait rattraper l’infarctus avant sa première phrase, distraire le cancer de son intrigue, négocier l’Alzheimer comme on déplace une armée sur une carte. Toujours le même mot d’ordre, mieux vaut prévenir que guérir.
Mais la prévention prélève sa dîme, et c’est le présent qui paye. Chaque risque futur converti en programme d’hygiène lève une taxe sur la joie et sur le relâchement du jour. Le paradoxe kelvinien revient, obstiné. Plus on mesure, plus on confond la carte et le terroir. Le nombre éblouit, il n’embrasse pas. La métrique discipline, elle ne console guère. Le XXe siècle médical l’a démontré dans sa prose sèche, facteurs de risque, preuve par cohortes, bilans généraux dont certains n’améliorent ni la mortalité ni les grands indicateurs. La mesure, utile et massive, n’est jamais innocente, car elle sélectionne ce qui compte parce qu’il se compte.
Le XXIe siècle ajoute une torsion. Nous vivons sous l’œil d’un double probabiliste, mi juge mi ange gardien. L’esprit s’y laisse prendre, car sous la rationalité s’installe une eschatologie froide. Non plus memento mori, plutôt memento metrics, souviens-toi de tes courbes, de tes zones, de ces trajectoires qui te dépassent. Le miroir brunit, il esquisse la silhouette de nos maladies prochaines, et la silhouette réclame ses sacrifices quotidiens. Dix mille pas, sommeil sanctifié, alimentation monacale, stress managé, suivis répétés. Parfois judicieux, parfois surabondants, parfois anxiogènes.
L’impensé déborde le clinique. Il est politique, il est économique. Une santé prédictible attire les assureurs qui raffinent la tarification, les employeurs qui gèrent les risques humains, les États qui pilotent les budgets, les plateformes qui monétisent la vigilance. Qui possède les modèles impose bientôt les normes de vie bonne : seuils, alertes, tableaux de bord. Le risque devient monnaie, la prévention protocole, l’écart soupçon et on dira que c’est pour notre bien, et l’on n’aura pas tout à fait tort, puisque les impérialismes parlent toujours le dialecte du salut.
Reste la fragilité native de toute prophétie statistique. Même algorithmes et mêmes bases, pourtant des individus singuliers. Même prédicteurs, pourtant des vies dissonantes. La prédiction fabrique des faux positifs, des cascades d’examens, des micro-lésions de confiance. La vigilance totale a un coût cognitif, lourd et têtu, car apprendre à vivre dans l’avant-maladie peut nous voler l’après-midi. On ne goûte plus le présent, on l’assure. On n’habite plus son corps, on l’administre. À force d’optimiser, on stérilise.
Faut-il pour autant jeter l’IA avec l’eau du bain de jouvence, non, il faut la situer comme on recadre une carte dans le paysage. Trois principes, modestes et têtus.
Premier principe : proportion et seuils. Tout signal n’appelle pas action, et toute courbe n’écrit pas un destin. La bonne clinique de soi commence par la vraisemblance et par la gravité, distinguer l’utile du futile, le probable du possible. L’IA excelle à dégager des motifs, et c’est à nous de conserver l’art du tri. Un droit à l’ignorance mesurée mérite place, ne pas tout savoir tout de suite lorsque l’action reste floue ou corrosive.
Deuxième principe : réversibilité et consentement. Les parcours préventifs doivent rester modulaires, avec des paliers, des sorties de secours, des retours sans blâme. Le consentement éclairé n’est pas un pop-up juridique, c’est une pédagogie durable. Dire ce que la machine prédit, ce qu’elle rate, ce que cela coûte en argent, en temps, en anxiété, et ce que l’on gagne vraiment.
Troisième principe : humanités de la santé. Mesurer n’est pas soigner, et prédire n’est pas accompagner. Il faut réinsérer la clinique dans des récits de vie, des projets, des saveurs. Viser une longévité de qualité qui laisse un interstice au plaisir, au symbolique, au repas partagé. Sinon la prévention devient un rite sans mythe, efficace et triste.
Le fil diachronique parle clair : au XIXe siècle, Quetelet et Kelvin installent l’orgueil métrologique, un monde mesuré donc intelligible ; au XXe siècle, triomphe des cohortes et invention des facteurs de risque, la santé publique gagne de vraies batailles ; au XXIe siècle, le vivant devient flux continu, la clinique un courant à interpréter, le médecin un herméneute entouré d’oracles. À chaque époque sa tentation hégémonique. Après la quantité vient la prédiction. Notre tâche n’est pas de refuser l’époque, elle est de lui poser des limites respirables.
Et si l’algorithme frôlait demain la perfection, la question se renverse. Plus la prophétie est juste, plus il faut des garde-fous, car la norme s’enhardit. Ne pas oublier qu’une machine qui prédit bien peut prescrire trop. On gagnera ici à se souvenir de la via negativa, c’est-à-dire améliorer par soustraction plutôt que par ajout. Ôter d’abord ce qui fragilise, par exemple la polymédication inutile, puisque les dommages certains du nuisible sont mieux établis que les bénéfices incertains des nouveautés, ce qui réduit l’exposition aux inconnues et aux effets secondaires et augmente la robustesse. Ce n’est pas un culte du retrait, c’est un ordre d’opération.
En clair, nous ne vivons pas dans des intervalles de confiance, nous vivons des après-midis avec des gens. Le corps n’est pas une somme de risques, il est un instrument de présence. Tenir les catastrophes à distance reste raisonnable, transformer la vie en salle d’attente ne l’est pas. Mesurer, oui. Mieux comprendre, oui. Gouverner, avec parcimonie, oui. Et savoir lâcher prise, parfois, en offrant au réel l’hospitalité d’un repas trop long bien arrosé, d’une marche sans but, d’une conversation qui sourit à nos certitudes.
Revenons finalement à Lord Kelvin. Il affirmait que l’on sait de quoi l’on parle quand on peut le mesurer. Ajoutons ceci, sans pathos inutile : on sait vraiment de quoi l’on parle quand, après avoir mesuré, on accepte qu’il reste une part à aimer, une part qui échappe au chiffre sans s’opposer à la raison. Alors l’IA trouvera sa place, conseillère parmi d’autres, non souveraine, utile servante, jamais régente.
© Pierre Fraser (PhD), sociologue et linguiste, 2025
Lectures supplémentaires pour mieux comprendre le sujet
- Shmatko, A., Jung, A. W., et al. (2025). Learning the natural history of human disease with generative transformers. Nature. (Nature)
- Krogsbøll, L. T., Jørgensen, K. J., & Gøtzsche, P. C. (2019). General health checks in adults for reducing morbidity and mortality from disease. Cochrane Database of Systematic Reviews, CD009009. (PubMed)
- Welch, H. G., Schwartz, L. M., & Woloshin, S. (2011). Overdiagnosed: Making People Sick in the Pursuit of Health. Beacon Press. (Porchlight Book Company)
- Muller, J. Z. (2018). The Tyranny of Metrics. Princeton University Press. (jstor.org)
- Topol, E. J. (2019). Deep Medicine: How Artificial Intelligence Can Make Healthcare Human Again. Basic Books. (psnet.ahrq.gov)