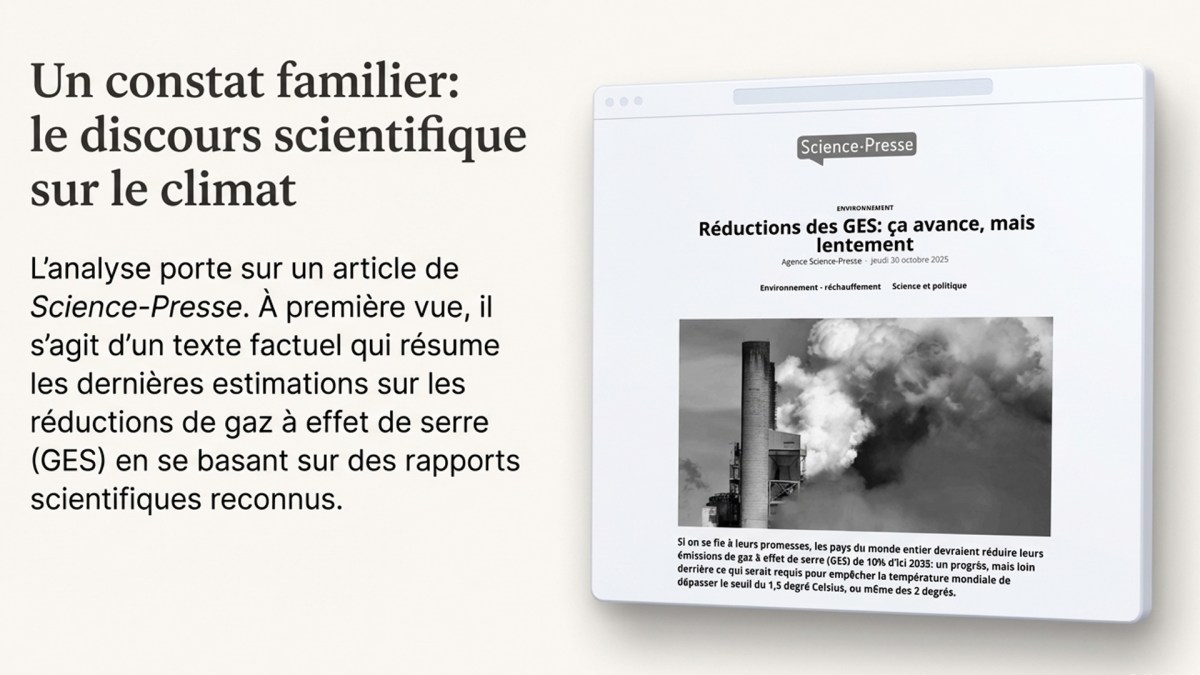L’ARRIVÉE DE LA GASTRONOMIE AU XVIIe SIÈCLE
Citer cet article
Fraser, P. (2015), « L’arrivée de la gastronomie au XVIIe siècle ». Une brève histoire du corps – Du corps rejeté au corps augmenté. Éditions V/F, pp. 33-36.
Le médecin londonien Martin Lister (1638-1712), après avoir visité Paris, écrira : « Ce dont je suis sûr, c’est que l’air et la constitution des Parisiens, hommes et femmes, sont étrangement modifiés. De minces et maigres, ils sont devenus gras et corpulents, les femmes surtout, et on ne doit, à mon avis, l’attribuer à rien d’autre qu’à l’usage des liqueurs fortes. Ajoutez à ces boissons l’emploi journalier de café, du thé, du chocolat, qui sont aussi répandus dans les maisons particulières de Paris qu’à Londres : toutes ces liqueurs sucrées engraissent beaucoup[1]. » Dans cette observation faite par Lister, il est possible de dégager deux constats : l’apparence du corps de la femme est particulièrement visée, parce qu’elle s’adonnerait à une pratique alimentaire douteuse et un lien est clairement établi entre le sucre et la prise de poids[2]. Deux événements contribueront donc à accentuer les interventions pour réguler le corps obèse au XVIIe siècle : l’arrivée massive du sucre et l’idée même d’éducation que se propose d’une manière générale le XVIIe siècle.

Même s’il ne faut pas diminuer l’importance du coton, du cacao et de plusieurs autres produits alimentaires dans la balance de l’échange commercial de l’époque, il n’en reste pas moins que les grandes affaires du XVIIe siècle sont d’abord et avant tout le sucre et le café[3]. En fait, l’arrivée massive en Europe du sucre brésilien et du sucre antillais fait systématiquement chuter les prix, instaurant dès lors une nouvelle dynamique alimentaire. En Grande-Bretagne, les classes populaires anglaises commencent à consommer de plus en plus de sucre brun et de mélasse. De 1660 à 1700, la consommation de sucre quadruple, triple entre 1700 et 1740, gagne le reste de l’Europe et augmente même plus vite que celle du pain[4]. Les deux plus grands importateurs, la France et la Grande-Bretagne, redistribuent le sucre antillais jusqu’au Moyen-Orient. Son entrée inédite dans les régimes alimentaires bouleversera les pratiques de commensalité et introduira des aliments inédits jusqu’alors tels les mousses, gâteaux, confitures, compotes, gelées, marmelades. Il se retrouvera également dans les plats de céréales, ainsi que dans les préparations à base d’œufs et de laitage et fera même également son chemin jusque dans le café.
Tout comme au XVIe siècle, la cuisine du XVIIe siècle se décline en trois temps : une pour l’aristocratie, très abondante et très diversifiée ; une pour la bourgeoisie, qui se rapproche de plus en plus de celle de l’aristocratie, de plus en plus abondante et de plus en plus diversifiée ; une pour le peuple, quasi semblable à celle du siècle précédent, c’est-à-dire, peu abondante et peu diversifiée. Le XVIIe siècle voit l’introduction de la gastronomie dans les grandes cours d’Europe. À l’image du roi Soleil, Louis XIV, la cuisine est somptueuse, raffinée, diversifiée. Elle se structure, définit des manières d’être et des attitudes, impose des règles de conduite et de maintien. Elle est à l’origine du déclin graduel des épices au profit des fines herbes aromatiques et de l’arrivée des ragoûts et des sauces, de l’apparition des jus et des confits, et de l’essor des légumes et de la diététique. Les cuisiniers édulcorent de moins en moins les viandes et les poissons, réservent désormais le sucre pour les desserts. Les sauces maigres sont supplantées, soit par des sauces émulsionnées, soit par des sauces grasses et onctueuses.
Mais ce qui marque le plus cette nouvelle cuisine, c’est sans doute le recours systématique aux légumes, y compris les légumes racine jusque-là méprisés par l’aristocratie, d’où l’essor des grandes cultures maraîchères. La cause première de tous ces changements en matière d’alimentation relèverait d’une simple question de statut social : l’aristocratie cherche avant tout à se démarquer concrètement des modes de consommation populaires et bourgeois : « Condamner les pratiques traditionnelles, c’est prendre à contre-pied les parvenus au moment où ils croient s’égaler par leur faste aux gentilshommes de vieille souche qu’ils essayent d’imiter[5]. » Paradoxalement, c’est aussi la raison pour laquelle « les élites aristocratiques se tournent de plus en plus souvent vers les grosses viandes de boucherie, sous l’influence de la cuisine bourgeoise traditionnelle, parce que les bourgeois eux-mêmes se sont mis à imiter la cuisine aristocratique et que le seul moyen qu’elles ont de se singulariser est d’adopter les procédés qu’ils ont abandonnés partiellement[6]. »
Avec le XVIIe siècle, au « manger beaucoup » succède le « bien manger » qui se confond aussi avec la modération. Il y a ici une idée qui aura un écho jusque dans les pratiques alimentaires du XXIe siècle sous la gouverne des nutritionnistes, car au fur et à mesure que « la viande devient accessible au grand nombre, de même que les épices, les classes distinguées les délaissent pour le « manger peu », les végétaux, le primat du goût. La différenciation sociale qui reposait d’abord sur une différence de quantité évolue vers une différence concernant les produits eux-mêmes[7]. » Et cette volonté de se démarquer englobe autant les façons d’accommoder les aliments que celle de les consommer, y compris les heures de repas pour se différencier de la bourgeoisie : « Il en résulte un changement dans la frontière sociale, qui passe dès lors entre les élites nobles et bourgeoises mangeuses de bons morceaux de toutes origines, gibier ou élevage, et le peuple auquel sont laissés les bas morceaux, […] tandis que seul le jambon reste consommé par les élites : la viande de porc est devenue, définitivement, un produit destiné au seul peuple[8]. »
Avec des moyens financiers de plus en plus accrus, la bourgeoisie se met à imiter la cuisine de l’élite. Comme le met si bien en scène Molière dans le Bourgeois gentilhomme (1670), monsieur Jourdain témoigne en effet de l’affirmation de la bourgeoisie de s’approprier les manières, les attitudes et les comportements de l’aristocratie. En 1691, pour répondre à ces nouvelles attentes, le grand chef François Massaliot (1660-1733) publie son célèbre ouvrage intitulé Cuisinier royal et bourgeois et rencontre un vif succès auprès de la bourgeoisie montante qui s’empare alors de la grande cuisine autrefois réservée à l’aristocratie, et qui, dans le même souffle, adopte de nouvelles manières de table : le couteau à usage individuel à bout rond, la fourchette, la cuillère, la serviette. La bourgeoisie n’est plus, comme au siècle précédent, confrontée à une certaine frugalité. Son ordinaire s’est modifié et la viande est de plus en plus en présente sur la table, tout comme la volaille, le beurre et le vin. À l’inverse, l’alimentation du peuple est toujours confinée à une alimentation céréalière et de pain composée de blé, de seigle et de froment (pain bis). Il y a également cette eau bouillie composée d’herbes et de racines, de carottes, de navets, de poireaux, d’épinards, de panais, d’oignons, de choux et de légumineuses qui compose l’ordinaire du quotidien. La viande est plus souvent qu’absente des repas, sauf les jours de fête.
Il faut peut-être envisager que, dans le contexte d’une cuisine du XVIIe siècle si nettement définie, la prise de poids est avant tout affaire de classe sociale. Conséquemment, ce sont le noble, l’aristocrate et le bourgeois qui deviennent la cible des médecins. L’idée est structurante, car les régimes sont plus souvent évoqués, cités, présents dans les lettres, les rituels, les récits « avec leurs recours très simples aux moindres quantités nutritives ou aux matières desséchantes, toutes censées limiter une grosseur dont le principe premier demeure l’humidité.[9] »
Les recommandations des médecins, encore en phase avec la théorie des humeurs héritée du Moyen-Âge, tenteront de traiter la diversité des tempéraments comme des maladies. Alors que la diététique du Moyen-Âge et de la Renaissance était plutôt conservative des tempéraments individuels — parce que manger était une opération non modificatrice des humeurs qui assurait une santé continue —, la diététique du XVIIe siècle devient corrective et normative. Et en se référant à l’idée voulant que la santé véritable soit fondée sur un équilibre parfait des humeurs, les médecins suggéreront que chacun doit manger ce qui corrige son humeur dominante pour atteindre cet équilibre :
« Selon ce système, les viandes et boissons, qui sont de qualité humide et chaude, sont propres à ceux qui sont d’humeur mélancolique ; celles qui sont froides et humides aux colériques [ou bilieux] ; les chaudes et sèches aux phlegmatiques ; et celle de bon suc et médiocre nutriment aux sanguins[10]. » Comme le souligne l’historien Georges Vigarello : « l’origine de la graisse demeure bien celle des liquides et les qualités du corps tiennent bien à celle des humeurs. […] L’horizon du liquide et du sec, avec ses équilibres, ses désordres, ses débordements, demeure bien l’horizon du sain et malsain, du digeste et de l’indigeste, du mince et du gros[11].»
Avec le XVIIe siècle, l’aversion envers le corps en excès de graisse prend définitivement source avec le passage du statut d’être un corps à celui d’avoir un corps dont l’individu est personnellement et socialement responsable, c’est-à-dire le corps devenu support des relations sociales et porteur d’identités. Le fait d’être en surpoids ou obèse traduirait par conséquent ce manque de contrôle et de volonté face à cette nouvelle responsabilité d’avoir un corps. Le corps en excès de graisse devient cible de stigmatisation. Les mots et les images sont là pour en témoigner, puisque l’iconographie et la littérature du XVIIe siècle font du très gros un individu paresseux, mou, indolent, fainéant, oisif, profiteur, abuseur. Et c’est bien de cette crainte de l’amollissement que provient la modernité corporelle, celle qui subsumera toutes les interventions à venir sur le corps au cours des siècles qui suivront.
© Pierre Fraser (PhD), sociologue et linguiste
[1] Société des bibliophiles français (1883), Voyage de Lister à Paris, Paris : Lahure, p. 151-152.
[2] Déjà, à cette époque, le coupable était identifié, ce que confirmera plus tard avec succès la science du XXe siècle.
[3] Brulez, W. (1968), « Le commerce international des Pays-Bas au XVIe siècle : Essai d’appréciation quantitative », Revue belge de philologie et d’histoire, tome 46, fasc. 4., p. 1205-1221.
[4] Muchembled, R. (1994), Le XVIIIe siècle, 1715-1815, Paris : Bréal, Annexe commenté.
[5] Garnot, B. (1995), La culture matérielle en France aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, Paris : Ophrys, p. 44.
[6] Idem, p. 45.
[7] Mathé, T., Pilorin T., Hébel, P. (2008), « Du discours nutritionnel aux représentations de l’alimentation », Cahier de recherche, n° 252, dirigé par Pascale Hébel, p. 16.
[8] Garnot, B. (1995), op. cit., p .46
[9] Vigarello, G. (2010), op. cit., p. 103.
[10] Garnot, B. (1995), op. cit. p. 43.
[11] Vigarello, G. (2010), op. cit., p. 113-114.
UNE BRÈVE HISTOIRE DU CORPS
La ville, un gymnase à ciel ouvert
La ville devient un gymnase à ciel ouvert : courir ou s’entraîner dans l’espace public affiche santé et discipline, tout…
Le corps violenté du XVIIe siècle
Au XVIIe siècle, le corps cesse d’être idéalisé : il devient cadavre disséqué, symbole de mortalité, reflet de la pensée…
L’épuration personnelle et collective au XVIIe siècle
Au XVIIe siècle, la purge n’est plus qu’un soin médical : elle devient un modèle de société, servant à justifier…
Le corps malléable du XVIIe siècle
Au XVIIe siècle, le corps est perçu comme malléable : corsets et appareils visent à le redresser selon des normes…
L’Éducation physique au XVIIe siècle
À la fin du XVIIe siècle, l’idéal « un esprit sain dans un corps sain » s’impose : l’éducation et…
La contenance et la gouvernance de soi
Au XVIIe siècle, on passe de « être » à « avoir un corps » : chacun devient responsable de…
Le corps bridé et contenu du XVIIe siècle
Au XVIIe siècle, le corps passe du cosmos à la mécanique : découvertes scientifiques et morale protestante en font un…
Idéal et représentation du corps à la Renaissance
À la Renaissance, l’obésité entre en scène : mesurée par Dürer mais rétive aux canons de Vitruve, elle contraste avec…
La Renaissance et le corps de justes proportions
De la Renaissance au XIXe siècle, le corps idéal glorifié (Da Vinci, Michel-Ange) coexiste avec l’image négative du gros, symbole…