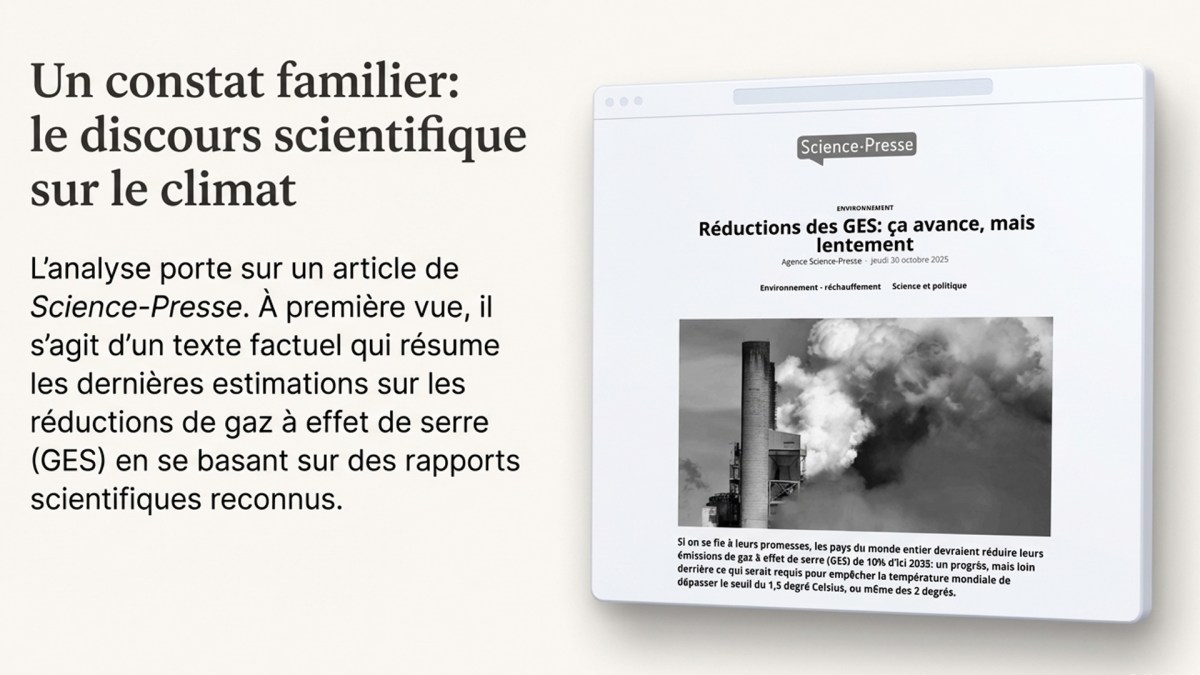LA CENSURE LITTÉRAIRE IMPOSÉE PAR LE CLERGÉ QUÉBÉCOIS
Imaginez le Québec de la fin du XIXe siècle : les clochers dominent l’horizon, et l’Église règne sur les esprits autant que sur les consciences. Dans ce climat, écrire n’est jamais un geste innocent. C’est un pari risqué, parfois même un acte de défi.
Prenons l’exemple de Marie Calumet, ce roman de Rodolphe Girard publié en 1904. Il dépeint avec ironie la vie paroissiale, et cela suffit pour déclencher la colère des autorités religieuses. Le verdict tombe : interdiction pure et simple. Le livre est retiré des librairies, condamné au silence officiel.
Mais la censure n’a pas toujours besoin de frapper avec fracas. Elle sait se montrer sournoise, comme dans le cas du Débutant de Damase Potvin. Là, pas de condamnation publique, pas de scandale… juste un silence glacial. Ignoré par les critiques, tenu à l’écart des circuits de diffusion, le roman disparaît doucement dans l’ombre. Une censure par omission, tout aussi efficace qu’une interdiction.
Et puis, il y a l’autre visage, plus intime encore : l’autocensure. Celle qui fait trembler la main de l’auteur avant même d’écrire. Claude-Henri Grignon, avec La Scouine, en fait l’expérience : comment oser critiquer une société dominée par le clergé sans risquer l’exclusion ou la réprobation publique ? Dans ce contexte, la plume s’alourdit, la voix se brise, et l’imaginaire se réduit à ce qui peut être toléré.
La censure, au Québec, n’a donc pas été qu’une série d’interdits ponctuels. Elle a été un climat, une atmosphère. Une chape de plomb qui pesait sur les écrivains, limitant leur audace, freinant la diffusion des idées, et modelant une littérature contrainte à s’autodiscipliner. Et c’est toute la liberté d’expression qui, pendant des décennies, s’est trouvée prisonnière de cette ombre cléricale.