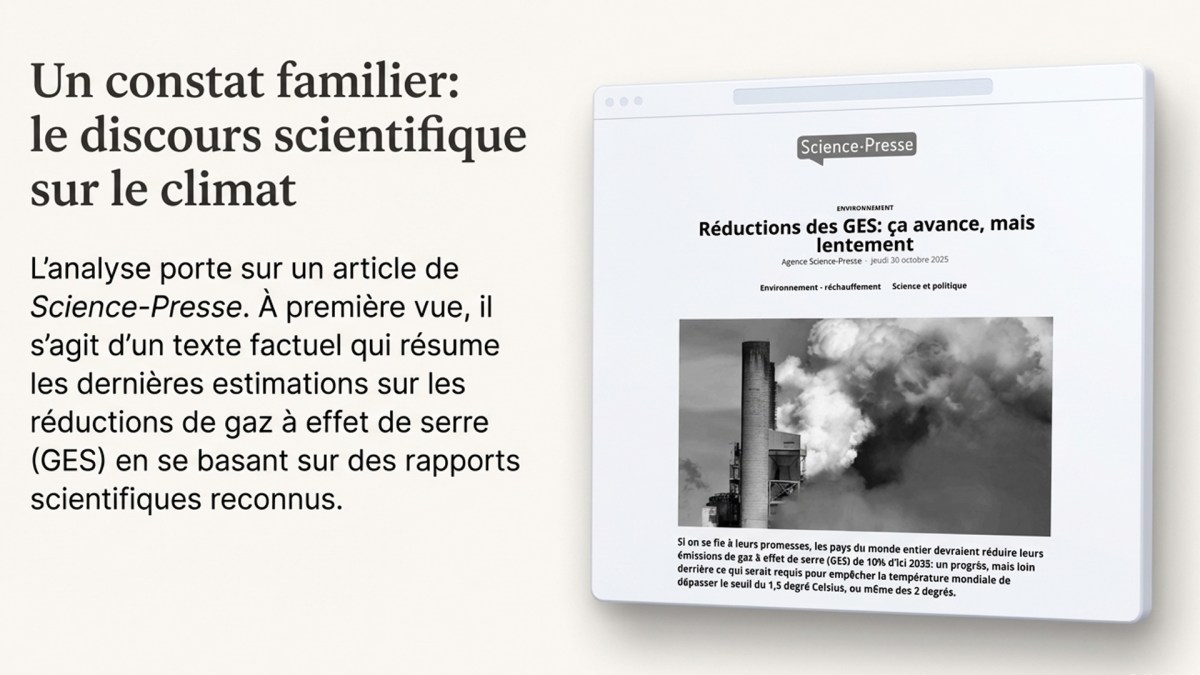LA LIGNE COURBE DU TEMPS
Un homme attend. Sous la voûte éclairée d’un métro presque désert, la lumière trace un serpent blanc sur le plafond noir. Elle guide l’œil, comme si la perspective elle-même hésitait à s’enfoncer dans la nuit. Le train, massif, silencieux, semble surgir d’un temps suspendu.
L’homme, absorbé par l’écran qu’il tient, est ailleurs : dans ce territoire invisible où le monde se replie dans une interface. Il n’attend pas le train, il attend le signal.
Le cadran lumineux, 21:12, n’indique pas une heure : il marque une fracture. L’instant précis où la routine bascule en solitude.
Tout, dans la composition, respire la tension entre le fixe et le mobile : la courbe du quai contre la rectitude du corps, la répétition géométrique des tuiles contre l’incertitude du noir. C’est un théâtre minimaliste où la lumière devient langage, où chaque néon répète le même mot muet : patience.
Ici, la modernité s’exprime par soustraction. L’image est un silence structuré — une absence organisée autour d’un geste minuscule. À cette heure tardive, la ville ne parle plus : elle écoute l’écho des notifications.