L’INVENTION SOCIALE DE L’OBÉSITÉ
La lutte contre l’obésité n’est pas qu’une question de santé, mais une construction culturelle où médecine, mode et normes sociales redéfinissent sans cesse ce qui est « normal ». En bref : l’obésité, c’est d’abord une histoire de société.
Se surveiller, se corriger, s’optimiser
Aujourd’hui, la santé ressemble de plus en plus à une activité à part entière. Elle s’insinue dans nos routines, dans nos écrans, dans nos conversations. Ce n’est plus seulement l’idée de ne pas être malade, mais une sorte de travail constant qui nous accompagne du réveil au coucher. La montre connectée nous rappelle qu’il est temps de bouger, l’application nous félicite ou nous gronde, le scan de code-barres nous dit si tel aliment mérite d’être mis dans le panier. Tout semble organisé autour d’un même impératif : se surveiller, se corriger, s’optimiser. Comme si nous étions devenus les gestionnaires à temps plein de notre propre organisme.
Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, mon point de départ repose sur une idée simple mais décisive : notre regard sur le corps a basculé. Autrefois, on attendait de lui qu’il fonctionne correctement et, s’il faiblissait, on le réparait. Aujourd’hui, il apparaît comme un terrain rempli de risques potentiels, un espace où pourraient se cacher des problèmes encore invisibles. La santé n’est plus une évidence tranquille, mais un état fragile qu’il faut gérer en permanence. Ce n’est plus l’absence de maladie qui rassure, mais l’absence de prédisposition. Ce glissement modifie complètement notre manière de nous percevoir.
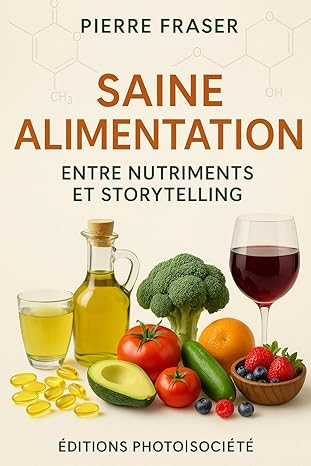
Dans une société saturée de promesses nutritionnelles, où chaque bouchée semble devoir justifier son existence par des vertus supposées, Pierre Fraser démonte avec une ironie salutaire les grands récits de la « saine alimentation ». Antioxydants miraculeux, superaliments héroïques, aliments « sans ceci » et « enrichis de cela », vins désalcoolisés et fauxmages bien pensants : l’assiette contemporaine est devenue un théâtre, une mise en scène savamment orchestrée où les discours scientifiques se muent en certitudes médiatiques, et où le plaisir de manger se dilue dans une avalanche de données et d’injonctions contradictoires.
Illustrons cette mutation avec un exemple familier : la tension artérielle. Pendant des décennies, une tension un peu élevée restait parfaitement acceptable. Puis un nouveau terme s’est installé, celui de « pré-hypertension ». Rien n’a changé dans le corps des gens, mais leur statut, lui, s’est transformé. Ils se sont retrouvés dans une zone intermédiaire, ni malades ni tout à fait sains, comme en sursis. Ce sentiment d’être « presque malade » n’est pas un détail anodin : il alimente une incertitude continue et déplace la responsabilité vers le mode de vie, devenu simultanément accusé et solution. Chaque choix alimentaire, chaque heure de repos, chaque minute d’activité semble peser dans la balance.
Cette logique s’est renforcée à la fin des années 1990, lorsqu’une série de révisions de normes médicales a redéfini de vastes pans de la population. Aux États-Unis, un simple changement de seuil pour diagnostiquer l’hypertension ou le diabète a suffi pour transformer du jour au lendemain des millions de personnes en « nouveaux patients ». Il n’est nullement question ici de complot, mais d’une convergence d’intérêts : d’un côté une médecine animée par l’idée légitime de prévenir toujours plus tôt, de l’autre une industrie dont les marchés s’étendent naturellement lorsque les frontières de la maladie se déplacent. Ainsi, la maladie n’est plus un état soudain, mais un continuum sur lequel il suffit de bouger une ligne pour faire basculer des foules entières dans la catégorie à surveiller.
Derrière ces changements s’installe un autre phénomène, plus culturel que médical : la responsabilisation individuelle. L’État, autrefois garant de la santé collective, tend à déléguer une partie de ce rôle à chacun. Le message implicite semble dire : vous avez les outils, vous avez l’information, à vous de vous gérer. La modernité sanitaire repose alors sur un triptyque familier : dépister, bien manger, être actif. Chacun devient une sorte de médecin de soi-même, chargé d’anticiper ses risques, de repérer ses faiblesses, de maintenir son corps dans un état de performance acceptable. Cette dynamique peut encourager de bons réflexes, mais elle installe aussi une vigilance continue, parfois anxieuse, et demande un effort que tout le monde ne peut pas fournir de la même manière.
Soulignons aussi que cette transformation dépasse le domaine strict de la santé pour toucher à l’identité. Le corps n’est plus seulement un organisme vivant : il devient une manière de se présenter au monde. Certaines normes corporelles, souvent héritées d’un long passé culturel, persistent avec une force étonnante et peuvent exercer une pression, surtout lorsque les comparaisons sont constantes, comme c’est le cas dans les environnements numériques actuels. Ce que je cherche à mettre en lumière, c’est le fait que ces normes ne sont pas seulement esthétiques ; elles s’alignent avec les valeurs d’efficacité, de maîtrise de soi et de productivité que notre société met en avant. Cela peut conduire, chez certaines personnes, à une sensation de jugement ou d’échec lorsqu’elles ne correspondent pas à ces standards, alors même qu’il existe une grande diversité de corps légitimes et sains.
Au fil de cette analyse, une image se dessine donc : celle d’un corps devenu chantier permanent. Un chantier parfois motivant, parfois épuisant. Un chantier où l’on tente sans cesse de mesurer, d’améliorer, de prévenir, de contrôler. Et c’est là qu’il faut soulever une question lourde de sens : si la santé, désormais fragmentée en indicateurs, devient le cœur de notre projet de vie, que reste-t-il pour les autres dimensions de l’existence ? Que devient l’espace du spontané, du créatif, du gratuit, celui des relations humaines complexes ou des moments où l’on accepte simplement d’être sans chercher à performer ?
Ce questionnement, loin d’être alarmiste, ouvre un espace de réflexion nécessaire. Il nous invite à réévaluer la place que nous accordons à la santé dans nos vies. Non pas pour nier son importance, mais pour éviter qu’elle ne devienne un horizon d’inquiétude permanente. Car au fond, la santé devrait rester ce qu’elle a longtemps été : un allié discret, et non une obligation de chaque instant.
© Pierre Fraser (PhD), linguiste et sociologue, 2020-2025




















