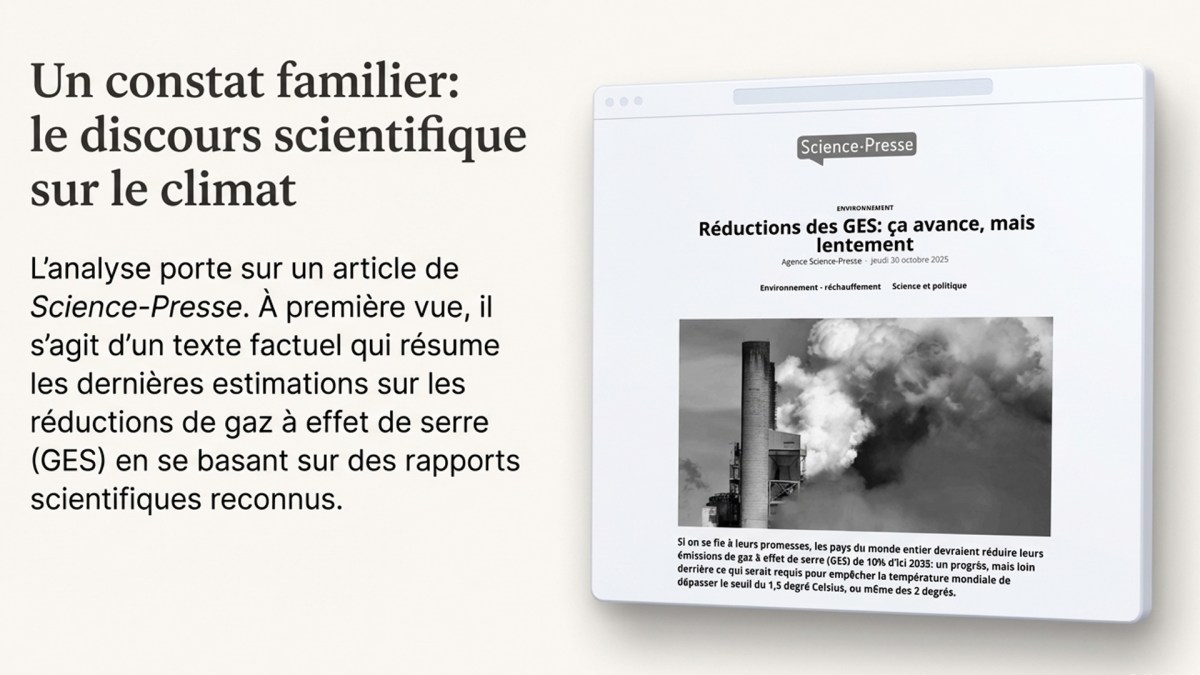Acheter ce livre : Québec | France
Et si l’écologie était devenue une tragédie en plusieurs actes ? Un drame antique rejoué sur la scène du monde moderne, où les protagonistes se prennent les pieds dans les ficelles d’un spectacle moral, oscillant entre vertu affichée et hypocrisie profonde.
Dans cet essai découpé avec mordant en cinq actes, Pierre Fraser et Georges Vignaux décortiquent les illusions vertes de notre époque. À travers une fresque intellectuelle aussi lucide qu’irrévérencieuse, ils interrogent la montée des discours écologistes, leur transformation en dogmes, leur récupération par le capitalisme, et leur glissement progressif vers une nouvelle forme de puritanisme hygiéniste.
De la trottinette urbaine au compost de bonne conscience, du mythe de Gaïa aux tribulations de Greta Thunberg, du bio aseptisé aux injonctions morales qui polluent l’espace public, Écologie — Une tragédie grecque en cinq actes pose la question qui fâche : l’écologie sauve-t-elle vraiment la planète, ou simplement nos égos ?
Sans complaisance, avec une plume acérée et un regard de sociologue, les auteurs dévoilent une écologie devenue religion séculière, spectacle mondialisé, théâtre de symboles plus que de résultats. Une critique salutaire et nécessaire, qui invite à repenser notre rapport à la nature, à la consommation — et à nous-mêmes.
ISBN 978-2921475150, 246 pages
Lire l’introduction de cet essai
L’idée de « sauver la planète » semble sortie d’un conte mythologique, où une poignée de héros écologistes se sont autoproclamés les gardiens de la Terre. Leur mission ? Protéger la planète d’un désastre imminent. Mais, d’où vient cette vocation quasi messianique ? Le vide spirituel laissé par le déclin des grandes religions a peut-être poussé certains à chercher une nouvelle cause sacrée. Sauver la planète est devenu le dernier refuge de ceux qui cherchent un sens à une existence post-industrielle.
Il y a bien sûr le mythe de Gaïa, cette Terre mère, autrefois vénérée par les sociétés primitives. Une sorte de retour à un passé idéalisé, où l’harmonie entre l’homme et la nature était censée régner. Ce n’est pas innocent que les écologistes en appellent à une forme de spiritualité laïque. Mais l’urgence climatique, quant à elle, a transformé ce discours en croisade moderne. Le climat change, la planète brûle, il faut agir ! Ce n’est plus une question de foi, c’est une question de survie. Les prophètes verts ont pris le relais.
Les méthodes, elles, varient d’une école à l’autre. Certains, les plus radicaux, prônent un retour à une simplicité frugale, presque ascétique. Renoncer à la surconsommation, recycler, cultiver son propre potager, c’est leur mantra. Le confort matériel, à leurs yeux, est une trahison de la planète. Cette forme de repentance écologiste, ce désir de purification, nous pousse à un retour en arrière. Mais qui est prêt à sacrifier son mode de vie moderne ? Peu…
D’autres croient au miracle technologique. L’idée est séduisante. Des panneaux solaires, des éoliennes, des voitures électriques. On veut réinventer le progrès. Comme si la technologie pouvait compenser les excès du passé. Pourtant, cette foi en un avenir vert grâce à l’industrie contient un paradoxe éclatant. Peut-on vraiment sauver la planète avec les outils qui l’ont mise en péril ? Là est le nœud du problème. Le capitalisme vert reste du capitalisme.
L’impact de ces méthodes est à double tranchant. D’un côté, des petites victoires locales, des initiatives vertueuses qui semblent prouver qu’un autre monde est possible. La réduction des déchets, la reforestation, les énergies renouvelables à petite échelle, tout cela fonctionne… en théorie. Mais à l’échelle mondiale, l’effet est moindre. Les grandes conférences sur le climat s’enchaînent, des promesses sont faites, mais la machine industrielle continue son chemin, alimentée par la demande incessante d’une humanité en quête de confort.
Pendant que l’Occident impose des normes environnementales de plus en plus strictes, les pays émergents continuent de développer leurs infrastructures sans se soucier des impacts environnementaux. Qui peut leur en vouloir ? Ces pays aspirent à la même prospérité que l’Occident. Sauver la planète devient alors un privilège de riches. Comment concilier cette contradiction fondamentale ? C’est là que l’écologisme devient une lutte des classes déguisée.
Dans ce climat de culpabilisation permanente, chacun est sommé de faire sa part. Ne prenez plus l’avion, abandonnez votre voiture, devenez végétalien, procréez moins… L’écologie devient un dogme, une nouvelle religion où les péchés ne se confessent plus à l’église, mais sur les réseaux sociaux. Mais cette culpabilisation collective, aussi bien intentionnée soit-elle, finit par étouffer. Combien sont prêts à sacrifier leur confort pour une cause qu’ils ne peuvent ni voir ni toucher ? L’écologie radicale pousse parfois le bouchon trop loin.
L’ironie veut que derrière certaines de ces injonctions écologiques, le cynisme pointe. De grandes entreprises polluantes s’adaptent à l’air du temps en adoptant une façade verte. On parle alors d’écoblanchiment. Le capitalisme a toujours su récupérer les idées nobles pour les transformer en profits. Une usine, recouverte de panneaux solaires, est-elle moins destructrice ? Le système s’adapte, se transforme, mais au fond, les mêmes logiques consuméristes demeurent.
La véritable question qui se pose est celle de l’humanisme. Peut-on sauver la planète sans sauver d’abord les hommes ? Car derrière chaque projet industriel, chaque émission de CO2, il y a un besoin humain, une vie, un quotidien. Les écologistes, dans leur zèle, oublient parfois que les solutions qu’ils proposent ne peuvent s’appliquer uniformément. Le monde est complexe, les besoins humains sont multiples. Vouloir imposer des solutions globales à des problèmes locaux est une erreur stratégique.
Il y a dans cette quête de sauver la planète une forme de distraction. En cherchant à résoudre le problème écologique, on évite de regarder d’autres crises : la pauvreté et les inégalités sociales, la crise de l’immigration. Tout cela est lié, bien sûr, mais se focaliser uniquement sur le climat, c’est ignorer les réalités humaines qui en découlent. L’écologisme, dans sa version extrême, devient alors une fuite en avant.
Finalement, peut-être que la Terre n’a pas besoin d’être sauvée. Peut-être que ce sont les hommes qui doivent apprendre à vivre avec leurs erreurs, à les corriger, sans s’illusionner. La planète continuera de tourner, avec ou sans nous. Ce sont nos conditions de vie qui sont en jeu, pas celles de la planète. Mais cette nuance échappe souvent à ceux qui brandissent des slogans enflammés, pleins de bonnes intentions, mais parfois déconnectés des réalités du terrain.
Et tous ces slogans et campagnes de culpabilisation carburant à la moraline commencent dans les années 70 avec Greenpeace, le Club de Rome, le WWF et bien d’autres — ces véritables archétypes d’un discours vert devenu dogme — qui ont su s’élever au rang de prophètes dans le théâtre de nos préoccupations contemporaines. C’est fascinant. Non, mieux, c’est troublant. Et pourtant, l’aube de cette histoire n’avait rien de prometteur dans les années 60. Un patchwork d’idées éparpillées, que l’on associait volontiers aux marginaux, aux radicaux, à ceux qui osaient affirmer ce que personne ne voulait entendre. Imaginez, dans une époque d’euphorie économique, quelqu’un vous glisse à l’oreille que la croissance, oui, la sacro-sainte croissance, était l’arme de notre propre destruction. Il fallait un certain goût du paradoxe, une forme raffinée d’arrogance, ne craignons pas les mots, pour pointer du doigt ces géants que sont les multinationales et les gouvernements, les accusant, comme on accuserait Zeus, de préparer l’apocalypse.
Voyons Greenpeace. Un petit groupe de dissidents des années 70, pas plus. Manifestation contre les essais nucléaires en Alaska — il fallait du courage, certes, mais qui aurait parié sur eux ? Et les voilà devenus une icône mondiale. Une multinationale de la contestation, dirait-on, capable d’agiter les foules avec une simple photo d’un ours polaire. Le génie visuel ! Une image suffit. Un éclat glacé de vérité dans un océan de mensonges. Pas besoin de chiffres, de courbes, d’équations ; l’ours flottant est la preuve ultime. Une ironie douce-amère, tout de même : là où Socrate utilisa le verbe pour empoisonner l’esprit, Greenpeace mania l’image comme un scalpel, taillant dans la chair du monde sans un mot.
Et puis, il y a le Club de Rome. Plus aristocratique, presque élitiste dans sa démarche. Là où Greenpeace soulève les foules, le Club de Rome fait vibrer les salons feutrés de la raison scientifique. Les Limites à la croissance ? Un coup de maître. En 1972, à l’apogée du culte technologique, ces intellectuels osent affirmer que l’idole de la croissance infinie n’est qu’une chimère, une promesse de mort lente. La machine n’absorbera pas tout, elle finira par s’étouffer. Et ce ne sont pas de doux rêveurs, non, mais des savants, des penseurs ; ceux dont les chiffres sonnent comme des oracles. À une époque où l’on croyait que l’atome allait nous sauver, eux disent que l’atome, lui aussi, finira par nous tuer.
Et que dire du WWF, cet étrange hybride de radicalisme doux ? Un conservateur dans l’âme, jouant sur la corde sensible du patrimoine perdu, presque comme un collectionneur nostalgique. Les pandas, les forêts tropicales, les espèces disparues, tout devient capital, et là, oui, la nature se convertit en monnaie d’échange. Vous voulez préserver ces merveilles ? Faites le calcul, la nature vaut de l’or. Ils transforment le chêne millénaire en investissement, le fleuve en dividende. Derrière des slogans faussement candides, l’impitoyable logique du marché s’impose : la nature ne vaut que ce qu’on peut en tirer.
Et pourtant, ne vous y trompez pas, ces trois géants de l’écologie se regardent en chiens de faïence. Greenpeace, toujours prêt à rugir, et le WWF, préférant le murmure à l’oreille des puissants. L’un éclate de colère, l’autre négocie dans les salons dorés. Et le Club de Rome, pendant ce temps, reste dans l’ombre, calculant, prophétisant l’Apocalypse en équations et en graphiques. Chacun joue sa partition, et de ce chaos naît une étrange harmonie : l’idée, radicale, que la croissance est une impasse.
Mais aujourd’hui ? Sont-ils encore ces icônes de la dissidence écologique ? Ou sont-ils devenus des rouages du système qu’ils dénonçaient ? Les multinationales, autrefois honnies, brandissent aujourd’hui des rapports du Club de Rome comme des trophées. Les gouvernements applaudissent, et des fonds d’investissement climatiques garnissent les coffres du WWF. Et Greenpeace, pauvre chevalier blanc des mers, peine à trouver son souffle face à l’ampleur du désastre écologique. Où est passée la radicalité ? Le fracas des débuts ? Peut-être ont-ils tous été récupérés, avalés par la machine même qu’ils combattaient.
Alors que reste-t-il ? Une écologie devenue institutionnelle, peut-être même confortable. Une idéologie qui, paradoxalement, maintient l’ordre établi en prétendant le subvertir. Leur victoire, si victoire il y a, serait-elle d’avoir fait croire que le changement était possible, alors que la grande roue du capitalisme continue à tourner, inexorablement, avant tout ?