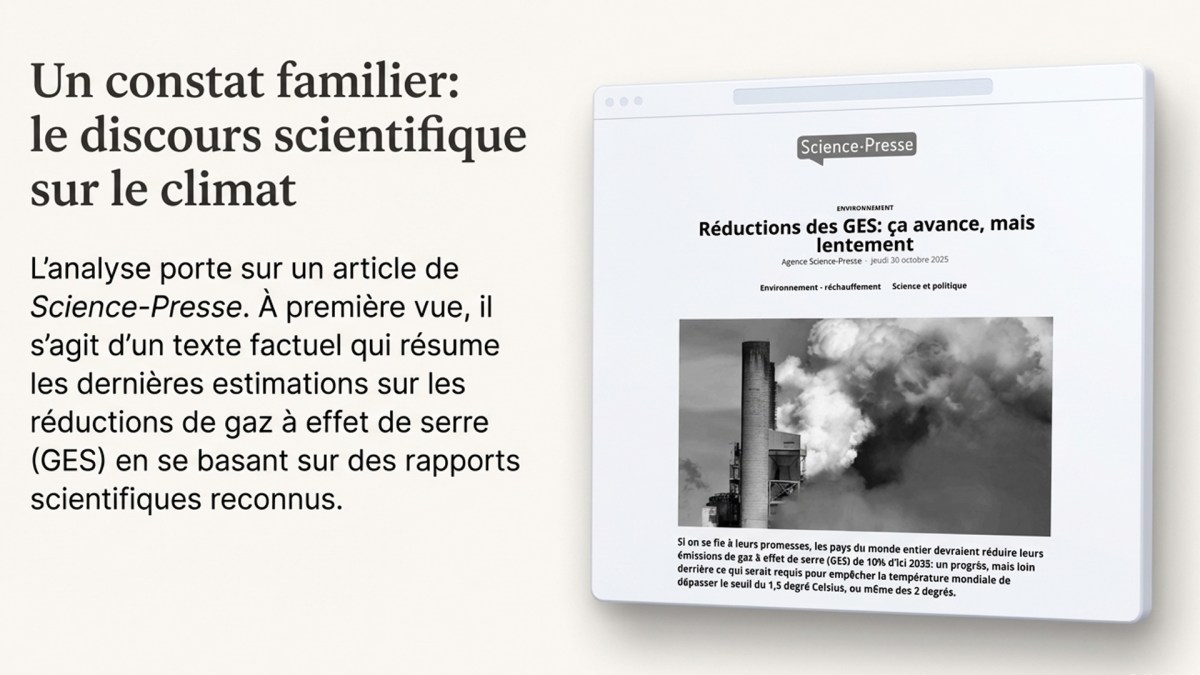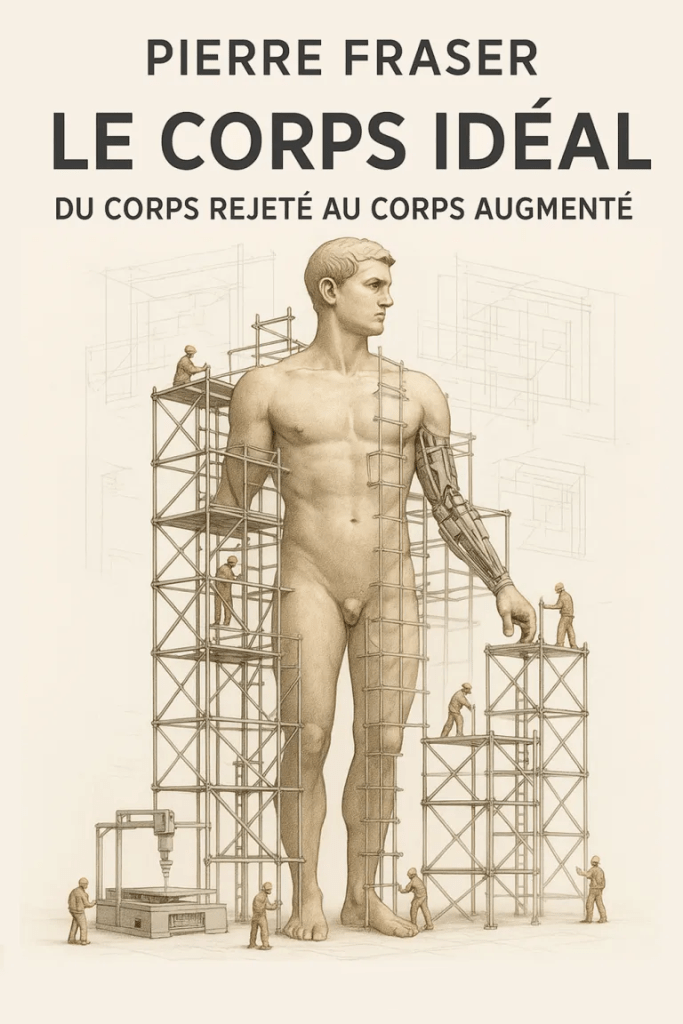UNE BRÈVE HISTOIRE DU CORPS
XVIIIe siècle

L’obésité et le corps socialement acceptable
Lire l’article
Citer cet article
Fraser, P. (2015). « L’obésité et le corps socialement acceptable ». Une brève histoire du corps – Du corps rejeté au corps augmenté. Éditions Photo|Société, pp. 87-89.
Le corps socialement acceptable du XVIIIe siècle est définitivement le corps énergique, et le cas de l’avocat parisien Jean-Baptiste Jacques Élie de Beaumont est particulièrement éloquent à ce sujet. Dans une correspondance[1] entretenue pendant plus de dix ans entre 1765 et 1776 avec les médecins Antoine Petit (1718-1794) et Samuel-Auguste Tissot, l’avocat en question, « à l’âge de 32 ans se retrouve extrêmement incommodé d’un excès d’embonpoint qui devient chaque jour plus considérable : il demande par quels moyens on pourrait au moins en arrêter le progrès[2] […] pour contrer les effets de son obésité, essentiellement la somnolence et l’impuissance[3]. » Le pauvre homme est découragé, comme en rend si bien compte Tissot :
« Rien ne l’émeut, rien ne l’excite. La vue d’une belle femme, le spectacle de l’opéra, les livres les plus propres à l’objet, tout en un mot ce qui flatte et anime les sens, le laisse dans son assiette naturelle, c’est-à-dire nulle. […] Il est fermement persuadé que s’il pouvait perdre beaucoup de son embonpoint il recouvrerait d’autant la faculté générative, parce que toute la substance que son ventre absorbe tournerait au profit des parties inférieures et qu’elles recouvreraient le ton et le ressort qu’elles ont absolument perdu[4]. »
Et lorsque Elie-de-Beaumont arrive à quelque chose, il s’agit d’une
« Situation molle et flasque, même au moment de l’émission de la semence. De là une répugnance secrète pour un acte où la grosseur fréquente et les mauvais succès réitérés font trouver peu d’attrait. Ou bien, dans un moment de passion, émission instantanée par le simple contact ; quelquefois même par l’imagination, et ensuite impossibilité d’acquérir une seconde émission[5]. »
Il importe de bien considérer certains éléments de ce discours. Tout d’abord, l’obésité provoquerait non seulement une atonie du membre viril, mais une atonie généralisée, une certaine perte de jouissance de la vie. Deuxièmement, lorsque la passion se pointe, ce n’est que dans un moment furtif et de grande célérité qu’elle trouve son exécution. Troisièmement, moins d’embonpoint serait synonyme de réactivité retrouvée au profit des parties inférieures. Ce discours de la capacité sexuelle lié à la minceur retentira jusqu’au XXIe siècle dans la téléréalité américaine The Biggest Loser où jeunes hommes et jeunes femmes obèses parlent de leur désespoir d’arriver à trouver un conjoint, et pour ceux qui sont déjà en couple, d’avoir une vie sexuelle accomplie. Se dessine et se précise donc ici, en filigrane, dès le XVIIIe siècle, Le martyre de l’obèse[6], dont Elie-de-Beaumont est en quelque sorte le précurseur, est une notion qui prendra de l’ampleur au cours des siècles suivants. Ce déplacement dans le discours est significatif, car il est désormais supposé que l’obésité rend non seulement l’individu malheureux, impuissant et affligé de différents problèmes de santé, mais qu’elle l’empêcherait d’avoir accès à l’amour. Le très gros, à l’aune de cette nouvelle représentation du corps, ne correspond en rien aux critères de force, de beauté et de réactivité propre au Siècle des Lumières, bien au contraire. Et Tissot, en disant que les effets d’une « vie trop sédentaire sont de détruire la force des muscles, et de les mettre, par la désuétude, hors d’état de supporter le mouvement[7] », engage non seulement une façon de travailler sur l’intérieur du corps, mais indique aussi ce qui doit être fait pour éviter l’amollissement et la dégénérescence ; ne reste plus qu’à déterminer scientifiquement ce qui doit être fait pour y parvenir, et les siècles suivants y pourvoiront.
En somme, avec le XVIIIe siècle, l’attention portée au très gros s’est à nouveau déplacée. Il n’est plus un simple balourd inculte ou incapable, il est désormais un personnage inutile, improductif et peut-être même impuissant. L’individu est non seulement aspiré dans une affirmation de soi avec son autonomie nouvellement acquise, mais aussi dans le fait de trouver en lui les ressorts internes pour vivre pleinement sa vie d’être humain. Le très gros sera stigmatisé à l’aune de cette idée : le manque de réactivité interne, car il n’a pas su trouver en lui cet appui sur soi qui permet d’agir. En fait, tout le discours à propos du corps socialement acceptable pour les siècles suivants roulera sur cette idée : la réactivité, le fait de se prendre en mains, la volonté d’être plus que ce que l’on est soi-même, l’individu autonome, maître de son destin, architecte de sa vie et entrepreneur de lui-même.
[1] Teysseire, D. (1995), Obèse et impuissant : le dossier médical d’Elie-de-Beaumont, 1765-1776, Grenoble : Éditions Jérôme Millon.
[2] Fonds Tissot de la Bibliothèque Cantonale et Universitaire (BCU) de Lausagne-Dorigny, coté IS 3784. Côte 1444, 4e chemise, que se trouvent les seize pièces concernant Jean-Baptiste Jacques Elie-de-Beaumont. [Source : Teysseire, D. (1995)].
[3] Teysseire, D. (1995), op. cit., p. 68.
[4] Lettre de Tissot datée du 9 juin 1776. [Source : Fonds Tissot de la Bibliothèque Cantonale et Universitaire (BCU) de Lausagne-Dorigny].
[5] Idem.
[6] Béraud, H. (1922), Le martyre de l’obèse, Paris : Kieffer.
[7] Tissot, S. A. (1820), op. cit., p. 49.
© Pierre Fraser (PhD), sociologue et lingusite, 2015-2025

La cuisine raisonnée
Lire l’article
Citer cet article
Fraser, P. (2015). « La cuisine raisonnée ». Une brève histoire du corps – Du corps rejeté au corps augmenté. Éditions Photo|Société, pp. 82-87.
En matière d’alimentation, les cuisiniers du XVIIIe siècle s’entendent à peu près tous pour faire table rase de l’héritage culinaire des siècles précédents. Paradoxalement, les cuisiniers suggèrent de revenir à la simplicité et à la pureté naturelle des aliments, mais proposent dans le même souffle une cuisine qui exige beaucoup de travail et de préparation combinant une multitude de saveurs. La préface de l’ouvrage Les dons de Comus ou les délices de la table est éclairante à ce sujet : « La science du cuisinier consiste à décomposer, à faire digérer et à quintessencier les viandes ; à tirer des sucs nourrissants et pourtant légers, à les mêler et à les confondre ensemble, de façon que rien ne domine et que tout se fasse sentir ; enfin, à leur donner cette union que les peintres donnent aux couleurs et à les rendre si homogènes, que de leurs diverses saveurs il résulte qu’un goût fin et piquant, et si j’ose le dire, une harmonie de tous les goûts réunis ensemble[1]. »
Il s’agit donc d’un travail où se mêlent compréhension de la structure des aliments, satisfaction du palais, et raffinement de table à travers une démarche structurée et structurante. Démarche structurée, dans le sens où les propriétés des aliments sont plus que jamais scientifiquement décortiquées et analysées tout au long du XVIIIe siècle à travers la publication de plusieurs encyclopédies des aliments. Le médecin écossais John Arbuthnot (1667-1735), dans son Essai sur la nature et le choix des aliments, suivant les différentes constitutions, signale tout d’abord qu’il lui « arriva d’affirmer, que cette partie de la médecine [la diététique] était fondée, autant qu’aucune autre, sur des principes scientifiques[2]. » Après avoir établi la crédibilité de son œuvre, il discourt sur la nature même des aliments : astringents[3], adoucissants[4] et antiacides[5]. Il dispense également ses conseils en fonction de la constitution des personnes : « Les personnes jeunes, chaudes, robustes et laborieuses, peuvent se nourrir de viandes dures et grossières, comme le bœuf, le porc, la chair et le poisson salés, le fromage dur, le pain de seigle, les œufs durs, etc., parce que ces substances nourrissent et se digèrent lentement[6] […] Les viandes grasses ne sont bonnes que pour les estomacs secs ; elles sont bientôt corrompues dans les sanguins et les bilieux; dans les phlegmatiques, elles procurent le cours de ventre, et empêchent la rétention[7]. » À remarquer ici, en plein Siècle des Lumières, cette référence à la théorie des humeurs, malgré cette volonté affichée et affirmée de l’approche scientifique. Les vieux repères sont toujours aussi efficaces.
Démarche structurante également, dans le sens où cette cuisine raisonnée présage déjà de la grande cuisine française du XIXe siècle, qui établira les fondements de la gastronomie pour les siècles à venir. C’est aussi l’époque des gourmets et des officiers de bouche de l’aristocratie, avec Vincent La Chapelle (1690 ou 1703 – 1745), auteur du Cuisinier moderne (1735), François Marin, auteur de Les dons de Comus ou les délices de la table (1739), et Menon, auteur de Les soupers de la Cour (1749). Avec cette refonte de la cuisine, le mélange des saveurs est plus nuancé que par les siècles passés où épices et aromates cèdent graduellement la place aux bouillons, aux fumets, aux essences et aux blonds servant à dégager des viandes les délicates saveurs. Les garnitures, pour leur part, font florès : foie gras, truffes, huîtres, morilles et ris de veau agrémentent les repas. Le pâté de foie gras, le fromage Camembert, la pomme de terre et les confitures de toutes sortes s’inscrivent dans cette démarche du renouvellement des pratiques alimentaires.
Au-delà de toute cette effervescence culinaire, tout comme par les siècles précédents, il y aussi une réalité sociale qui détermine le type d’aliments consommés : les festins et les repas de société sont à la cour. Chez les aristocrates, la cuisine est raffinée, d’un grand luxe, et abondante :
« du 6 juillet au 2 novembre 1712, sont livrés chez le comte de Lannoy-Clerveaux au château de Neufville-la-Condroz, 1 298 livres de viande (60 % de viande mouton, 33 % de bœuf et 7 % de veau). Dans d’autres comptes du même ménage apparaissent le porc, qui occupe une moindre place, ainsi que l’agneau, acheté par quartiers ; […] Quant aux volailles […], si elles figurent en bonne place, elles sont nettement devancées par le poisson […] Les légumes sont également variés [et] la place des douceurs, gâteaux, confiseries, sucreries, chocolat, dragées, etc. n’est pas non plus négligeable[8]. »
Le service de table se raffine et de nouveaux ustensiles font leur apparition : la louche ou cuillère à pot, les cuillères à sel, à moutarde, à condiments et à sucre, tout comme la saucière, le moutardier, l’huilier, le beurrier et le sucrier. Les bourgeois, quant à eux, développent une cuisine qui se rapproche de plus en plus de celle de l’aristocratie. Par exemple, chez « les Trappé, au château de Losange, on mange beaucoup du bœuf et du veau, du mouton, du jambon de même que différents poissons et quantité de friandises. […] Dans tous les cas de familles aisées, l’huile d’olive ou de Provence est largement utilisée. Le thé, le café et le chocolat sont répandus. […] Quant à la boisson, outre les vins de pays, on fait venir du vin de Bourgogne, quelquefois même d’Espagne[9]. » La cuisine de la classe bourgeoise, tout comme celle de l’aristocratie, avec la publication par Menon de La cuisinière bourgeoise en 1749, se raffine. Son éditeur précise en préface que Menon « ennoblit les mets roturiers par les assaisonnements dont ils les rehaussent […] pour donner aux plus communs [des mets] une saveur qui ne sera pas commune[10]. » C’est aussi l’apparition de la salle à manger avec l’introduction de la grande table à manger ronde ou ovale. En ce qui concerne le reste de la population, l’écrivain français Rétif de La Bretonne (1734-1806) rend bien compte de l’alimentation d’une tranche de la population, celle du paysan aisé et de ses employés :
« Je vais vous dire un mot de notre nourriture, c’est-à-dire de la manière de vivre du paysan aisé. Pour ceux qui ne le sont pas, du pain d’orge ou de seigle, une soupe à l’huile de noix ou même de chènevis, une mauvaise boisson. […] Mais chez notre maître, nous avions avant de partir pour la charrue une soupe au bouillon de porc salé, cuit avec des choux ou des pois ronds, jointe à un morceau de ce salé et une assiettée de pois ou de choux ; ou bien une soupe au beurre et à l’oignon, suivie d’une omelette, ou d’œufs durs, ou d’herbages, ou de fromage blanc assez bon[11]. »
Autrement, comme par les siècles passés, l’alimentation des masses populaires rurales est « une diète écrasée par le poids des céréales et marquée par une tenace culture de la faim[12]. » Cependant, moins orientée vers les viandes qu’aux XIV et XVe siècles, « la diète paysanne redécouvre le sarrasin, adopte des plantes nouvelles comme le maïs, mais plus difficilement la pomme de terre […] et tend à délaisser les céréales secondaires pour le pain de pur froment au cours du XVIIIe siècle. » Quant au pain, sa noirceur, sa lourdeur et sa mauvaise cuisson signalent manifestement la pauvreté. En somme, le constat, du XVe au XVIIIe siècle, est le même : l’aristocrate et le bourgeois sont les plus susceptibles d’être victimes d’embonpoint. François Marin dira : « Pour qui la goutte, cette goutte indomptable qui punit si cruellement les sensuels, et qu’un ancien (Lucien) appelle ingénieusement la Reine des maladies ? Voilà comment on impute à l’art innocent de la cuisine les effets de l’intempérance. Un célèbre médecin (Hecquet, Traité de la digestion) a fait voir que la plupart des maladies proviennent des vices de la digestion […][13] » Et que dit exactement Hecquet à ce sujet ? Que la « manière de vivre en est un autre indice, parce qu’elle arrive encore à ceux qui usent trop souvent d’aliments gras, de beurre et de ragoûts[14] », de là « les hémorragies, les fluxions, les lassitudes qui annoncent les maladies ou qui les commencent : les appesantissements, les douleurs, et l’accablement qui les accompagnent […][15] » Et c’est justement ici qu’interviennent médecins et moralisateurs pour réguler ce corps en excès de graisse des nobles et des bourgeois, à travers régimes, diètes, rations alimentaires et exercices.
[1] Marin, F., Bougeant, B. (1739), Les dons de Comus ou les délices de la table, Paris : Prault, p. xx.
[2] Arbuthnot, J. (1751), Essai sur la nature et le choix des aliments, suivant les différentes constitutions, traduit de l’Anglais par Boyer de La Prébandier, Paris : Guillaume Cavelier, p. viii.
[3] Astringents : coing, grenade, oseille, pourpier, câpre, pimprenelle, vins, liqueurs fortes, spiritueux.
[4] Adoucissants : fraises, oranges, citrons, limons, pommes, poires, pêches, prunes, groseilles, raisins, figues, melons.
[5] Antiacides : œufs, coquillages, asperges, persil, céleri, ail, rocambole, oignons, cresson, raves, carottes, noisettes, amandes, pistaches, olives, champignons.
[6] Arbuthnot, J. (1751), op.cit., p. 175-176.
[7] Idem., p. 177.
[8] Hudemann-Simon, C. (1985), La noblesse luxembourgeoise au XVIIIe siècle, Paris : Publications de la Sorbonne, 1985, p. 441-442.
[9] Idem., p. 442-443.
[10] Menon (1760), La cuisinière bourgeoise, Bruxelles : François Poppens, p. viii.
[11] Rétif de La Bretonne, N.E. (1779), op. cit.
[12] Quellier, F. (2013), La table des Français. Une histoire culturelle (XVe et début XIXe siècle), Paris : Presses universitaires de France, p. 49.
[13] Marin, F., Bougeant, B. (1739), op. cit. p. xxii.
[14] Hecquet, P. (1712), De la digestion et des maladies de l’estomac suivant le système de la trituration et du broyement, Paris : François Fournier, p. 265.
[15] Idem. p. 227.
© Pierre Fraser (PhD), sociologue et lingusite, 2015-2025

Le corps comme lieu d’accomplissement personnel
Lire l’article
Citer cet article
Fraser, P. (2015). « Le corps comme lieu d’accomplissement personnel ». Une brève histoire du corps – Du corps rejeté au corps augmenté. Éditions Photo|Société, pp. 77-82.
Il importe de revenir sur cette idée de l’individu autonome du XVIIIe siècle, car elle engage le corps pour les siècles qui suivront. Tout d’abord, le XVIe siècle a mis d’avant l’idée qu’il faut préserver son corps et le maintenir en santé. Le XVIIe siècle, quant à lui, dans un mouvement sans précédent, a arraché le corps à l’influence du grand corps collectif : il décrète que l’homme a un corps dont il est personnellement et socialement responsable, d’où un nouveau souci de soi auquel doit répondre la société : « Dans ce contexte, le corps, loin d’être un lieu de perdition, peut devenir au contraire source d’épanouissement[1]. » Cette proposition de l’éthique protestante, à l’opposé de celle du catholicisme, stipule qu’il faut « donner à celui ou celle qui se trouve en situation critique les moyens de surmonter ses difficultés et de vaincre ses angoisses, d’accepter le sort qui lui est fait, non pas pour abandonner la partie, mais pour apprendre au contraire à se maîtriser et par là se dépasser[2]. »
La santé, la bonne condition physique, l’absence de souffrances morales ou physiologiques seraient les conditions de l’épanouissement de la personne. L’individu autonome est celui qui est donc en mesure d’agir sur les choses et les événements. Ce changement de position est pivot dans la construction de l’homme moderne et contemporain. L’individu doit être l’agent et non le patient de son développement. Il faut, en quelque sorte, donner la capacité à un individu de prendre son sort en main à partir de ce qu’il est, afin qu’il puisse formuler et mener par lui-même ses propres plans d’action. Les puritains américains contribueront grandement à structurer ce concept de l’individu autonome, en fondent le récit mythique américain élaboré à partir de trois idées hautement structurantes : une alliance où chaque membre de la communauté s’engage par sa volonté propre à être autonome ; « exhorter tous les chrétiens à gagner ce qu’ils peuvent et à épargner ce qu’ils peuvent, c’est-à-dire en définitive à devenir riches[3] » ; l’Amérique se veut la lumière du monde tournée vers l’avenir — c’est le rêve américain de la cité sur la colline, l’American Way.
Au XVIIIe siècle, le libéralisme, fondé sur la quête du bonheur par le self-government, définit à la fois l’individu et les institutions. Pour l’américain, les institutions telles que la famille, l’école, la tradition et l’État ne sont que des intermédiaires pour se réaliser, car souverain de lui-même, il est autonome. Cette façon de conclure l’alliance sociale entre l’individu et le collectif, c’est celui de l’idéal jeffersonien de la quête du bonheur et celui d’une société gouvernée par des individus relativement égaux. Dans ce contexte, le droit de l’américain à gagner sa vie n’est pas seulement essentiel, mais fondamental, car par son travail, il peut créer de la richesse pour lui-même, tout comme pour sa collectivité, et participer en ce sens au bonheur collectif. L’argent est ici une valeur de respect. Être riche c’est être touché par la grâce divine. Elle démontre que, par son travail assidu, l’individu s’accomplit et qu’il réussit. Plus encore, elle démontre que l’individu ne dépend de personne. C’est un puissant symbole de liberté, mais qui ne soustrait en rien l’individu à son obligation de participer à l’enrichissement collectif et à l’entraide mutuelle.
Même s’il est ici question du XVIIIe siècle, il est tout à fait pertinent d’anticiper sur le XIXe siècle pour bien saisir ce dans quoi l’autonomisation engage l’individu. Le discours viendra du philosophe américain Ralph Waldo Emerson, qui transformera l’individu en un royaume souverain : « L’entreprise américaine, à la différence des autres, entremêle l’accomplissement de soi personnel et commun[4]. » Le concept est simple : Dieu aide ceux qui s’aident eux-mêmes. C’est la confiance en soi prônée par Emerson. C’est la réconciliation de l’individu autonome avec le collectif. C’est la fusion du plus individuel et du plus commun : « la relation de l’individu à l’Amérique est directe, comme celle du croyant avec son Dieu ; il n’a pas besoin de ces institutions qui font la médiation entre le chacun et le commun[5]. » L’américain obtient en bloc sa réalité sociale. Emerson propose alors la notion de self reliance — l’appui sur soi qui permet d’agir — en affirmant : « Vous êtes l’expression de cet univers vaste et merveilleux. […] Faites toutes ces choses avec sincérité et vous vous approcherez de ce que vous êtes vraiment, à savoir : une expression singulière de toute existence — un génie, un créateur, un rédempteur, un guérisseur, un enseignant, une force pour le bien dans le monde[6]. » D’ailleurs, le psaume 137 de l’Ancien Testament, si cher aux puritains, ne dit-il pas : « Je confesse que je suis une vraie merveille, tes œuvres sont prodigieuses : oui, je le reconnais bien[7] » ?
Pour Emerson, une seule condition s’impose : la personne fait l’événement et l’événement fait la personne. Une seule chose est sacrée, l’intégrité de son propre esprit. Un seul fondement de valeur pour l’individu, sa propre nature. Ces trois idées, à elles seules, représentent la base du système de valeurs américain, à savoir, oser être soi-même. Pour Emerson, la self reliance peut tout révolutionner : économie, politique, religion, éducation, relations humaines, objectifs personnels, modes de vie, etc. Cette façon de se concevoir en tant qu’individu implique que la médiation entre l’idéal et le réel, entre les valeurs et les faits, ne peut pas être gérée par les institutions. Elle ne peut être accomplie que par l’individu, d’où cette idée fortement ancrée chez les Américains voulant que les institutions soient suspectes, que l’État n’a pas à materner les individus. Autrement dit, il n’y a de domination que parce qu’il y a au moins un soumis. L’américain ne veut surtout pas être celui-là. Il veut être le premier non-soumis. Cette façon de se représenter n’est pas banale et a des implications profondes qui trouvent des échos jusque dans le discours anti-obésité actuel. Autrement dit, l’obèse a-t-il pris appui sur lui-même pour pouvoir agir ? Car c’est bel et bien ce programme social que propose le XVIIIe siècle : agir, mais agir de façon responsable. Donc, si la personne fait l’événement et si l’événement fait la personne, l’individu doit disposer d’un corps capable de rendre compte de cette proposition. Conséquemment, avec le XVIIIe siècle, la tonification du corps devient centrale, l’exercice « ranime les fibres, entretient la souplesse et le ressort des muscles : il donne des forces au corps, favorise la distribution du suc nourricier, et rend l’esprit plus gai, plus vif et plus vigoureux : il divise les humeurs, développe les sels, atténue le sang, accélère le mouvement, le perfectionne […][8]. » C’est l’ère de la fibre, des nerfs et des muscles. La fibre a non seulement désormais un prestige qu’elle n’avait pas auparavant, mais elle est en passe de renverser la théorie des humeurs : « Une bonne condition du corps ne se limite plus à celle, simplissime, de la pureté des substances ou de la solidité des chairs telles que les évoquaient les médecins du XVIe ou du XVIIe siècle. […] L’image humorale du corps cède toujours davantage la place à une image plus complexe faite de tension et d’excitation[9]. »
Pour le médecin suisse Samuel-Auguste Tissot (1728-1797), la fibre se veut « la principale partie de la machine humaine[10]. » Elle est ferme et vigoureuse du moment qu’elle est excitée et activée : « Les principaux effets de l’exercice sont de fortifier les fibres, de maintenir les fluides dans l’état convenable, de donner l’appétit, de faciliter les sécrétions, et surtout la transpiration, de relever le courage, et de produire une sensation agréable dans tout le système nerveux[11]. » La fibre de bonne qualité répondrait donc non seulement de la santé globale de l’individu, mais aussi de son courage, glissement depuis le biologique jusqu’au jugement moral des qualités d’un individu. Il y a aussi tous ces aliments gras qui « augmentent le relâchement des fibres de l’estomac, émoussent l’action déjà trop faible de la salive, des sucs digestifs de la bile, [et] des liqueurs intestinales[12] », tout comme il y a ceux qui revigorent, comme le blanc d’œuf qui « fortifie beaucoup les personnes faibles[13]. »
Les prescriptions pour être en santé du médecin suisse Théodore Tronchin (1709-1781), quant à elles, sont simples : « une alimentation modérée, l’air pur, la vie à la campagne, l’équitation, et par-dessus tout, l’exercice en plein air. Il ordonnait à un abbé de couper du bois, à une abbesse de faire elle-même sa chambre et de frotter le plancher[14]. » Il y a donc cette recherche de la tonification et du renforcement de la fibre par l’activité, qui « n’est plus l’épurement, mais l’endurance [où] l’enjeu n’est plus l’affinement des matières, gage de distinction, mais leur endurcissement, gage de dureté nouvelle[15] » [qui se traduira aussi par l’endurcissement du moral :] « la faiblesse organique devient ici faiblesse de civilisation, les repères d’affermissement deviennent indices revendicatifs[16]. »
Le médecin écossais Guillaume Buchan (1729-1805) résumera en une seule phrase ce qui constituera vraisemblablement le fondement même du jugement moral à propos du manque de volonté des gens obèses : « Un libertin qui altère sa santé est plus coupable envers sa postérité que le prodigue qui dissipe son bien et celui d’autrui[17]. » Le jugement est donc posé : le très gros est coupable de sa condition. Cette idée de la fibre endurcie, vigoureuse, ferme et tonifiée fédère non seulement une nouvelle représentation du corps, mais aussi celle de l’individu autonome, maître de sa vie et architecte de son destin. Seul celui qui a de l’endurance serait apte à affronter la vie, seul celui en mesure de puiser dans ses ressources, et seul celui en mesure d’appuyer sur ses ressorts internes pour se réaliser serait apte à confronter l’adversité. C’est bien l’individu du XXIe siècle qui est ici dessiné en filigrane. De toute évidence, l’obèse a la fibre ramollie et n’a pas la réactivité attendue dans un tel programme de société.
[1] Gélis, J. (2005), op. cit., p. 109.
[2] Ibidem.
[3] Weber, M. (2003), L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, suivi d’autres essais, édité, traduit et présenté par J.P. Grosselin, Paris : Gallimard, p. 47. (Weber souligne la phrase.)
[4] Bercovtich, S. (1975), The Puritan Origins of the American Self, London : Yale University Press, p. 169.
[5] Ehrenberg, A. (2010), op. cit., p. 54.
[6] Emerson, R.W. ([1841] 1993), Self-Reliance and Other Essays, Mineola, N.Y. : Dover Thrift Editions. (Notre traduction).
[7] Traduction française œcuménique de la Bible (TOB) parue en 1975-1976 effectuée en commun par des chrétiens de confession catholique et protestante.
[8] Jacquin, A. P. (1762), De la santé. Ouvrage utile à tout le monde, Paris : Durand, p. 270.
[9] Porter, R., Vigarello, G. (2005), « Corps, santé et maladies », Histoire du corps. 1. De la Renaissance aux Lumières», tome 1, coll. Points / Histoire, Paris : Seuil, p. 381.
[10] Tissot, S. A. (1869), Œuvres complètes de Tissot, tome 3, Paris : Allut, p. 61.
[11] Idem, p. 48.
[12] Idem, p. 121.
[13] Idem, p. 126.
[14] Freschfield, D. W. (1989), Horace-Bénédict de Saussure, Genève : Slatkine, p. 60.
[15] Porter, R., Vigarello, G. (2005), op. cit., p. 382.
[16] Idem., p. 383.
[17] Buchan, G. (1783), Médecine domestique; ou, Traité complet, des moyens de se conserver en santé, de guérir et de prévenir les maladies, par le régime et les remèdes simples, tome 1, 3e éd., Paris : Froullé, p. 21.
© Pierre Fraser (PhD), sociologue et lingusite, 2015-2025

La représentation iconographique du corps
Lire l’article
Citer cet article
Fraser, P. (2015). « La représentation iconographique du corps ». Une brève histoire du corps – Du corps rejeté au corps augmenté. Éditions Photo|Société, pp. 70-77.
Si les XVe et XVIe siècles ont magnifié et glorifié le corps dans la peinture, si le XVIIe siècle a mis en scène des corps mutilés et souffrants, gros et boursouflés, le Siècle des Lumières s’engage dans une autre dynamique. La peinture se diversifie, semble être celle d’un siècle « élégant et frivole, libre de mœurs, vif d’esprit, voué coupablement et délicieusement à une fête insouciante[1] » et voit naître dans la foulée le critique d’art : Diderot sera l’un de ceux-ci. Il n’est plus seulement question de débattre des moyens et des techniques utilisés par l’artiste, mais bel et bien de la finalité de ses œuvres, « sur la possibilité d’un jugement éclairé qui reconnaîtrait les valeurs propres du beau et du sublime[2]. » L’écrivain et journaliste français Louis-Sébastien Mercier (1740-1814), dans son ouvrage Tableau de Paris, posera une simple question : « À qui profite cet art ? » : « C’est donc pour que l’indolence jouisse dédaigneusement de tous ces arts créés avec tant de travaux. Cela est bien triste à penser. Quoi, tout est fait pour l’œil de la mollesse, pour les plaisirs du voluptueux oisif ! Quoi, c’est pour le réveiller de sa léthargie et de son noble ennui, que les nobles enfants des arts mettent au jour leurs admirables productions ![3] » Et c’est bien là l’une des propriétés de l’Art que relève Mercier : à quelque moment qu’on l’observe, l’art est avant tout l’apanage de ceux qui détiennent le pouvoir et la richesse. Ce sont eux qui commandent les œuvres en fonction de leurs propres critères, de leur goût et de leur culture.
Malgré tout, peu importe que la peinture soit destinée aux privilégiés, il n’en reste pas moins qu’elle doit répondre de son époque et de ses valeurs : elle ne peut s’exclure du contexte social, politique et économique dans laquelle elle s’inscrit. Dans le cadre du XVIIIe siècle, l’art doit se situer dans le projet global de cette société qui cherche avant tout le complet épanouissement de l’humanité de l’homme. En ce sens, l’œuvre d’art doit arracher l’âme et le corps « à l’atonie du désœuvrement, provoquer par le moyen d’événements figurés, au travers d’une simulation réussie, un instant d’effervescence émotive[4] », qui implique non seulement le mouvement, mais la beauté du mouvement et dans le mouvement, ce thème si cher aux Lumières.
Le style rococo, de 1750 à 1781, embellit la femme, en montre ses plaisirs et sa volupté. Le thème des fêtes galantes, en rupture avec la représentation des puissants des siècles passés, cherche plutôt à représenter les plaisirs intimes et personnels ; c’est donc un retour sur soi dans la foulée de l’idée d’avoir un corps et de l’exprimer. Et cette rupture se retrouve aussi dans la littérature avec Rétif de La Bretonne, alors qu’il parle de son père : « Les Académies décernent des prix aux écrivains, qui donnent un nouvel éclat à la gloire des anciens ministres, des hommes de lettres distingués : moi je vais jeter des fleurs sur la tombe d’un honnête homme, dont la vertu fut commune et à tous les jours, pour ainsi parler…[5] » Le néo-classicisme, pour sa part, signale un retour à l’austérité. La surcharge du rococo est abandonnée au profit d’une plus grande sobriété. La peinture de la Révolution française, quant à elle, dépeint le corps du sans-culotte comme un corps robuste, musclé et équilibré en opposition à celui des élites, obèse, boursouflé et bouffi. La représentation iconographique de corps en excès de graisse au XVIIIe siècle n’est pas simple à cerner. Seuls les enfants et les chérubins semblent potelés. L’œuvre Groupe d’enfants dans le ciel (1766) de Jean-Honoré Fragonard (1732-1806) révèle une débauche d’enfants en excès de graisse à la limite de la cellulite.
Dans un tel contexte, la graisse n’a plus la prédominance que lui donnait un Rubens au siècle précédent. Elle est autre. Peut-être faut-il prendre ailleurs les repères de la graisse en ce siècle qui privilégie la réactivité et le mouvement. À ce titre, le portrait de Pierre-Jacques-Onésyme Bergeret de Grancourt, réalisé en 1774 par le peintre néo-classique François-André Vincent (1746-1816), dépeint un individu en surpoids au ventre flasque, aux mamelons naissants qui se laissent deviner à travers le chemisier, mais ne tombe pas pour autant dans le corps boursouflé et craquelé par l’abondance des chairs représenté jadis par Rubens ; il y a ici une retenue. Les hommes sont donc généralement représentés sous deux types : le noble svelte, élégant, et l’homme aux muscles saillants.

Pierre Jacques Onésyme Bergeret de Grand-court, Jean-Honoré Fragonard, 1774.
Par exemple, et pour ne citer que ceux-ci, côté noble svelte et élégant, on retrouve Les heureux hasards de l’escarpolette de Fragonard, Le dépit amoureux de Laurent Cars (1699-1771). Côté muscles saillants, il y a Hercule et Omphale de François Boucher (1703-1770) et Le Verrou de Fragonard. La majorité des peintres, en ce qui concerne la femme, bien qu’elle semble grasse au regard des critères du XXIe siècle, la représentent, selon l’expression du marquis d’Argenson, avec « un joli embonpoint bien distribué[6]. »

Diane sortant du bain, François Boucher, 1742 (Paris, musée du Louvre). Après la chasse, Diane se repose, assistée dans sa toilette par une nymphe. Créateur d’un type féminin ingénu et provocateur, sensuel et élégant, Boucher utilise ce sujet mythologique comme un hymne à la femme.
Qu’il s’agisse de La naissance de Vénus et Diane sortant du bain de Boucher, Le feu aux poudres de Fragonard, Égine visitée par Jupiter de Jean-Baptiste Greuze (1725-1805), Femme nue et couchée de Jean-Antoine Watteau (1684-1721), le corps nu de la femme est toujours charnu et sans excès de graisse. À l’inverse, lorsque le corps de la femme est vêtu, il est mince de taille et tout en poitrine sous l’effet du corset à baleines. Le corps nu et le corps vêtu de la femme ont chacun leur logique. Le premier, dans l’intimité, doit rendre compte de la santé et de la capacité de la femme à enfanter dans ce siècle marqué par l’idée de dégénérescence de la race. Le second doit plaire en société, inciter à la fête galante et au plaisir.
D’autres supports iconographiques serviront également à structurer une certaine représentation du corps : la gravure et la silhouette. Tout d’abord, les gravures de la seconde moitié du XVIIIe siècle, en particulier les scènes du journaliste français Philibert-Louis Debucourt (1757-1832) ou celles du caricaturiste écossais Isaac Cruikshank (1756-1811) « s’ingénient à diversifier les contours, tout en désignant physiquement des distinctions : celles allant du noble au roturier, du maître au serviteur, du dominant au dominé, du corps replet au corps émacié[7] » ; l’anatomie l’emporte sur le faste et le spectacle de l’habit. Autrement, avec la montée du journalisme, la presse est désormais un vecteur de diffusion des représentations du corps. La caricature s’y taille une place tout à fait inédite jusque-là. Celle de Cruikshank, intitulée Indecency (1799), est particulièrement éloquente à ce sujet, qui représente une grosse femme urinant au coin d’une rue. Les gravures de Debucourt, quant à elles, à partir de 1789, avec la liberté d’expression nouvellement instituée en France, trouvent un filon profitable : sa plus célèbre, publiée au bas de l’Almanach mural de 1791, représente une marchande qui vend des journaux à la criée et au numéro.
Pour sa part, le peintre et graveur anglais William Hogarth (1697-1764) sera un pionnier de l’investigation morphologique[8]. Dans La diligence ou la Cour de l’auberge de campagne (1747), Hogarth propose ni plus ni moins qu’un répertoire d’anatomies différenciées esquissant les différentes facettes du paysage social.

La diligence ou la Cour de l’auberge de campagne, William Hogarth, juin 1747. Scènes de campagne électorale et de comédie à l’arrière-plan. Gravure d’E. Riepenhausen d’après W. Hogarth.
Ses œuvres, The Bench (1758) et Simon, Lord Lovat, mettant en scène des magistrats gras, replets et obèses, ou An Election Entertainment (1755) représentant un foisonnement d’individus aux morphologies fort différentes occupés à festoyer, forment non seulement la trame d’une nouvelle prise de conscience de la diversité des corps, mais également de jugements moraux à travers l’attitude et le vêtement dans des contextes du quotidien de la vie des gens.
Un autre support iconographique, la silhouette, prendra d’assaut le paysage des morphologies humaines. Le contrôleur des finances de Louis XV, Étienne de Silhouette (1709-1767) sera à l’origine de l’expression à la silhouette (1759) désignant des objets faits à l’économie, d’une façon sommaire. Rousseau, en 1765, adoptera l’expression profil à la silhouette, qui définira le dessin au trait de profil exécuté en suivant l’ombre projetée par un visage. Vers 1788, le mot silhouette deviendra celui qui décrit l’apparence morphologique d’une personne : le glissement n’est pas anodin. C’est désormais le « trait singulier des chairs, celui des galbes et des profils, avec d’infinies différences dans l’ampleur des poitrines, la protubérance des ventres, la courbure de dos[9] », qui s’affirme, rend compte de la diversité sociale. C’est l’image du commun, car le profil à la silhouette ne peut se confiner à rendre uniquement compte des aristocrates. Il impose la diversité, l’émiettement des allures et des fonctions sociales. Il s’agit donc bien du programme des Lumières qui est ici souligné dans cette démarche : celle du corps réapproprié par chaque individu, le corps qui manifeste la personne, le corps qui n’a qu’à exprimer lui-même. Autre fait intéressant, le mot silhouette, en anglais, sera conservé tel quel. La silhouette est donc en passe de s’imposer non seulement comme gabarit de référence, mais comme ce qui permet également d’atteindre la silhouette rêvée. Le mot fera école au XXIe siècle, autant dans l’alimentation — « Yogourt sans gras et sans sucre ajouté Danone Silhouette[10] » —, que dans le vêtement — « Pour trouver votre silhouette type, mesurez-vous […]. Pensez que chaque corps est unique[11] » —, que dans les lunettes — « qui vous découpent un look de vedette : Silhouette Eyewear[12]. » La silhouette deviendra ainsi le « lieu privilégié du moi[13] ».
[1] Starobinski, J. (1987), L’invention de la liberté, Paris : Flammarion, p. 9.
[2] Idem. p. 9.
[3] Mercier, L. S. (1781), Tableau de Paris, tome 1, Hambourg : Virchaux, p. 30.
[4] Idem. p. 11.
[5] Rétif de La Bretonne, N.E. (1779), La vie de mon père, Neufchâtel, Préface.
[6] de Voyer Argenson, R.L. (1862), Journal et mémoires du Marquis d’Argenson, tome 4, Paris : Société de l’histoire de France, p. 174.
[7] Vigarello, G. (2012), La silhouette, Paris : Seuil, p. 26.
[8] Idem., p. 27.
[9] Idem., p. 29.
[10] Danone, Silhouette Grec, Le bonheur ça se nourrit ; http://www.danone.ca/fr/produits/silhouette, consulté le 12 novembre 2013.
[11] Labrecque, L. (2013), Avec style, la référence pour tous vos secrets de styles ; http://www.louiselabrecque.com/?page=mesurezvous, consulté le 12 novembre 2013.
[12] http://www.silhouette.com.
[13] Vigarello, G. (2012), op. cit., p. 137.
© Pierre Fraser (PhD), sociologue et lingusite, 2015-2025

La monté des régimes alimentaires
Lire l’article
Citer cet article
Fraser, P. (2015). « La monté des régimes alimentaires ». Une brève histoire du corps – Du corps rejeté au corps augmenté. Éditions Photo|Société, pp. 68-70.
Tout au cours du XVIIIe siècle, le régime alimentaire se codifie, se légitime et se diversifie. À l’instar de la Raison qui imprègne tout, la cuisine n’échappe pas au progrès. La science l’investit. L’alimentation devient une donnée biologique, se dessine sur fond d’analyses médico-physiologistes « où les phénomènes chimiques de la digestion côtoient non seulement les recettes culinaires et les rêveries gastronomiques, mais aussi les observations morales ou moralisantes[1]. » Ce que le XVIIIe siècle instaure, c’est une problématique biologique de la nutrition dont il faut déterminer le mécanisme. Pour la première fois, la digestion devient sujet de recherche : s’agit-il d’un simple processus de trituration qui broie la nourriture, ou bien s’agit-il d’un processus qui dissout les aliments ? Le chimiste Georges Durade, dont les travaux feront école, penchera en faveur de la dissolution des aliments :
« La salive [composée de lymphe, et de beaucoup d’esprit nerveux] est comme on voit d’une utilité essentielle, dans l’action préparatoire à la digestion ; mais non à la digestion elle-même, qui pourrait à la rigueur s’en passer : cherchons quelles circonstances, quelles conditions y sont absolument nécessaires. […] Lorsque le bol alimentaire est entré au pharynx, à l’aide des muscles déglutineurs, du voile du palais et de la base de langue ; il parvient delà dans l’œsophage, qui le contractant aussitôt, s’en décharge dans l’estomac, forcé de s’ouvrir cette voie par les obstacles supérieurs. [Par la suite] la véritable action de ces sucs [gastriques], est d’achever l’amollissement des parties féculentes concrètes, de les réduire en bouillie, et vraisemblablement de déterminer à la fermentation tout ce qui en est susceptible[2]. »
Il y a, dans cette citation, quelques repères dont il faut tenir compte. Tout d’abord, l’esprit nerveux dont serait composée la salive et qui correspond à cette idée prégnante du XVIIIe siècle, la réactivité. Ensuite, la marque de la raison et de la science qui cherche à tout expliquer par la description systématique du processus de déglutition et de dissolution des aliments. Ce sont les travaux du biologiste italien Lazzaro Spallanzani (1729-1799) sur la digestion artificielle, celui-là même qui avait réfuté la théorie de la génération spontanée des cellules, qui confirmeront les hypothèses de Durade. Tout cet empirisme traduit également qu’il n’y a pas encore théorisation et rationalisation de la science alimentaire. Pour preuve, ce que ces recherches et travaux n’expliquent pas, c’est comment l’alimentation contribue au maintien de l’équilibre physiologique. Il faudra attendre le XIXe siècle pour y parvenir.
Au-delà de la recherche scientifique sur la nutrition, si le XVIIe siècle a été celui du renouveau culinaire, le Siècle des Lumières aura été celui de l’innovation culinaire. Il s’agit bel et bien d’une nouvelle cuisine éprise de science et d’une plus grande diversité alimentaire dont il est ici question : « En Italie des pâtes ; en Espagne la passion du safran et du chocolat ; en Angleterre de grosses viandes — bœuf et mouton — rôties saignantes ; en Allemagne beaucoup de gibier, beaucoup de salaisons, du pain noir, de la choucroute et des raves ; en Pologne du bouillon de betteraves fermentées et du kasza ; en France, une prédilection pour les volailles de toutes sortes et pour le plain blanc[3]. »
En Amérique du Nord, et plus particulièrement aux États-Unis, de nombreuses terres fertiles et la présence de grands troupeaux ovins et bovins orientent plutôt l’alimentation vers une consommation à base de céréales et de viandes, tout comme en Angleterre. Cette caractéristique d’abondance propre à ce pays fera en sorte que les Américains seront mieux nourris que les Européens. En fait, les études portant sur la taille démontrent toutes que les Nord-Américains du milieu du XVIIIe siècle étaient en moyenne plus grands de 7 cm que leurs confrères britanniques[4]. Non seulement le corps est-il porteur d’identités, mais la qualité de l’alimentation, au XVIIIe siècle, détermine aussi comment le corps sera porteur d’identités.
[1] Aron, J.P. (1961), Biologie et alimentation au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, «Annales. Économies, Sociétés, Civilisations», 16e année, n° 5, p. 971.
[2] Durade, G. (1766), Traité physiologique et chimique sur la nutrition, Paris : Lottin et Hérissant.
[3] Flandrin, J.L. (1983), La diversité des goûts et des pratiques alimentaires en Europe du XVIe au XVIIIe siècle, «Revue d’histoire moderne et contemporaine», vol. 30, n° 1, Le Corps, le Geste et la Parole, p. 73.
[4] Klein, H.S. ([2004] 2012), A Population History of the United States, Second Edition, Cambridge : Cambridge University Press, p. 49.
© Pierre Fraser (PhD), sociologue et lingusite, 2015-2025

La dégénérescence du corps et de la société
Lire l’article
Citer cet article
Fraser, P. (2015). « La dégénérescence du corps et de la société ». Une brève histoire du corps – Du corps rejeté au corps augmenté. Éditions Photo|Société, pp. 64-68.
À l’inverse de cette vision du corps dynamique mû par une force intérieure et cette volonté de réactivité, il y a cette idée, aux environs de 1730, d’une nature dégénérée qui traversera le Siècle des Lumières. En fait, « la noblesse avait pris conscience de sa propre et longue passivité politique comme d’un abâtardissement de la nation, comme d’une dégénérescence par rapport aux glorieux ancêtres ; en conséquence, elle s’efforçait d’arracher la nation à la déchéance, à l’apathie[1]. » Dans les imageries européennes, l’attitude de certaines cours et souverains, notamment celle de Louis XV en France, font du XVIIIe siècle celui de la légèreté, de la frivolité et de la sensualité. Il y a aussi ce rappel constant des moralistes traditionnels voulant qu’un mauvais usage de la sexualité est un danger qui menace la santé corporelle, idée désormais appuyée par les explications médicales, surtout celles du médecin suisse Tissot, « en particulier sous la forme de mises en garde contre la masturbation et contre la menace de maladies vénériennes, jointes parfois à la peur de la dégénérescence de la race humaine[2]. » Il ne faut également pas oublier la puissante montée de l’esprit des Lumières et des philosophes éclairés qui œuvrent vers la vertu. Rousseau est résolu à renverser la nouvelle priorité donnée à l’acquisition des connaissances en faveur d’une restauration de l’éducation morale à travers son Émile ; il va marquer la société sur le plan moral, tout comme le fera Voltaire. C’est dans ce contexte, à partir de 1720, alors que la ville de Londres est particulièrement affectée par un problème d’alcoolisme généralisé — le Gin Craze[3] —, donc de dégénérescence dans cet âge de la Raison, que se révèle dans toute son ampleur une certaine stratification sociale où tous y trouvent en quelque sorte leur compte : les pauvres et les ouvriers qui boivent le gin, ceux qui le distillent et le vendent, les membres du Parlement qui craignent pour l’ordre social, le premier ministre qui voit là une occasion en or de générer des revenus pour l’État avec la taxe sur la vente d’alcool.
Pour les observateurs du XVIIIe siècle, la dégénérescence serait donc partout, alors que, dans les faits, l’accroissement démographique démontre au contraire, après 1750, une Europe plutôt vigoureuse qui connaît une certaine augmentation de l’espérance de vie[4]. Il y a donc là deux réalités qui s’entrechoquent : le discours d’une certaine dégénérescence de la race alors que la population s’accroît. Une seule et même réalité donc pour deux perceptions opposées, en somme, une certaine construction sociale de la dégénérescence. Voltaire ne dira-t-il pas, dans son essai intitulé Essai sur la poésie épique :
« Les Anciens se faisaient une gloire d’être robustes. […] Ils ne passaient pas la journée à se faire traîner dans des chars à couvert des influences de l’air, pour aller porter leur alanguissement d’une maison dans une autre, leur ennui et leur inutilité », tout comme il constate à quel point la société s’est ramollie : « Tous ces jeux militaires commencent à être abandonnés, et, de tous les exercices qui rendaient autrefois les corps plus robustes et plus agiles, il n’est presque plus resté que la chasse ; encore est-elle négligée par la plupart des princes de l’Europe. Il s’est fait des révolutions dans les plaisirs, comme dans tout le reste[5]. »
Le médecin français et théoricien de l’hygiénisme, Charles-Augustin Vandermonde (1727-1762), quant à lui, fait particulièrement état de cette dégénérescence en ouverture de son essai intitulé Essai sur la manière de perfectionner l’espèce humaine :
« Quelque intérêt que nous ayons à rendre notre espèce parfaite, il ne paraît pas que nous prenions tous les moyens d’y réussir. Dans l’enfance loin d’accélérer le développement de nos facultés, en faisant valoir les instruments propres à le favoriser, on contraint nos mouvements, on gêne notre liberté, et on étouffe les efforts utiles de notre âme, par les entraves que l’on donne à notre corps. La force n’est plus un des attributs de l’humanité. La faiblesse et les maladies environnent notre berceau et travaillent de concert à notre destruction. Enfin la plupart des hommes, victimes de la difformité, voient avec regret éclore dans les Ouvrages du Créateur la beauté qui se flétrit sur le corps[6]. »
Dans tout ce discours de la dégénérescence, deux éléments doivent retenir l’attention : les contraintes imposées au corps font référence à tous ces corsets et appareils correcteurs du siècle précédent que dénonce Vandermonde ; la force et la beauté se positionnent désormais comme facteurs unificateurs dans la foulée du siècle précédent d’avoir un corps dont l’individu est personnellement et socialement responsable, d’un corps devenu support des relations sociales. Voltaire et d’autres chroniqueurs de l’époque constatent tout de même que certaines populations s’en tirent mieux que d’autres. Voyant toutes ces courses de jeunes gens et de chevaux sur les bords de la Tamise, Voltaire s’exclamera : « Je me crus transporté aux Jeux olympiques. » Ce qui pousse Voltaire à s’exprimer ainsi réside dans le fait que l’Angleterre s’adonne massivement à l’activité sportive. Les disciplines les plus populaires, celles du peuple, sont codifiées, perfectionnées, adoptées par la haute classe et transformées en véritables jeux nationaux, cultivés par tout ce qui est anglais. D’autre part, Rousseau, dans sa grande idée de la nature salvatrice, voudrait que son Émile fût à l’aise en tout, « dans l’eau comme sur la terre. Que ne peut-il vivre dans tous les éléments ! Si l’on pouvait apprendre à voler dans les airs, j’en ferais un aigle ; j’en ferais une salamandre si l’on pouvait s’endurcir au feu[7]. » Toujours dans le même ordre d’idées, le commentaire du mathématicien Alexandre-Théophile Vandermonde (1735-1796) est intéressant à plus d’un égard : « La force n’est plus un des attributs de l’humanité ». Ce commentaire, s’il est recalé dans le contexte du XXIe siècle, prend toute sa signification, alors que la sédentarité est désormais ciblée comme l’un des facteurs majeurs de la prise de poids où plus du tiers des Américains sont obèses, donc sans force au sens où l’entendait le Siècle des Lumières.
Au total, le XVIIIe siècle suggère de se conformer à la nature, d’éviter les faiblesses, de s’éloigner de tout ce qui ramollit, de développer le corps en même temps que l’esprit. Ce qu’imagine donc le Siècle des Lumières, c’est la possibilité d’agir autant dans et sur l’individu que dans et sur le collectif. Il y a bien ici un changement de registre par rapport aux siècles précédents. C’est donc dans ce contexte du discrédit de la dégénérescence, de l’individu autonome, maître de son destin et architecte de sa vie, de la fibre nerveuse, de l’électricité, de l’anima, de la force et de la beauté, que le très gros s’inscrit. Qu’a-t-il fait à lui-même, à son corps, en tant qu’homme affranchi doué de raison et de génie, pour en arriver là ? C’est en ces termes que se pose le corps obèse au XVIIIe siècle.
En 1771, l’anatomiste Boissier de Sauvages (1706-1767) souligne que l’obésité « est cette maladie où le corps est défiguré par une trop grande quantité de graisse[8]. » Pour la première fois, l’excédent de graisse devient un désordre échappant aux simples gestes de l’ajout ou du retranchement. Ici, le parallèle avec le XXIe siècle est intéressant. Malgré les avancées scientifiques en matière de masse adipeuse, la culture populaire persiste à croire que, pour combattre l’obésité ou en empêcher son développement, il suffit de brûler le nombre de calories ingérées, comme s’il s’agissait de simples gestes d’ajout ou de retranchement. Pourtant, il faut voir comment un corps bien musclé brûle un certain nombre de calories sans pour autant avoir à faire de l’exercice pour retrancher une certaine quantité de calories ingérées.
Ce que le XVIIIe siècle découvre également, c’est que le corps n’obéit pas comme voulu aux méthodes qui lui sont imposées pour maigrir : l’obésité résiste aux soins et à l’exercice, aux régimes[9], aux boissons et nourritures tonifiantes, confirmant ainsi la crainte du relâchement, celle de l’affaissement des enveloppes, l’amoindrissement physique et l’atteinte organique, car pour l’homme des Lumières, ce qui importe, c’est le dynamisme, la réactivité et la vivacité. Le XXIe siècle, quant à lui, n’a pas encore tout à fait résolu ce problème. Par exemple, dans le cadre de la célèbre téléréalité américaine The Biggest Loser, plusieurs de ceux qui maigrissent de façon tout à fait saisissante en l’espace de dix-huit semaines reprennent invariablement du poids, sinon tout le poids perdu, dès qu’ils sont de retour à la maison et dans leur environnement[10]. Il y a, dans le corps, quelque chose d’irréductible face à la graisse que le Siècle des Lumières avait bien relevée.
[1] Klaniczay, T. (1976), « Nationalisme à l’époque baroque », Baroque, vol. 8.
[2] Bloch, J. (1998), op. cit., p. 333.
[3] Warner, J. (2011), Craze: Gin and Debauchery in an Age of Reason, New York : Random House.
[4] Muchembled, R. (1994), « L’extension des marchés / La croissance de la population », Le XVIIIe siècle, 1715-1815, Paris : Bréal, p. 15.
[5] Voltaire (1769), « Essai sur les mœurs et l’esprit des nations », Collection complète des œuvres de M. Voltaire, tome 9, Genève, p. 257.
[6] Vandermonde, C.A. (1756), Essai sur la manière de perfectionner l’espèce humaine, tome 1, Paris : Vincent, p. iii-iv.
[7] Rousseau, J. J. (1854), « Émile ou l’éducation », Collection complète des œuvres de J.J. Rousseau, tome 3, Londres, p. 149.
[8] Boissier de Sauvages, F. (1771), Nosologie méthodique dans laquelle les maladies sont rangées par classes, suivant le système de Sydenham et l’ordre des Botanistes, tome 3, Paris : Hérissant, p. 277.
[9] Sans compter que, à cette époque, les recommandations et les régimes des médecins se contredisent souvent les uns les autres, tout comme aujourd’hui.
[10] Wyatt, E. (2009), On ‘The Biggest Loser’, Health Can Take Back Seat, The Gainesville Sun, Florida, November 25.
© Pierre Fraser (PhD), sociologue et lingusite, 2015-2025

La mouvance naturaliste
Lire l’article
Citer cet article
Fraser, P. (2015). « La mouvance naturaliste ». Une brève histoire du corps – Du corps rejeté au corps augmenté. Éditions Photo|Société, pp. 59-64.
Tout au cours du XVIIIe siècle se développe lentement cette idée de l’exercice « conforme à la nature » articulée autour du fait de marcher, courir, sauter, s’équilibrer, grimper, lever, porter, lancer, attraper, nager et se défendre, autrement dit, le passage à la gymnastique raisonnée à des jeux et des activités produisant des mouvements utiles. Du coup, Mercurialis jouit d’une popularité renouvelée. Il fait loi et devient un classique. En 1722, dans son Traité de l’éducation des enfants[1], le philosophe suisse Jean-Pierre Crousaz (1663-1750) estime « qu’il faut préférer les jeux d’exercice aux autres. » En 1779, L’Encyclopédie de Diderot, parlant de l’homme qui s’adonne à l’exercice et à l’activité physique, dira de celui-ci qu’il « est extrêmement robuste, résiste aux injures de l’air, supporte impunément la faim, la soif, les fatigues les plus fortes sans que sa santé en souffre aucune altération ; il est fort comme un Hercule. [L’autre], au contraire, est d’un tempérament très faible, d’une santé toujours chancelante, qui succombe aux moindres peines de corps ou d’esprit[2]. » Et à l’inverse, les mots ne manquent pas pour qualifier ceux qui ne sont pas « entraînés » : rachitique, dégénéré, vieillard de vingt-cinq ans, petit crevé, squelette ambulant, pantin.
Ce n’est que vers la fin du XVIIIe siècle que l’éducation physique commencera à être théorisée, analysée et décortiquée sous l’œil attentif de la science. Un but lui sera assigné : parfaire le corps. Dès lors, des exercices et des méthodes seront imaginés pour le configurer à certaines attentes. Une question, alors, se pose : faut-il « entreprendre d’agir sur le corps de l’homme pour le rendre apte aux activités exigées de lui par son appartenance à une société, à une nation, par son souci d’effacer les imperfections et les tares de la nature ? » La réponse vient de Clément-Joseph Tissot (1747-1826) avec son ouvrage Gymnastique médicinale et chirurgicale publié en 1780, qui connaît un grand succès dès sa publication, tant en France qu’à l’étranger, alors que des traductions en allemand, en suédois et en italien sont rapidement diffusées et vendues. D’entrée de jeu, Tissot pose une simple question : « Qui ne sait pas que les personnes qui vivent dans l’inaction […] sont sujettes à une infinité de maladies, que leurs fibres sont faibles et relâchées, que leurs sens s’émoussent, que tout leur corps s’engourdit ?[3] » Déjà, le problème de la sédentarité est clairement posé et interpelle médecins et spécialistes de l’éducation physique. Le repère est clair et s’imposera comme origine d’un ensemble d’interventions qui sera éventuellement déployées sur le corps au cours des siècles qui viendront. Et la réponse appuyant ses dires est claire : « Que l’on compare les animaux sauvages avec les animaux domestiques de même espèce, on verra ce que peuvent l’exercice et la liberté pour la vigueur du corps ; ces derniers sont gras parce qu’ils sont bien nourris, bien soignés ; mais ils sont mous, faibles et languissants […][4] » Il est donc évident que la bonne chère, combinée à l’inactivité, est source d’amollissement, mais qu’elle a aussi une classe sociale : « La plupart des médecins qui consultaient M. Tronchin, étaient des gens riches, perdus par la mollesse, l’oisiveté et la bonne chère ; l’exercice et la diète, voilà quelle devait être leur médecine, aussi M. Tronchin eut-il les succès les plus brillants[5]. » Ce que fait ici Tissot, par sa démarche, c’est la preuve par l’évidence. Il n’y aurait donc plus de raisons de douter du bien-fondé de ce qu’il dit, car « autant il est ordinaire de voir les gens oisifs et paresseux être valutidinaires et languissants, autant il est rare de voir ceux qui sont accoutumés au travail devenir malades, à moins qu’ils ne s’y livrent trop[6]. »
S’il y a un point commun qui ressort, depuis Locke et Fleury au siècle précédent, c’est bien la volonté de se passer de la médecine autant que faire se peut : « On voit que dans bien des cas, la bonne médecine n’est pas tant l’art de faire des remèdes, que celui d’apprendre à s’en passer[7]. » Il y a là une constante qui perdurera jusqu’à notre siècle. À l’inverse du phénomène de médicalisation de l’existence du XXIe siècle, il y a tout ce discours anti-obésité qui mise justement sur le fait de se passer de la médecine, et qui recommande, pour ce faire, d’adopter un mode de vie sain, de faire de l’exercice trente minutes par jour et de consommer quotidiennement cinq portions de fruits et de légumes. S’il y a un contre-exemple à la médicalisation de l’existence, c’est bien celui-ci, et Tissot en rend bien compte : « Le mouvement peut souvent tenir lieu de remèdes, et tous les remèdes du monde ne peuvent pas tenir lieu du mouvement. » Autrement dit, le discours de la lutte contre l’obésité du début du XXIe siècle, en porte-à-faux avec l’industrie pharmaceutique, suggère le retour à des pratiques dites naturelles. Autre point à considérer concernant l’exercice, et qui n’est pas à négliger, est celui de faire de l’exercice par obligation ou par plaisir. Et ce qu’il y a d’intéressant avec Tissot, c’est que le phénomène était déjà relevé : « L’exercice est un travail ou un amusement. […] Mais on se livre volontairement à l’exercice, quand il est amusement, au lieu qu’on s’y porte avec peine, lorsqu’il nous offre l’image du travail. » De là, tous les appareils ou exercices qui seront inventés pour que l’individu puisse s’exercer tout en y prenant plaisir, de là aussi les vélos stationnaires dans les centres de remise en forme qui font face à des écrans de télé, de là les pédagogies imaginées aux États-Unis pour inciter les adolescents obèses à faire de l’exercice à l’école et en dehors de l’école.
Ce que Tissot renvoie en écho à notre époque, c’est que la science a joué un rôle déterminant dans le développement de l’éducation physique et du sport. Il est aujourd’hui impensable d’imaginer la pratique d’un sport quelconque sans l’appel à une multitude d’experts et de spécialistes. Même le simple adepte du jogging a ses magazines et ses sites Internet pour le guider, sans compter qu’il dispose d’une panoplie toujours plus élargie d’appareils électroniques lui permettant de monitorer sa condition. Comme le souligne Jacques Ulmann : « De là, une comptabilité stricte destinée à mesurer les exploits humains par le moyen de la montre et du mètre. De là aussi, de véritables axiomes du sport : l’homme sautera toujours plus haut, courra toujours plus vite. Et lorsque l’entraînement et la technique ne suffiront plus à rendre possibles des performances plus élevées, il n’est pas absurde de compter sur une véritable mutation du corps de l’homme parce que le sport l’y aura préparée[8]. »
A posteriori, c’est bien ce que préfigure le XVIIIe siècle, à savoir la suggestion faite à l’individu de transformer, améliorer, refaçonner et optimiser son corps. Dans un tel contexte, le ventre du XVIIIe siècle, qui marque encore une certaine ascendance sociale, est sur le point de disparaître au profit du corps sans ventre, qui lui, marquera définitivement l’ascendant social. La stigmatisation qui porte sur le très gros est également sur le point de glisser irrémédiablement vers le gros avec le XIXe siècle qui s’annonce. L’exercice et la diète seront ce par quoi sera mesuré l’effort pour rester en santé et avoir un corps de justes proportions. Et les repères sont bien là et bien ancrés : exercice et saine alimentation, d’où l’effort demandé à un individu autonome, maître de son corps et de son destin.
Deux découvertes viennent appuyer cette image du corps dynamique : les différentes applications de l’électricité, avec Jean Jallabert[9], trouvent une voie expérimentale dans le corps et Lavoisier découvre que la respiration est combustion : « respirer ne consiste plus à favoriser la contraction du cœur où à rafraîchir et affiner le sang, comme les médecins et savants l’avaient toujours pensé, mais à entretenir la chaleur animale et, plus largement, la vie par quelque invisible brasier. Une flamme existe, dont l’oxygène serait une des conditions. Une matière comburée existe aussi, comme la cire pour la bougie ou le charbon pour le foyer. La nourriture serait bien cet aliment : une de ses transformations s’explique par cette contribution[10]. » Un certain type de corps socialement attendu vient également appuyer cette image du corps dynamique avec cette « admiration du superbe physique des dieux[11] » si propre à ce XVIIIe siècle qui veut « regagner la vigueur des peuples anciens[12]. »
[1] Crousaz, J.P. (1722), Traité de l’éducation des enfants, Paris : Vaillant et Prévost.
[2] Diderot, D., de Félice, F.B. (1772), Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 3e éd., tome 17, Yverdon, p. 787.
[3] Tissot, C.J. (1780), Gymnastique médicinale et chirurgicale, Paris : Bastien, p. 27.
[4] Idem., p. 25-26.
[5] Idem., p. 13.
[6] Idem., p. 32.
[7] Idem., p. 34.
[8] Ulmann, J. ([1965] 1997), op. cit. p. 47.
[9] Jallabert, J. (1749), op. cit., p. 155.
[10] Vigarello, G. (2010), op. cit., p. 167.
[11] Bloch, J. (1998), « Nature corrompue et santé corporelle : sexualité et éducation en France au XVIIIe siècle », Sexualité, mariage et famille au XVIIIe siècle, sous la direction d’Olga B. Cragg et de Rosena Davison, Québec : Presse de l’Université Laval, p. 333.
[12] Idem., p. 333.
© Pierre Fraser (PhD), sociologue et lingusite, 2015-2025

Le corps énergique du Siècle des Lumières
Lire l’article
Citer cet article
Fraser, P. (2015). « Le corps énergique du XVIIIe siècle ». Une brève histoire du corps – Du corps rejeté au corps augmenté. Éditions Photo|Société, pp. 55-59.
Le Siècle des Lumières s’est avisé que l’homme, doté de qualités données une fois pour toutes en un état d’achèvement, l’homme clos sur lui-même, constitue une vue anthropologique périmée. L’humanité est lancée dans une histoire qui est celle d’un constant dépassement. Elle gagne des connaissances, inaugure des modes de vie. Sous l’influence du transformisme a émergé l’idée que l’espèce humaine n’est pas constante. Elle est apparue, elle disparaîtra sans doute un jour. Ainsi est née tout naturellement cette croyance qu’il n’y a pas de limite à l’effort humain[1]. Et cette croyance, voulant qu’il n’y ait pas de limites à l’effort humain se traduira également dans le corps, et ce, à différents niveaux. En fait, avec le XVIIIe siècle, le corps est définitivement libéré des déterminismes qui le soumettaient comme par les siècles passés. Il interagit avec son environnement, en devient définitivement le maître, dispose désormais d’une force vitale qui est principe, cause de tous les phénomènes qui le maintiendrait en vie. Il s’agit de la thèse vitaliste, « laquelle postule que les phénomènes vivants sont d’un type particulier, non soumis aux lois de la physique, et se développent en fonction de règles qui leur sont propres[2]. » Et cette thèse, en réaction aux progrès de l’analyse scientifique mécaniste du XVIIe siècle, suggère que la vie serait « une sorte de flux spirituel, comparable à celui de la conscience, qu’il serait impossible de ramener à quelque équation de physique que ce soit[3]. » Les porteurs de cette thèse ne sont pas parmi les moindres. Il y a tout d’abord le médecin et chimiste allemand Georg Stahl (1660-1734), père de la théorie du phlogistique et défenseur de l’animisme, qui récuse toutes ces théories mécanistes qui ne tiennent pas compte de la vie, et stipule que l’âme, l’anima, exercerait une influence directe sur la santé. Le médecin écossais John Brown (1735-1788) considère, pour sa part, que la vie résulte avant tout d’une réaction active et perpétuelle de l’individu à son environnement. En France, Théophile de Bordeu (1722-1776) et Paul-Joseph Barthez (1734-1806) supposent que la vie est à mi-chemin entre l’animisme et le mécanisme[4]. Les découvertes du chimiste français Lavoisier (1743-1794) à propos de la combustion, non seulement relèguent la théorie du phlogistique au rang de fausse théorie, mais changent complètement la donne du corps : la respiration est combustion, le processus de digestion serait aussi combustion.
La médecine fait d’importantes avancées. C’est l’arrivée de la physiologie de l’anatomie pathologique et de l’autopsie avec Friedrich Hoffman (1660-1742) et Giovanni Battista Moragagni (1682-1771). Pour la première fois, les médecins « parviennent à dresser des diagnostics cohérents fondés sur des classes de symptômes[5]. » C’est aussi la possibilité de traiter les anévrismes, d’écouter le corps et ses bruits, pour identifier une lésion pulmonaire, pleurale ou cardiaque, même d’opérer une cataracte. L’étude systématique des muscles, par Bernardo Ramazzini (1633-1714), fonde l’ergonomie, lie certaines maladies et problèmes musculo-squelettiques à des emplois bien précis. Jean-Baptiste Sénac (1693-1770), pour sa part, dresse une édifiante synthèse des cardiopathies, alors que Pierre Fauchard (1678-1761) introduit la médecine dentaire. Tout le XVIIIe siècle est non seulement une montée en puissance de la science positive à propos du corps, mais se veut aussi celui de l’électricité et de la fibre nerveuse. Le scientifique suisse Jean Jallabert[6] (1712-1768), en 1748, guérit le bras paralysé d’un serrurier de 52 ans à l’aide d’un générateur d’électricité statique. L’électricité devient dès lors modèle de puissance corporelle, d’où l’idée que l’électrisation du corps renforcerait la santé, d’où la référence à une nouvelle architecture intime du corps où la fibre devient l’unité anatomique minimale du corps, transformation d’une image de la santé où les maladies du corps seraient plutôt de l’ordre d’une quelconque faiblesse. Il y a aussi cette idée que le corps peut s’autoréguler et s’autoréparer. En somme, le corps n’est plus tout à fait cet instrument passif du XVIIe siècle, il est désormais actif, même dans ces mécanismes internes.
Avec toutes ces découvertes scientifiques, avec toutes ces avancées médicales, il ne s’agit donc pas d’un simple changement de degré dans le registre des déterminismes du corps par rapport aux siècles précédents, mais bel et bien d’un changement de registre à l’aune de la grande idée de l’individu autonome et maître de lui-même du Siècle des Lumières. L’homme éclairé peut conduire sa vie. L’homme éclairé est délivré de l’obscurantisme. L’humanité tout entière, voyant clair, libère l’homme des despotes et des tyrans et le rend maître de son destin, chose que Condorcet souligne de façon éloquente lorsqu’il dit : « Ainsi l’on n’osa plus partager les hommes en deux races différentes, dont l’une est destinée à gouverner, l’autre à obéir ; l’une à mentir, l’autre à être trompée : on fut obligé de reconnaître que tous ont un droit égal de s’éclairer sur tous leurs intérêts, de connaître toutes les vérités[7]. » Les Lumières indiquent donc comment l’esprit parvient à l’intelligence des choses, comment l’homme éclairé éclaire les autres : « L’esprit humain, affranchi des liens de son enfance, s’avance vers la vérité d’un pas ferme, de cette terre heureuse où la liberté vient d’allumer le flambeau du génie[8]. » Avec le Siècle des Lumières, il ne s’agit plus seulement de savoir scientifique, mais de savoir au sens large, la connaissance qui libère l’homme, qui lui offre la possibilité de créer une société basée sur la tolérance et la liberté. Les citoyens du XVIIIe siècle profiteront peu des bénéfices de cette science naissante — la vie étant toujours aussi dure —, mais ils auront une vision : celle d’un monde meilleur et la conviction qu’il est possible d’y parvenir.
Le programme du Siècle des Lumières est ambitieux et se résume pourtant simplement : la capacité à poser sans contrainte un regard critique et la capacité à disposer d’une liberté absolue de jugement, d’où la possibilité de se délivrer des préjugés, des superstitions et des illusions. Devenir éclairé, comme le souligne Kant, c’est obéir à l’impératif de Socrate : « Connais-toi toi-même ! ». Devenir éclairé, c’est apprendre à distinguer ce qui peut être effectivement compris de ce qui n’est qu’apparence de savoir : « Se servir de sa raison ne veut rien dire d’autre que se demander soi-même ceci, pour tout ce qu’on doit admettre : puis je bien ériger en principe universel de l’usage de ma raison la raison pour laquelle je l’admets, ou la règle qui résulte de ce que j’admets ? Chacun peut ainsi se mettre lui-même à l’épreuve ; et il verra que cet examen fait aussitôt disparaître superstition et extravagance […][9]. » Pourtant, Kant souligne que l’individu éclairé, une fois libéré des chaînes du passé, n’est pas à l’abri de nouveaux préjugés qui l’enchaîneraient à nouveau, car « un homme extrêmement riche de connaissances [est] le moins éclairé lorsqu’il s’agit d’en user[10]. » En somme, tout tient à ce que l’homme est un être libre, c’est-à-dire ce qu’il se fait lui-même et ce qu’il se fait à lui-même. Il s’agit d’une toute nouvelle position épistémique qui entraînera des répercussions profondes sur toute la société du XVIIIe siècle dont les échos sont encore audibles aujourd’hui à travers toutes les interventions à déployer sur le corps et également à travers tout le mouvement de croissance personnelle et d’autonomisation systématique de l’individu[11].
Ce dans quoi le Siècle des Lumières engage le corps, c’est dans un double mouvement : soumission et libération. Soumission, dans le sens où « tout se passe ici comme si le peuple allait chez le savant comme chez le devin et le magicien, qui sait ce qu’il en est des choses surnaturelles ; en effet, l’ignorant se fait du savant dont il espère quelque chose des représentations volontiers excessives[12]. » Soumission, dans le sens où l’individu consulte son médecin pour décider à sa place de son régime, plutôt que d’en décider lui-même en se donnant la peine de consulter son propre entendement. Soumission, dans le sens où l’individu recherche la santé pour accéder au bonheur en attendant des médecins les moyens d’y parvenir. Libération, dans le sens où le développement, l’entretien, l’alimentation et le soin du corps doivent dépendre totalement et intégralement de la volonté de l’individu et de son entendement. Bref, ce que Kant décrit comme étant son « régime ». Et ce régime, chez Kant, s’appuie sur deux forces, la force mécanique, celle qui est motrice, et la force organique, celle qui est formatrice :
« […] dans une montre, une partie est l’instrument qui fait se mouvoir les autres; mais un rouage n’est pas la cause efficiente qui engendre les autres […] C’est pourquoi, dans une montre, un rouage n’en produit pas un autre et encore moins une montre d’autres montres, en organisant pour cela une autre matière ; elle ne remplace pas d’elle-même les parties dont elle est privée et ne corrige pas les défauts de la première formation à l’aide des autres parties ; si elle est déréglée, elle ne se répare pas non plus d’elle-même, toutes choses qu’on peut attendre de la nature organisée. Un être organisé n’est pas seulement une machine — car celle-ci ne détient qu’une force motrice —, mais il possède une énergie formatrice qu’il communique même aux matières qui ne la possèdent pas, énergie formatrice qui se propage et qu’on ne peut expliquer uniquement que par la puissance motrice. [La nature] s’organise au contraire d’elle-même dans chaque espèce de ses produits organisés[13]. »
Cette longue citation de Kant pose un jalon important dans la vision du corps qu’organise le XVIIIe siècle : celui d’un individu mu par une force motrice intérieure. Il est donc exigé du corps dynamisme, vigueur, réactivité et flexibilité ; c’est le devoir de l’individu autonome.
[1] Ulmann, J. ([1965] 1997), De la gymnastique aux sports modernes. Histoire des doctrines de l’éducation physique, Paris : Vrin, p. 47.
[2] Vignaux, G. (2010), L’aventure du corps, Paris : Pygmalion, p. 123.
[3] Idem.
[4] Raynaud, D. (1998), « La controverse entre organicisme et vitalisme : étude de sociologie des sciences », Revue française de sociologie, vol. 39, n° 4, p. 721-750.
[5] Vignaux, G. (2010), op. cit., p. 135.
[6] Jallabert, J. (1749), Expériences sur l’électricité avec quelques conjectures sur la cause et les effets, Paris : Durand et Pissot, p. 155.
[7] Condorcet (1864), Tableau historique des progrès de l’esprit humain, tome 1, Paris: Dubuisson et Cie, p. 187.
[8] Idem. p. 180.
[9] Kant, E. (1786), Qu’est-ce que s’orienter dans la pensée ?, « Mensuel Berlinois ».
[10] Kant, E. (1786), op. cit.
[11] Ehrenberg, A. (2012), La société du malaise, Paris : Odile Jacob.
[12] Kant, E. (1797), Le conflit des Facultés, tome 3.
[13] Kant, E. (1993), Critique du jugement, Paris : Vrin, p. 181-182.
© Pierre Fraser (PhD), sociologue et lingusite, 2015-2025
XVIIe siècle

L’arrivée de la gastronomie au XVIIe siècle
Lire l’article
Citer cet article
Fraser, P. (2025), « L’arrivée de la gastronomie au XVIIe siècle ». Une brève histoire du corps – Du corps rejeté au corps augmenté. Éditions Photo|Société, pp. 49-54.
Le médecin londonien Martin Lister (1638-1712), après avoir visité Paris, écrira : « Ce dont je suis sûr, c’est que l’air et la constitution des Parisiens, hommes et femmes, sont étrangement modifiés. De minces et maigres, ils sont devenus gras et corpulents, les femmes surtout, et on ne doit, à mon avis, l’attribuer à rien d’autre qu’à l’usage des liqueurs fortes. Ajoutez à ces boissons l’emploi journalier de café, du thé, du chocolat, qui sont aussi répandus dans les maisons particulières de Paris qu’à Londres : toutes ces liqueurs sucrées engraissent beaucoup[1]. » Dans cette observation faite par Lister, il est possible de dégager deux constats : l’apparence du corps de la femme est particulièrement visée, parce qu’elle s’adonnerait à une pratique alimentaire douteuse et un lien est clairement établi entre le sucre et la prise de poids[2]. Deux événements contribueront donc à accentuer les interventions pour réguler le corps obèse au XVIIe siècle : l’arrivée massive du sucre et l’idée même d’éducation que se propose d’une manière générale le XVIIe siècle.
Même s’il ne faut pas diminuer l’importance du coton, du cacao et de plusieurs autres produits alimentaires dans la balance de l’échange commercial de l’époque, il n’en reste pas moins que les grandes affaires du XVIIe siècle sont d’abord et avant tout le sucre et le café[3]. En fait, l’arrivée massive en Europe du sucre brésilien et du sucre antillais fait systématiquement chuter les prix, instaurant dès lors une nouvelle dynamique alimentaire. En Grande-Bretagne, les classes populaires anglaises commencent à consommer de plus en plus de sucre brun et de mélasse. De 1660 à 1700, la consommation de sucre quadruple, triple entre 1700 et 1740, gagne le reste de l’Europe et augmente même plus vite que celle du pain[4]. Les deux plus grands importateurs, la France et la Grande-Bretagne, redistribuent le sucre antillais jusqu’au Moyen-Orient. Son entrée inédite dans les régimes alimentaires bouleversera les pratiques de commensalité et introduira des aliments inédits jusqu’alors tels les mousses, gâteaux, confitures, compotes, gelées, marmelades. Il se retrouvera également dans les plats de céréales, ainsi que dans les préparations à base d’œufs et de laitage et fera même également son chemin jusque dans le café.
Tout comme au XVIe siècle, la cuisine du XVIIe siècle se décline en trois temps : une pour l’aristocratie, très abondante et très diversifiée ; une pour la bourgeoisie, qui se rapproche de plus en plus de celle de l’aristocratie, de plus en plus abondante et de plus en plus diversifiée ; une pour le peuple, quasi semblable à celle du siècle précédent, c’est-à-dire, peu abondante et peu diversifiée. Le XVIIe siècle voit l’introduction de la gastronomie dans les grandes cours d’Europe. À l’image du roi Soleil, Louis XIV, la cuisine est somptueuse, raffinée, diversifiée. Elle se structure, définit des manières d’être et des attitudes, impose des règles de conduite et de maintien. Elle est à l’origine du déclin graduel des épices au profit des fines herbes aromatiques et de l’arrivée des ragoûts et des sauces, de l’apparition des jus et des confits, et de l’essor des légumes et de la diététique. Les cuisiniers édulcorent de moins en moins les viandes et les poissons, réservent désormais le sucre pour les desserts. Les sauces maigres sont supplantées, soit par des sauces émulsionnées, soit par des sauces grasses et onctueuses.
Mais ce qui marque le plus cette nouvelle cuisine, c’est sans doute le recours systématique aux légumes, y compris les légumes racine jusque-là méprisés par l’aristocratie, d’où l’essor des grandes cultures maraîchères. La cause première de tous ces changements en matière d’alimentation relèverait d’une simple question de statut social : l’aristocratie cherche avant tout à se démarquer concrètement des modes de consommation populaires et bourgeois : « Condamner les pratiques traditionnelles, c’est prendre à contre-pied les parvenus au moment où ils croient s’égaler par leur faste aux gentilshommes de vieille souche qu’ils essayent d’imiter[5]. » Paradoxalement, c’est aussi la raison pour laquelle « les élites aristocratiques se tournent de plus en plus souvent vers les grosses viandes de boucherie, sous l’influence de la cuisine bourgeoise traditionnelle, parce que les bourgeois eux-mêmes se sont mis à imiter la cuisine aristocratique et que le seul moyen qu’elles ont de se singulariser est d’adopter les procédés qu’ils ont abandonnés partiellement[6]. »
Avec le XVIIe siècle, au « manger beaucoup » succède le « bien manger » qui se confond aussi avec la modération. Il y a ici une idée qui aura un écho jusque dans les pratiques alimentaires du XXIe siècle sous la gouverne des nutritionnistes, car au fur et à mesure que « la viande devient accessible au grand nombre, de même que les épices, les classes distinguées les délaissent pour le « manger peu », les végétaux, le primat du goût. La différenciation sociale qui reposait d’abord sur une différence de quantité évolue vers une différence concernant les produits eux-mêmes[7]. » Et cette volonté de se démarquer englobe autant les façons d’accommoder les aliments que celle de les consommer, y compris les heures de repas pour se différencier de la bourgeoisie : « Il en résulte un changement dans la frontière sociale, qui passe dès lors entre les élites nobles et bourgeoises mangeuses de bons morceaux de toutes origines, gibier ou élevage, et le peuple auquel sont laissés les bas morceaux, […] tandis que seul le jambon reste consommé par les élites : la viande de porc est devenue, définitivement, un produit destiné au seul peuple[8]. »
Avec des moyens financiers de plus en plus accrus, la bourgeoisie se met à imiter la cuisine de l’élite. Comme le met si bien en scène Molière dans le Bourgeois gentilhomme (1670), monsieur Jourdain témoigne en effet de l’affirmation de la bourgeoisie de s’approprier les manières, les attitudes et les comportements de l’aristocratie. En 1691, pour répondre à ces nouvelles attentes, le grand chef François Massaliot (1660-1733) publie son célèbre ouvrage intitulé Cuisinier royal et bourgeois et rencontre un vif succès auprès de la bourgeoisie montante qui s’empare alors de la grande cuisine autrefois réservée à l’aristocratie, et qui, dans le même souffle, adopte de nouvelles manières de table : le couteau à usage individuel à bout rond, la fourchette, la cuillère, la serviette. La bourgeoisie n’est plus, comme au siècle précédent, confrontée à une certaine frugalité. Son ordinaire s’est modifié et la viande est de plus en plus en présente sur la table, tout comme la volaille, le beurre et le vin. À l’inverse, l’alimentation du peuple est toujours confinée à une alimentation céréalière et de pain composée de blé, de seigle et de froment (pain bis). Il y a également cette eau bouillie composée d’herbes et de racines, de carottes, de navets, de poireaux, d’épinards, de panais, d’oignons, de choux et de légumineuses qui compose l’ordinaire du quotidien. La viande est plus souvent qu’absente des repas, sauf les jours de fête.
Il faut peut-être envisager que, dans le contexte d’une cuisine du XVIIe siècle si nettement définie, la prise de poids est avant tout affaire de classe sociale. Conséquemment, ce sont le noble, l’aristocrate et le bourgeois qui deviennent la cible des médecins. L’idée est structurante, car les régimes sont plus souvent évoqués, cités, présents dans les lettres, les rituels, les récits « avec leurs recours très simples aux moindres quantités nutritives ou aux matières desséchantes, toutes censées limiter une grosseur dont le principe premier demeure l’humidité.[9] »
Les recommandations des médecins, encore en phase avec la théorie des humeurs héritée du Moyen-Âge, tenteront de traiter la diversité des tempéraments comme des maladies. Alors que la diététique du Moyen-Âge et de la Renaissance était plutôt conservative des tempéraments individuels — parce que manger était une opération non modificatrice des humeurs qui assurait une santé continue —, la diététique du XVIIe siècle devient corrective et normative. Et en se référant à l’idée voulant que la santé véritable soit fondée sur un équilibre parfait des humeurs, les médecins suggéreront que chacun doit manger ce qui corrige son humeur dominante pour atteindre cet équilibre :
« Selon ce système, les viandes et boissons, qui sont de qualité humide et chaude, sont propres à ceux qui sont d’humeur mélancolique ; celles qui sont froides et humides aux colériques [ou bilieux] ; les chaudes et sèches aux phlegmatiques ; et celle de bon suc et médiocre nutriment aux sanguins[10]. » Comme le souligne l’historien Georges Vigarello : « l’origine de la graisse demeure bien celle des liquides et les qualités du corps tiennent bien à celle des humeurs. […] L’horizon du liquide et du sec, avec ses équilibres, ses désordres, ses débordements, demeure bien l’horizon du sain et malsain, du digeste et de l’indigeste, du mince et du gros[11].»
Avec le XVIIe siècle, l’aversion envers le corps en excès de graisse prend définitivement source avec le passage du statut d’être un corps à celui d’avoir un corps dont l’individu est personnellement et socialement responsable, c’est-à-dire le corps devenu support des relations sociales et porteur d’identités. Le fait d’être en surpoids ou obèse traduirait par conséquent ce manque de contrôle et de volonté face à cette nouvelle responsabilité d’avoir un corps. Le corps en excès de graisse devient cible de stigmatisation. Les mots et les images sont là pour en témoigner, puisque l’iconographie et la littérature du XVIIe siècle font du très gros un individu paresseux, mou, indolent, fainéant, oisif, profiteur, abuseur. Et c’est bien de cette crainte de l’amollissement que provient la modernité corporelle, celle qui subsumera toutes les interventions à venir sur le corps au cours des siècles qui suivront.
© Pierre Fraser (PhD), sociologue et linguiste
[1] Société des bibliophiles français (1883), Voyage de Lister à Paris, Paris : Lahure, p. 151-152.
[2] Déjà, à cette époque, le coupable était identifié, ce que confirmera plus tard avec succès la science du XXe siècle.
[3] Brulez, W. (1968), « Le commerce international des Pays-Bas au XVIe siècle : Essai d’appréciation quantitative », Revue belge de philologie et d’histoire, tome 46, fasc. 4., p. 1205-1221.
[4] Muchembled, R. (1994), Le XVIIIe siècle, 1715-1815, Paris : Bréal, Annexe commenté.
[5] Garnot, B. (1995), La culture matérielle en France aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, Paris : Ophrys, p. 44.
[6] Idem, p. 45.
[7] Mathé, T., Pilorin T., Hébel, P. (2008), « Du discours nutritionnel aux représentations de l’alimentation », Cahier de recherche, n° 252, dirigé par Pascale Hébel, p. 16.
[8] Garnot, B. (1995), op. cit., p .46
[9] Vigarello, G. (2010), op. cit., p. 103.
[10] Garnot, B. (1995), op. cit. p. 43.
[11] Vigarello, G. (2010), op. cit., p. 113-114.

Le corps stratifié et violenté
Lire l’article
Citer cet article
Fraser, P. (2015). « Le corps stratifié et volonté ». Une brève histoire du corps – Du corps rejeté au corps augmenté. Éditions Photo|Société, pp. 45-49.
Dans un siècle de remises en question systématiques de l’ordre établi, dans un siècle empêtré dans des guerres de religion qui n’en finissent plus, à l’aune de grandes découvertes scientifiques et géographiques, pour la première fois, la souffrance du corps est explicitement montrée dans la peinture et décrite dans la littérature. Ce renversement de position est majeur par rapport au corps glorifié de la Renaissance. Le XVIIe siècle est aussi une autre ontologie de la mort du corps, sous-jacente à la science moderne, où considérer la vie comme un problème c’est reconnaître son étrangeté dans le monde mécanique qu’est l’univers : l’expliquer c’est la nier en en faisant l’une des variantes possibles du sans vie. Claude Bernard ne suggérera-t-il pas, deux siècles plus tard, que la vie est ni plus ni moins qu’un ensemble de fonctions qui « résistent à la mort » ?
Le XVIIe siècle impose un renversement du problème de la vie. Si la vie foisonne partout, pourquoi surgit la mort du corps ? Il y a là une contradiction d’importance, un problème à résoudre dont la Renaissance avait posé les fondements. Comment le corps peut-il vivre si seule la mort existe ? Comment le corps peut-il vivre si seule la réalité matérielle se manifeste ? C’est le paradoxe du corps du XVIIe siècle défini par Descartes : le corps ne devient intelligible qu’à l’état de cadavre, le vivant se révèle seulement qu’à travers le corps décédé, car il s’aligne dès lors sur la matière, exposant sa mécanique interne. Et comme le remarque Canguilhem : « L’homme ne peut se rendre maître et possesseur de la nature que s’il nie toute finalité naturelle et s’il peut tenir toute la nature, y compris la nature apparemment animée, hors de lui-même, pour un moyen[1]. » Il s’agit bien là du programme scientifique du XVIIe siècle.
En écho à cette science du corps et à sa mort inéluctable, une grande partie de la production artistique du XVIIe siècle est peuplée de corps souffrants et macabres, tout comme de corps en miettes, coupés, découpés, disséqués, suppliciés, éventrés, martyrisés, auto-flagellés, parfois lacérés. La souffrance s’exprime autant dans le corps sanglant, que dans celui exposé à la pourriture, que dans celui exposé par la dissection. Cette représentation du corps est à l’image même de la violence quotidienne qui lui est faite dans cette Europe travaillée par différentes représentations d’ordre religieux, médical et politique. Dans cette représentation iconographique du corps, ce n’est pas « le dégoût ou l’horreur que recherchent avant tout les auteurs, peintres ou artistes-collectionneurs, [mais à] davantage ordonner et charger de sens ce qui pourrait sembler absurde et inacceptable : la souffrance humaine et la mort. Le corps souffrant dans toute sa violence, parce qu’il est figuré, devient vecteur de l’expression des sentiments les plus intimes[2]. » Le corps ainsi représenté permettrait « de sublimer la souffrance et l’horreur, en faisant du lecteur un acteur et un voyeur[3]. » Le corps souffrant est donc aussi corps social.
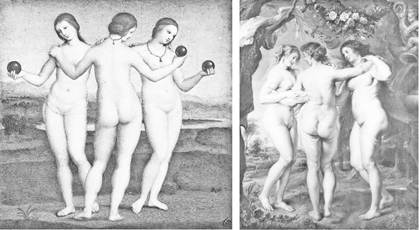
Les trois grâces : Raphaël. Les trois grâces : Rubens.
Le peintre Pierre-Paul Rubens (1577-1640) participe activement à cette violence faite au corps en grossissant les volumes, en déformant les chairs, les têtes et les cous, en boursouflant les ventres et les membres dans un effondrement systématique des chairs. Sa propre version des Trois Grâces déchues, par rapport à celle de Raphaël au siècle précédent, est une claire indication de vouloir montrer ce débordement de chairs en expansion sous l’effet d’une masse adipeuse croissante. Dans l’une de ces lettres, Rubens dira à son interlocuteur à propos de cet envahissement adipeux : « La principale raison pourquoi les corps humains de notre temps sont différents de ceux de l’antiquité, c’est la paresse, l’oisiveté et le peu d’exercice que l’on fait. Car la plupart des hommes n’exercent leur corps qu’à boire et à faire bonne chère. Ne vous étonnez donc pas, si, amassant graisse sur graisse, on a un ventre gros et chargé, des jambes molles et énervées, et des bras qui se reprochent à eux-mêmes leur oisiveté[4]. » Considéré sous cet angle, le gros est victime de sa paresse et de son insatiable gourmandise[5]. Il est objet de curiosité avec sa graisse paralysante qui infiltre le corps dans ses moindres interstices, craquelant les chairs.
À l’inverse du corps magnifié et glorifié du XVIe siècle, le XVIIe siècle met en scène un corps dans ce qu’il a de plus ordinaire, « fait d’humeurs et de graisse, sécrétant odeurs et suintements, aux fonctions organiques inavouables[6]. » C’est le corps ramené à son plus petit dénominateur commun. C’est le corps grossier qui « étale sa matérialité physique où l’embonpoint érotique devient obésité répugnante[7]. » Paradoxalement, à l’inverse de ce corps grossier, avec Rubens, ce sont trois siècles d’art et d’excès de graisse qui se profilent. De Jacob Jordaens (1593-1678) à Pierre-Auguste Renoir (1841-1919), « déités plantureuses, cupidons à fossettes, voire martyres potelées ou saintes mamelues[8] » peupleront la peinture où les « formes rebondies, à l’égal des nuées qui ravissaient les béates jusqu’aux parvis [les accueillent par] des rondes de chérubins dodus[9]. »
La représentation iconographique des rois et des puissants se distingue également de celle de la Renaissance. Il ne s’agit plus de montrer le roi ou le noble vêtu de son armure, chevauchant sa monture, pourfendant l’ennemi ou s’adonnant à la pratique de la chasse, mais bien plutôt de mettre en valeur de nouvelles représentations du corps à travers ses apparences : « attitude moins massive, par exemple, travaillée par l’élégance, le maintien. Il s’agit, plus profondément encore, d’un renouvellement des valeurs données à l’excellence physique […]. Un ensemble de références […] centrées davantage sur le raffinement de la pose et des vêtements que sur l’expression physique de la force[10]. » Alors que Rubens déforme volontairement le corps, se moque délibérément du corps en excès de graisse du bourgeois, alors qu’ailleurs le corps est montré dans sa souffrance sous différentes facettes mille fois reproduites, celui des élites et des nobles suggère, a contrario, la minceur, la retenue, la découpe, l’élégance et le raffinement. Avec ces trois types d’iconographie, l’art renvoie à la population l’image d’un corps socialement stratifié : le corps souffrant du peuple, le corps boursouflé des bourgeois trop bien nourris, le corps civilisé, cultivé, raffiné et élégant de l’élite.
[1] Canguilhem, G. (1989), Études d’histoire et de philosophie des sciences, Paris : Vrin.
[2] Herman de Franceschi, S. (2012), Comptes rendus, Dix-septième siècle, vol. 2, n° 255, p. 371-378.
[3] Bien, C. (2010), « Comment ne pas céder au plaisir de voir la souffrance, et de souffrir soi-même ? », Corps sanglants, souffrants et macabres. La représentation de la violence faite au corps en Europe, XVIe et XVIIe siècles, sous la direction de Charlotte Bouteille-Meister et Kjerstin Aukrust, Paris : Presses Sorbonne nouvelle, p. 256.
[4] Gachet, E. (1840), « Lettre inédites de Pierre-Paul Rubens », trad. par René de Piles du fragment latin sur l’Antique, Cours de peinture par principes, p. 127, in-12, 1766, Bruxelles : Hayez, p. lxxxi.
[5] Difficile, une fois de plus, de ne pas se référer à la téléréalité américaine The Biggest Loser où les entraîneurs démontrent par «A+B» aux participants le résultat de leur paresse et de leur insatiable gourmandise en les affichant sur une pesée pour le plus grand plaisir de millions de téléspectateurs ; aujourd’hui, la paresse et la gourmandise se mesurent objectivement.
[6] Laneyrie-Dragen, N. (2008), L’invention du corps, Paris : Flammarion, p. 162.
[7] Arasse, D. (2005), op. cit., p. 476.
[8] Sendrail, M. (1967), op. cit., p. 109.
[9] Idem., p. 111.
[10] Vigarello, G. (2005), op. cit., p. 248.
© Pierre Fraser (PhD), sociologue et lingusite, 2015-2025

Épuration collective et personnelle
Lire l’article
Citer cet article
Fraser, P. (2015). « Épuration collective et personnelle ». Une brève histoire du corps – Du corps rejeté au corps augmenté. Éditions Photo|Société, pp. 44-45.
Le XVIIe siècle a également ceci de particulier, qu’il convie chaque individu à un vaste travail d’épuration personnelle par l’évacuation : « non plus seulement la purge ou la saignée, mais la transpiration, l’expectoration, le vomissement[1]. » Le cardinal Richelieu, selon le témoignage de l’ambassadeur vénitien Angelo Correr, est saigné plusieurs fois par mois, tout comme Louis XIII que son chirurgien incise 47 fois par année, tout comme Louis XIV qui, en plus des saignées, se voit prescrire une batterie de lavements et de purgations[2]. Madame de Sévigné, en 1675, rapporte que les enfants sont désormais saignés à partir de l’âge de trois ans s’ils ont une fièvre[3]. Dès lors, l’évacuation et la purgation des élites deviennent modèles de pratiques.
Le XVIIe siècle convie également l’ensemble de la société à un vaste travail d’épuration collective par l’évacuation. La purge, comme métaphore, traverse l’ensemble de la société. À ce titre, la peste n’est plus seulement le fait d’une quelconque puissance obscure, mais bel et bien de l’environnement immédiat, « colportée par les soldats, les vagabonds, les groupes errants ; une menace qui circule comme une chose et qui s’infiltre comme un venin[4]. » Le corps des autres devient vecteur d’incertitudes, de menaces et de peurs, d’où exclusion, évacuation, épuration, d’où l’introduction d’une nouvelle idée qui redéfinira systématiquement la vision du corps : le corps doit être épuré pour le plus grand bien du collectif. L’évacuation devient modèle de pensée socialement transposée : le pauvre, le pestiféré, le malade, le soldat estropié, la prostituée mutilée, ceux qui appartiennent aux marges de la société, sont à déplacer, à évacuer du corps social. En excluant et en refoulant tout ce qui est susceptible de contaminer et de souiller le corps du groupe, l’évacuation permettrait de gérer efficacement l’ordre social. Déjà, au XVIe siècle, Léonard de Vinci avait imaginé, à l’aide d’écluses, de vannes et de moulins, un tout-à-l’égout souterrain calqué sur le modèle du corps permettant d’évacuer les rebuts, déchets et immondices de la ville.
[1] Vigarello, G. (1999), Histoire des pratiques de santé — Le sain et le malsain depuis le Moyen-Âge, Paris : Seuil, coll. Points, p. 99.
[2] Idem., p. 95.
[3] Idem., p. 96.
[4] Idem., p. 109.
© Pierre Fraser (PhD), sociologue et lingusite, 2015-2025

Un corps maléable : corsets et appareils correcteurs en tous genres
Lire l’article
Citer cet article
Fraser, P. (2015). « Un corps maléable : corsets et appareils correcteurs de tous genres ». Une brève histoire du corps – Du corps rejeté au corps augmenté. Éditions Photo|Société, pp. 49-54.
Dans la foulée d’une science positive et triomphante qui se met en place, une grande partie du XVIIe siècle est traversée par cette prétention de vouloir diriger la nature, de s’en rendre maître. Cette prétention se traduira jusque dans le corps, où corsets et appareils correcteurs de tous genres prétendront le reformer et le refaçonner pour le conformer à une certaine vision propre à ce siècle, celle de la rectitude, norme esthétique et socialement distinctive.
Le corps de l’enfant, considéré fragile et malléable, est à l’image d’une « pâte tendre qu’il faut pétrir par des gestes précis en la façonnant à l’aide de moules correcteurs[1]. » Il y a donc cette idée d’un corps passif sur lequel il faut agir par des moyens externes au corps. Le muscle n’est pas encore pressenti comme cet outil de travail précis et ciblé qui brûle les calories, qui redessine le corps. Il y a, en somme, cette volonté de vouloir agir par l’extérieur sur l’intérieur du corps. Ce moulage du corps est donc obtenu « par l’adjonction des forces passives du maillot et du corps à baleines, les tuteurs de la tige de la tendre enfance qu’il faut redresser. […] Pour ces raisons, l’utilisation du corset rigide se généralise au XVIIe siècle dans les familles dominantes et, à la fin du siècle, le corps à baleines devient un élément commun du costume destiné aux plus jeunes enfants[2]. » John Locke s’opposera à toutes ces pratiques vestimentaires :
« Laissons à la nature le soin de former le corps comme elle croit mieux le faire. Elle travaille spontanément beaucoup mieux, avec beaucoup plus d’art, que nous pourrions faire nous-mêmes si nous prétendions la diriger. […] Les moyens employés pour donner aux enfants une taille fine et svelte ont précisément pour résultat de la leur gâter. […] Ils devraient craindre de détourner la nature de ses voies, en essayant de façonner eux-mêmes les membres et les organes, alors qu’ils ne savent seulement pas comment est faite la plus petite, la plus simple partie du corps. Et cependant j’ai vu en si grand nombre des exemples d’enfants auxquels on avait fait beaucoup de mal pour les avoir trop serrés dans leurs vêtements […][3] »
Deux visions d’action sur le corps s’affrontent à la fin du XVIIe siècle : passive et active. Passive, dans le sens où il faut agir sur le corps par des moyens correcteurs pour socialement le façonner. Active, dans le sens où il y a cette forte intuition que l’usage des corsets et des vêtements qui compriment le corps conduisent à « une poitrine étroite, une respiration trop courte, une mauvaise haleine, des poumons malades, un corps voûté. » La vision active l’emportera au cours du Siècle des Lumières et sera scientifiquement confirmée par Lavoisier au XIXe siècle par l’idée de combustion interne. Ce changement de vision, de passive à active, contribuera à ce repositionnement de perspective envers le corps. Il est dorénavant possible d’agir de l’intérieur de celui-ci pour le transformer et non plus seulement de l’extérieur. Le corps idéal imaginé au XVIe siècle commence à se dessiner et préfigure de la corporéité contemporaine. Le très gros et le gros seront confrontés à cette nouvelle perspective : ils devront désormais activement agir sur eux-mêmes et non plus être passifs.
[1] Allard, J. (2007), « Perceptions nouvelles du corps et raisons médicales de la mode dans la seconde moitié du XVIIIe siècle », Représentations du corps sous l’Ancien Régime: discours et pratiques, Textes rassemblés et édités par Isabelle Billaud et Marie-Catherine Laperrière, n° 2, p. 16.
[2] Idem.
[3] Locke, J. ([1693] 1882), op. cit. p. 16.
© Pierre Fraser (PhD), sociologue et lingusite, 2015-2025

La montée de l’éducation physique
Lire l’article
Citer cet article
Fraser, P. (2015). « La montée de l’éducation physique au XVIIe siècle ». Une brève histoire du corps – Du corps rejeté au corps augmenté. Éditions Photo|Société, pp. 37-42.
Le XVIIe siècle fait du vers de Juvénal, « Un esprit sain dans un corps sain », un véritable projet de société. Il y a cette conviction que le bonheur de l’homme se trouve dans l’harmonie du corps et de l’esprit. L’éducation prend une place qu’elle n’avait pas encore jusqu’à ce jour. Elle est érigée en préoccupation sociale de premier rang : « Tenir la jeunesse c’est tenir l’avenir ». Il y a l’apparition d’un souci croissant concernant l’éducation des enfants. Il y aussi cette idée que l’éducation est nécessaire pour tous. Par manque de moyens et de structures, l’initiative de l’éducation est « laissée au clergé et c’est donc à travers ce dernier que se développent à la fois les écrits pédagogiques et les institutions scolaires. Or, à ces deux niveaux, on peut constater l’apparition d’un souci nouveau et véritablement original : celui d’une généralisation de l’enseignement[1]. »
Dans les deux dernières décennies du XVIIe siècle, plusieurs écoles élémentaires verront le jour en Angleterre, en France et en Allemagne. Elles seront rapidement suivies, tout d’abord en Prusse, et par la suite dans d’autres pays, par des écoles d’exercice nommées « gymnase »[2]. Trois ouvrages résumeront, vers la fin du XVIIe siècle, ce que toute une époque avait concocté en matière d’éducation : le Traité du Choix et de la Méthode des Études[3] (1686) de l’abbé Claude Fleury (1640-1723) ; le Quelques pensées sur l’éducation[4](1693) de John Locke (1632-1704) ; le De motu animalium (À propos du mouvement animal) (1680) du mathématicien, médecin et physiologiste italien Johanni Alphonsi Borelli (1608-1679), qui rationalisera l’activité des moindres muscles du corps. Ces trois livres sont porteurs d’une vision qui orientera pour les générations à venir la représentation du corps. Mais avant tout, ce qui surprend de prime abord, c’est l’unicité du discours que tiennent Fleury et Locke, une unicité essentiellement fédérée sous quatre oppositions : le corps versus l’âme ; la santé naturellement donnée versus la santé acquise ; la modération versus l’excès ; la mollesse versus la vigueur.
D’entrée de jeu, à la section Qu’il faut avoir soin du corps, Fleury commence tout d’abord par dire que, après « notre âme il n’y a rien qui nous doive être aussi précieux, que cette autre partie de nous-mêmes : et que l’union étroite de l’une et de l’autre, fait que l’âme n’est point en état de bien agir, si le corps n’est bien disposé[5]. » L’assise est donc posée : un esprit sain dans un corps sain. Il souligne par la suite que la santé du corps n’est pas donnée, mais qu’elle s’acquiert : « On connaît assez les biens du corps, la santé, la force, l’adresse et la beauté : mais on croit qu’il faut que la nature nous les donne[6]. » Et cette santé, comme il le remarque, ne peut être acquise que par l’exercice, « cet art que les Grecs nommaient la gymnastique[7] », et que tout homme de bonne condition devrait pratiquer dans une certaine mesure. L’excès est aussi dénoncé : « ce qui fortifie n’est pas, comme croit le vulgaire, manger beaucoup, et boire beaucoup de vin, mais travailler et s’exercer en se nourrissant et se reposant à proportion[8]. » C’est donc avant tout de modération dont a besoin le corps pour être solide, robuste et en santé. Et pour y parvenir, Fleury suggère des exercices somme toute fort simples : « marcher longtemps, se tenir longtemps debout, porter des fardeaux, tirer des poulies, courir, sauter, nager, monter à cheval, faire des armes, jouer à la paume, et ainsi du reste, selon les âges, les conditions, et les proportions auxquelles chacun se destine[9]. »
Fleury dira que les enfants doivent avoir « de bonne heure une grande estime[10] » pour les exercices et un « grand mépris de la vie molle et efféminée[11]. » Le XVIIe siècle a donc en horreur la mollesse et la paresse, et Fleury le souligne tout particulièrement : « Quand je parle d’avoir de la santé, je ne parle pas de ces précautions de femmes et d’hommes sédentaires, et trop aisés, qui se tâtent le pouls à tous moments : et qui à force de craindre les maladies, sont presque toujours malades, ou du moins s’imaginent l’être : qui prennent des bouillons tous les matins, qui ne peuvent ni jeûner, ni faire maigre, ni manger plus tard qu’une certaine heure ; qui ne peuvent dormir, s’ils ne sont couchés mollement et fort loin du bruit : qui n’ont jamais assez de châssis, de paravents et de contre-portes ; en un mot, qui ont une horreur extrême des incommodités[12]. » Dans cette seule phrase, Fleury illustre la portée même de l’inverse du corps vigoureux tant vanté par le XVIIe siècle, ainsi que des effets négatifs sur le corps d’une vie un peu trop douillette.
À partir des constats de Fleury, il est pertinent de faire un double parallèle avec le XXIe siècle, avec, d’une part, le confort matériel des habitations et des conditions de vie en général, et d’autre part, la préoccupation grandissante, à la limite obsessive, de nos contemporains concernant leur état de santé et que Fleury vilipendait déjà : « Ces gens abusent des soulagements qui ont été inventés pour les vrais malades, et pour ceux dont la santé est ruinée par de longs travaux, ou par une extrême vieillesse : et ce qui marque leur mollesse, c’est qu’ils n’usent jamais des moyens que j’ai marqués, du travail et de l’abstinence ; ils aiment mieux prendre une médecine, que de se priver d’un repas. Il est donc très important de faire comprendre de bonne heure aux jeunes gens, l’erreur de ces prétendus infirmes […][13]. » Fleury ne propose pas seulement un programme pour obtenir et maintenir un corps en santé, mais bien une relation au corps, celle d’une activité du corps qui se décline par la force, l’adresse et la beauté où la mollesse et la paresse n’ont pas lieu d’être, éloignant d’autant le recours à toutes médecines. En un mot, la vie douillette n’est pas l’apanage du XVIIe siècle.
John Locke, pour sa part, avec Quelques pensées sur l’éducation, introduit la notion d’éducation physique : non pas l’éducation physique au sens où elle est actuellement entendue, mais bel et bien comme programme d’éducation du corps dans son ensemble. Il souligne tout particulièrement à quel point il faut acquérir des habitudes qui permettront de mener sans danger une vie rude, à quel point il faut « apprendre aux enfants à dominer leurs appétits, [à quel point] il faut donner à leur esprit aussi bien qu’à leur corps de la force, de la souplesse, de la vigueur en les habituant à être les maîtres de leurs désirs et en aguerrissant leur corps par les privations[14]. » L’enfant, au sortir du collège, sera déjà un homme d’action, tout préparé à tenir sa place dans le monde. Locke ouvre son chapitre intitulé L’Éducation physique comme suit : « Que la santé est nécessaire à nos affaires et notre bonheur, et que pour faire quelque figure dans le monde, nous ne pouvons nous passer d’un tempérament vigoureux qui résiste au travail et à la fatigue : c’est un point évident où la preuve est inutile. […] Un esprit sain dans un corps sain, telle est la brève mais complète définition du bonheur dans ce monde. L’homme qui possède ces deux avantages n’a plus grand-chose à désirer. […] C’est donc par là que je vais commencer, en traitant de la santé du corps[15]. »
Pour Locke, il semble évident que l’éducation physique ait des effets positifs, puisqu’elle permettrait à la fois de fortifier la santé et le tempérament. Tout ce qui concerne le manger, le vêtir, le coucher, en bref, la façon de traiter le corps dans son ensemble, fait partie intégrante de l’éducation physique, sans excepter les épreuves auxquelles on le soumet pour l’endurcir ou le recréer. Pour Locke, l’éducation physique ne prend sa pleine signification qu’à la condition d’être rapportée aux fins mêmes que l’éducation définit au XVIIe siècle où « tout se réduit à un petit nombre de règles faciles à observer ; beaucoup d’air, d’exercice et de sommeil ; un régime simple, pas de vin ni de liqueurs fortes ; peu ou même pas du tout de médecines ; des vêtements qui ne sont trop étroits ni trop chauds ; enfin et surtout l’habitude de tenir la tête et les pieds froids, de baigner souvent les pieds dans l’eau froide et de les exposer à l’humidité[16]. » En ce qui concerne la nourriture, Locke considère qu’elle « doit être commune et fort simple », afin d’apprendre à l’enfant à « s’abstenir de manger plus copieusement et plus fréquemment que la nature l’exige[17] », car plusieurs « sont devenus gloutons et gourmands par habitude[18]. » Surtout, « il ne doit pas y avoir d’heures fixes pour les repas de risque de créer une habitude […]. Le pain sec est la meilleure des nourritures[19] », sans compter qu’il faut aller à la garde-robe[20] (toilette) régulièrement pour purger l’organisme. Locke suggère également qu’« il est plus sage de confier les enfants à la seule conduite de la nature, que de les mettre dans les mains d’un médecin trop disposé à les droguer et à croire que dans les indispositions ordinaires de la diète ou d’un régime qui s’en approche est le meilleur des remèdes[21]. » Ironie historique ici à relever par rapport au XXIe siècle où les enfants diagnostiqués du trouble de déficit de l’attention ou d’autres problèmes comportementaux se voient prescrire différentes médications.
Ce que proposent essentiellement Fleury et Locke, c’est d’engager le corps dans une pratique de modération et de retenue tout en restant le plus loin possible des conseils des médecins. Il faut viser à la fois à un amincissement apparent du contour et à un allégement apparent du corps tout en lui conservant robustesse et endurance. Il faut s’abstenir de manger plus que la nature l’exige de crainte de devenir un glouton, et par conséquent, un gras personnage. Il s’agit définitivement là de propositions qui s’alignent sur le corps laborieux et vigoureux de la Réforme. Mais au-delà des considérations et des recommandations proposées par Fleury et Locke, il y a cette « activité du corps » qui traversera par la suite tout le XVIIIe siècle avec l’activité de la fibre qui anime le corps. Et cette activité du corps, c’est Johanni Alphonsi Borelli (1608-1679) qui l’a décrite, en 1680, dans un ouvrage où il applique aux corps humains et aux animaux les théories physiques et mécaniques de Galilée : « Tous les exercices musculaires, de la marche au saut, en passant par la course et la natation sont mathématisés[22]. » Borelli a non seulement posé les bases d’une gymnastique rationnelle qui prendra par la suite tout son essor au cours des XVIIIe et XIXe siècles, mais a aussi défini la modernité corporelle. L’ouvrage de Borelli n’est donc pas sans conséquence, tout comme ceux de Fleury et Locke.
[1] Jolibert, B. (1981), L’enfance au XVIIe siècle, Paris : Vrin, p. 11.
[2] Londe, C., (1821), « Medical Gymnastics ; or Exercise applied to the Organs of Man, according to the laws of Physiology, of Hygiene, and Therapeutics », American Annals of Education, vol. 1, p. 235.
[3] Fleury, C. (1686), Traité du Choix et de la Méthode des Études, Paris.
[4] Locke, J. ([1693] 1882), Quelques pensées sur l’éducation, trad. de Gabriel Compayré, Paris : Hachette.
[5] Fleury, C. (1686), op. cit., p. 154.
[6] Idem., p. 154.
[7] Idem., p. 154.
[8] Idem., p. 155.
[9] Idem., p. 157.
[10] Idem., p. 158.
[11] Idem., p. 158.
[12] Idem., p. 162.
[13] Idem., p. 163.
[14] Locke, J. ([1693] 1882), op. cit., p. 159.
[15] Idem., p. 1.
[16] Idem., p. 37.
[17] Idem. p. 19.
[18] Idem. p. 19.
[19] Idem. p. 21.
[20] Idem. p. 33.
[21] Idem. p. 36.
[22] Gleyse, J. (2007), op. cit., p. 19.
© Pierre Fraser (PhD), sociologue et lingusite, 2015-2025

Être un corps versus avoir un corps
Lire l’article
Citer cet article
Fraser, P. (2025), « L’arrivée de la gastronomie au XVIIe siècle ». Une brève histoire du corps – Du corps rejeté au corps augmenté. Éditions Photo|Société, pp. 49-54.
Nouveau régime donc de représentations du corps à l’aune de la contenance et de la gouvernance de soi du XVIIe siècle à travers cette machine déterminée qu’exprimait René Descartes : « Je ne reconnais aucune différence entre les machines que font les artisans et les divers corps que la nature seule compose, sinon que les effets des machines ne dépendent que de l’agencement de certains tuyaux, ou ressorts, ou autres instruments, qui, devant avoir quelque proportion avec les mains de ceux qui les font, sont toujours si grands que leurs figures et mouvements se peuvent voir, au lieu que les tuyaux ou ressorts qui causent les effets des corps naturels sont ordinairement trop petits pour être aperçus de nos sens[1]. »
Dans la perspective mécaniste de Descartes, d’une part, le corps peut être ramené à un simple système de détermination mécaniste, c’est-à-dire par figures et mouvements que privilégie le XVIIe siècle, sans compter qu’il est entièrement soumis à la pure causalité déterministe, tout comme le sont les pierres, les plantes, les outils et les choses. D’autre part, l’âme humaine et la pensée, immatérielles par essence, ne sont pas simplement réductibles au fonctionnement du corps et à ce qui le compose, d’où l’idée que les animaux ne sont pas dotés d’une âme et qu’ils ne sont que de simples automates, d’où aussi l’idée que toutes les choses existant dans l’univers matériel doivent relever de la physique pourvu que cette science exprime effectivement les lois de la nature. En fait, avec Descartes, le processus de désenchantement du monde ne s’amorce pas seulement, il inaugure aussi une ère où, une fois que la science fonctionne, il n’est plus besoin de se prononcer encore sur cette embarrassante question de l’Être. De là, des réductionnismes partiels peuvent se mettre en place, depuis les méthodes de la physique aux phénomènes de la respiration, de la digestion et de l’évacuation.
Le XVIIe siècle marque aussi une rupture importante dans la relation entretenue envers le corps. C’est le passage de l’idée d’être un corps à celle d’avoir un corps avec les traités de civilités. Être un corps renvoie au comportement rustre ou animal — la bête a un corps —, tandis qu’avoir un corps renvoie au comportement civilisé, à celui de l’honnête homme correctement éduqué dont les bonnes manières constituent « une rhétorique efficace qui affirme, défend et légitime un statut social[2] ». Autrement dit, parallèlement à la construction mécaniste du corps et à la construction scientifique du corps rationalisé de Descartes — « cette machine composée d’os et de chair, telle qu’elle apparaît en un cadavre[3] » —, s’élabore la construction culturelle d’un corps support des relations sociales, devient « l’aspect le plus immédiat de la personnalité[4]. » Le changement n’est pas banal, car il engage l’individu dans son essence même ; il est désormais responsable de son corps, il doit répondre de son état.
Au XVIIe siècle, la femme, avec le docteur Louis Couvay[5], passe du statut d’être un corps auquel elle serait identifiable, au statut d’avoir un corps dont elle est physiquement dépendante et socialement responsable, « qu’elle a la responsabilité d’employer à des fins utiles, c’est-à-dire à l’établissement d’un ménage harmonieux. Seule mérite l’estime de l’homme la dame dont la performance sociale réussit, et ce, grâce à ses perfections et l’apparence de son corps[6]. » Et ces perfections, selon Couvay, sont de deux ordres, internes et externes[7]. D’une part, les perfections externes : « la beauté, la bonne grâce, la taille, l’humeur gaie, l’humeur douce, le bon esprit et les bonnes mœurs, les qualités essentielles à la vie mondaine[8]. » D’autre part, les perfections internes sont « si cachées, qu’on ne les peut recognoistre que par expérience ; de sorte qu’il est impossible à ceux qui en espreuvent le pouvoir, de déclarer qu’elle est la perfection, qui les surmonte et qui leur oste la liberté[9] ».
En somme, le XVIIe siècle fait de la beauté extérieure du corps féminin un impératif : sa grâce et sa taille engagent un modèle de minceur fait pour plaire, être agréable à l’œil. La beauté interne, quant à elle, est plus problématique. Elle ne se laisse deviner que par la fréquentation de la personne. Elle n’est pas donnée, elle est si cachée que même le corps de belle apparence a de la difficulté à la révéler. La personnalité féminine ne vaudrait donc que par l’apparence de son corps. Cette vision n’est pas innocente, car elle inscrit socialement l’apparence du corps de la femme.
Dans ce passage du statut d’être un corps à celui d’avoir un corps, l’obèse passe également du statut d’être un corps auquel il serait identifiable, au statut d’avoir un corps dont il est responsable. Il y aurait donc une personne qui se cache dans toute cette graisse, tout comme il y aurait une perfection cachée dans le corps de la femme qui peine à se dévoiler. Il serait donc du devoir de l’obèse de révéler cette personne en évacuant toute la graisse qui l’enveloppe. Tout comme pour la femme, seule mérite l’estime la personne dont la performance sociale réussit. Être obèse, dans un tel contexte, n’est peut-être pas une performance sociale qui réussit.
[1] Descartes, R. (1835), Œuvres philosophiques de Descartes, tome 1, textes annotés par Adolphe Garnier, Paris : Hachette, p. 308.
[2] Bryson, A. (1990), The rhetoric of status : gesture, demeanour and the image of the gentleman in sixteen and seventeenth century England, «Renaissance Bodies : The Human Figure in English Culture c. 1540-1660», L. Gent and N. Lleewellyn, eds, London : Reaktion Books, p. 141.
[3] Descartes, R. ([1641] 2000), Méditations métaphysiques, Paris : Flammarion, p. 66.
[4] Bryson, A. (1990), op. cit., p. 139.
[5] Nodier, C. (1728), Mélanges tirés d’une petite bibliothèque, Paris : Crapelet, tome 1, p. 376.
[6] Carlin, C. (2007), op. cit. p. 112.
[7] Couvay, L. ([1647], 1685), L’Honneste Maitresse ou Le Pouvoir Legitime des Dames sur ceux qui les recherchent honnestement en Mariage, Paris: Helie Josset, Préface.
[8] Carlin, C. (2007), « Modernités de l’imaginaire nuptial : anatomies du mariage », Religion, Ethics, and History in the French Long Seventeenth Century / La religion, la morale et l’histoire à l’âge classique, William Brooks and Rainer Zaiser, Eds, Bern: Perter Lang, AG, International Academic Publishers, p. 112.
[9] Couvay, L. ([1647], 1685), op. cit., Préface.

Le corps bridé et contenu du XVIIe siècle
Lire l’article
Citer cet article
Fraser, P. (2025), « Le corps bridé et contenu du XVIIe siècle ». Une brève histoire du corps – Du corps rejeté au corps augmenté. Éditions Photo|Société, pp. 31-33.
Le XVIIe siècle est un siècle charnière pour le corps. Il y a tout d’abord rupture ontologique par rapport au siècle précédent, car le corps ne s’inscrit plus dans le cosmos. C’est l’amorce du désenchantement, la descente dans le particulier, le réductionnisme et la parcellisation, dans ce siècle de la Raison qui vérifie, analyse, démonte, dissèque et décortique : « L’ontologie qui se développe à ce moment de l’histoire est une ontologie dont le modèle est celui de la matière. L’univers est [désormais] conçu comme un champ de masses et de forces inanimées qui opèrent selon les lois de l’inertie et de la distribution dans l’espace[1] ». C’est la thèse mécaniste où le savoir se réduit au seul aspect identifiable des processus, où le corps est livré aux seules lois des forces mouvantes. La loi des liquides et des flux s’impose avec la découverte, par William Harvey (1578-1657), de la circulation sanguine, où le corps est désormais assimilé au fonctionnement des machines : montres et horloges, pompes et fontaines. Le corps est irrémédiablement soumis aux lois déterministes de la matière : il est une mécanique complexe faite de circuits, de flux et d’articulations. Prolongement aussi de l’idée de mouvement du XVIe siècle où le corps est dorénavant associé à un agencement de poulies, de leviers, de couples de force et de ressorts.
Sous l’impulsion de la Réforme, le XVIIe siècle a arraché le corps à l’influence du grand corps collectif : l’homme est désormais personnellement et socialement responsable de son propre corps. Il y a donc là un nouveau souci de soi auquel doit répondre la société : « Dans ce contexte, le corps, loin d’être un lieu de perdition, peut devenir au contraire source d’épanouissement[2]. » Cette proposition de l’éthique protestante, à l’opposé de celle du catholicisme, stipule qu’il faut « donner à celui ou celle qui se trouve en situation critique les moyens de surmonter ses difficultés et de vaincre ses angoisses, d’accepter le sort qui lui est fait, non pas pour abandonner la partie, mais pour apprendre au contraire à se maîtriser et par là se dépasser[3]. » En fait, avec la Réforme, le corps a été placé au cœur même des préoccupations : le corps laborieux et vigoureux au service de Dieu. Être au service de Dieu impose certaines obligations : la contenance de soi (rapport à soi-même et à son propre corps) et la gouvernance de soi (rapport du corps au collectif). Cette morale puritaine, qui ne tolère pas que les temps libres se passent dans l’oisiveté ou l’inaction, conduira à effacer toute coupure entre travail et loisir, à lutter contre le temps mort, la vacuité, l’inoccupation, à être constamment en besogne, à s’assurer d’une activité continue.
Sous l’impulsion de la Réforme, la santé, la bonne condition physique, l’absence de souffrances morales ou physiologiques deviennent les conditions de l’épanouissement de la personne (la recherche de la grâce), d’où la nécessaire contenance de soi. Et cette contenance de soi n’est possible, d’une part, qu’à la condition de remplir adéquatement quatre devoirs bien précis : devoir d’équilibre, devoir d’attention, devoir d’effort, devoir de maîtrise et de restriction. Devoir d’équilibre, dans le sens où il est attendu de l’individu qu’il parvienne à un corps équilibré pour assumer adéquatement et efficacement le rôle social qu’il a à jouer, c’est-à-dire le travail. Devoir d’attention, dans le sens où il faut porter une attention toute particulière au corps, à ce qu’il ingère et à son activité en général. Devoir d’effort, dans le sens où il faut se soumettre à certaines pratiques pour maintenir le corps en santé. Devoir de maîtrise et de restriction, dans le sens où il faut éviter de succomber à la tentation des plaisirs et des facilités qu’offre la vie moderne tout en adoptant des attitudes et des comportements qui empêchent de sombrer dans l’excès sous toutes ses formes. En somme, la contenance de soi n’exige pas d’adhérer à un quelconque credo ou à une quelconque norme, car ce qui compte avant tout, ce sont les actions que l’individu est librement et volontairement en mesure de poser qui comptent. S’il ne les pose pas, il se condamne lui-même à la stigmatisation sociale et à l’impitoyable regard des autres. Être en défaut de contenance de soi, c’est également être en perte de souci de soi, en perte du respect de soi-même, et par conséquent, des autres. Tout individu en défaut de contenance de soi est donc une menace à sa propre intégrité (respect de soi), à sa propre identité (souci de soi) et à sa propre vertu (désirs incontrôlés).
[1] Vignaux, G. (2009), L’aventure du corps, Paris : Pygmalion. p. 121.
[2] Gélis, J. (2005), « Le corps, l’Église et le sacré », Histoire du corps. 1. De la Renaissance aux Lumières, tome 1, coll. Points / Histoire, Paris : Seuil, p. 109.
[3] Idem.
RENAISSANCE

La représentation iconographique du corps à la Renaissance
Lire l’article
Citer cet article
Fraser, P. (2025), « La représentation iconographique du corps à la Renaissance ». Une brève histoire du corps – Du corps rejeté au corps augmenté. Éditions Photo|Société, pp. 24-30.
Impressionné par les travaux de Mantegna, le jeune peintre allemand Albrecht Dürer (1471-1528) reprendra, à sa façon, le thème du personnage obèse à travers une étude systématique des proportions du corps des petits, des maigres et des obèses, dont plus d’une vingtaine de dessins pour ces derniers. Son Traité des proportions, paru à titre posthume en 1528, pose non seulement de nombreuses réflexions d’ordre esthétique sur le corps, mais également d’ordre social sur ce corps qui incarne l’excès et la démesure. Pour la première fois, avec Dürer, l’obésité est mesurée, analysée mathématiquement sous toutes ses coutures, inscrite dans le célèbre cercle du canon des proportions idéales de Vitruve. Mais le corps obèse résiste à toute systématisation mathématique. Impossible de totalement le cadrer dans le cercle de Vitruve, impossible de « localiser les amas graisseux situés au niveau du ventre, mais aussi pour définir le seuil entre le gros et le très gros[1]. » Problème de mesure donc, tant sur le plan mathématique que moral, dans cette impossibilité d’évaluer objectivement l’envahissement séreux, aussi bien que d’évaluer l’emportement quasi compulsif du très gros dans ses abus de nourriture et de boisson.
Les médecins, malgré leur méconnaissance des processus exacts d’engendrement de la masse adipeuse, constatent empiriquement que les gens trop bien nourris sont plus souvent victimes de la goutte, d’apoplexie et de problèmes vasculaires. La sobriété et la retenue sont donc au centre même des démarches d’amincissement pour la classe sociale la plus favorisée. La réduction alimentaire a la cote : suppression de repas, pesage des aliments, consommation de viandes légères, consommation d’aliments aux propriétés desséchantes, non excrémenteuses, dessicatives et abstersives, mise à l’écart des légumes, agrumes et fruits liquides trop juteux, retrait systématique d’aliments dilatant le ventre, haricots, pois, fèves. C’est donc l’homme de robe, aristocrate ou bourgeois, qui devient objet de préoccupation par son embonpoint parfois excessif.
Dès le début du XVIe siècle, deux régimes alimentaires à l’opposé l’un de l’autre sont en place : celui de l’aristocratie par lequel les gens meurent goutteux et apoplectiques d’avoir trop bien mangé, et celui du peuple par lequel les gens meurent d’une alimentation déséquilibrée productrice de carences. Pour les premiers, les médecins recommandent la sobriété, la retenue, parfois l’abstinence dans certains cas extrêmes. Pour les seconds, c’est la maigreur qui interpelle : elle rappelle « la famine, la peste, les décharnements. Elle est dessèchement, aspérité, faiblesse, ce qui, dans l’imaginaire ancien, s’oppose au ressort de la vie[2]. » L’un comme dans l’autre, les deux régimes appellent à des interventions que la médecine commence à mettre en place pour atteindre cet idéal du corps glorifié par les peintres de la Renaissance.
Dans l’Europe du XVIe siècle, la cuisine se positionne comme un véritable indicateur social, au même titre que le costume et le langage, alors que l’aristocratie s’offre régulièrement des repas gargantuesques. Par exemple, à la table du cardinal Farnese, « veau et mouton occupent, et de loin, la première place, mais on y trouve également chaque midi et chaque soir une infinie variété de chairs plus rares et plus délicates, tels chevreau, pigeonneau, oison, dindonneau, en plus de pâtés, de ris de veau, de saucissons et autres confections de cette nature[3]. » Certains repas ont même jusqu’à quatre services : « un premier, à base de fruits confits ; deux autres, composés de viandes et de volailles alternant avec des plats sucrés ; un dernier, le dessert, réunissant une variété de plats doux, parfumés d’œufs confits et de sirops. Sans compter, bien évidemment, le vin, cet indispensable compagnon de la bonne chère, recommandé par les médecins, chanté par tous les poètes de l’époque, qui lui attribuent, les uns et les autres, des vertus et des qualités presque universelles[4]. » La bourgeoisie, à l’inverse de l’aristocratie, dispose plutôt d’une alimentation « principalement céréalière — pain blanc, pain de riche, au lieu du fatidique croûton noir du pauvre, mais pain tout de même — et, hormis quelques ripailles et festins que nobles et bourgeois se paient à l’occasion, la frugalité, même dans ces milieux, semble avoir été la règle générale[5]. » Le régime du peuple, très frugal, d’ailleurs souvent irrégulier, constitué presque exclusivement de légumes et de céréales — pain noir, légumes, eau —, est presque toujours déficient, sinon à la limite de la subsistance[6].
| Sculpteur : Appolinios ; hauteur : 1,59 mètre ; datation : 1e siècle av. J.-C. Le Torse du Belvédère, fragmentaire, en marbre, est conservé au musée Pio-Clementino (inv. 1192), dans la cour du Belvédère du Vatican qui lui donne son nom. |

Pour leur part, au XVIe siècle, Michel-Ange et Raphaël seront au centre du déploiement iconographique de ce corps nouveau qui émerge, dynamique et énergique aux muscles en saillie. Le culte de la forme humaine s’installe définitivement : le corps nu retrouvé, le corps glorifié, l’érotisation du regard, la liberté du mouvement, sa volupté et sa magnificence exprimées sous toutes ses formes. Le Torse du Belvédère sculpté par l’Athénien Appolinios, tant loué par Michel-Ange, représente cet idéal recherché par les peintres de la Renaissance : « l’effort grandiose, la puissante attache des cuisses, la fierté du mouvement, le mélange de passion humaine et de noblesse idéale[7] », sont conformes à cette nouvelle représentation du corps. Toute la peinture italienne se fonde sur cette idée, sur ces « muscles qui soulèvent une épaule, et par contrecoup arc-boutent le tronc sur la cuisse opposée[8]. » Tout ce qui entoure le corps, tout ce qui le contextualise n’est que mise en scène, fond, accompagnement, préparation, développement pour mettre en valeur le corps. Et pour donner ce mouvement au corps, pour mettre en évidence ses muscles et sa force, le peintre Alberti explique qu’il est attendu de la peinture qu’elle donne l’apparence du plus grand relief aux corps et que cette ressemblance doit correspondre à ce qui est vu[9]. Mais pour montrer cette volumétrie, encore faut-il savoir où sont situés les muscles. La peau les révèle, crée des volumes à la surface de la peau, donc de la profondeur. Toute la peinture de la Renaissance sera à l’aune de cette « recherche des couleurs appropriées qui suggéreront les différents volumes du corps vus dans la lumière et, d’autre part, de déterminer un type de figure humaine (homme ou femme ; jeune ou vieux, etc.)[10] ». L’Homme de Vitruve de Léonard de Vinci (1452-1519), intitulé Étude des proportions du corps humain selon Vitruve (1492), s’affiche non seulement comme le symbole même de l’humanisme de la Renaissance, où l’homme est définitivement au centre de l’Univers qu’il s’est réapproprié, mais aussi comme celui de l’homme de justes proportions.
La représentation iconographique des rois et des puissants, quant à elle, au XVIe siècle, met non seulement en scène des individus en pleine action, mais les dépeint dans toute leur vigueur corporelle, leur verdeur, leur solidité, leur force, leur résistance à la fatigue, car « le pouvoir a ses versants corporels : il y faut une robustesse visible, une intensité quasi musculaire[11] », et le puissant doit exhiber cette vaillance. D’ailleurs, les portraits représentant Charles Quint dépeignent un individu engagé dans l’action, « armure et lance en main, corps tendu pour l’attaque, cheval caparaçonné, amorçant le galop[12]. » Il s’agit de représenter le puissant à travers des logiques mouvantes évoquant non seulement la force du combat sans laquelle l’image du pouvoir ne peut se construire, mais aussi celle de l’adresse et de la prestance.
| Roi René, Nicolas Froment, 1476. |

À l’inverse de la représentation iconographique de ce corps idéalisé des puissants, de ce corps aux proportions quasi parfaites, du muscle révélé, il y a aussi une iconographie qui rend compte des corps appesantis, replets et obèses. Le peintre Nicolas Froment, en 1476, représente un roi René au visage massif, aux doubles mentons. Il y a aussi l’image du ravi « au visage bouffi, yeux clos, col court, épaules rondes, ventre largement entraîné vers l’avant[13] » illustré dans le mariage de la vierge du Livre des heures d’Étienne Chevalier. Le glouton de la Cavalcade des vices, chevauché à la fois par l’ours et le bourgeois, illustre l’empâtement du corps, indique son indolence et sa paresse. Il y a aussi cette distinction sociale de l’apparence des corps illustrée dans la miniature de Gaston Phœbus du repas collectif du Livre de chasse où des serviteurs ventrus sont opposés à des nobles plus minces à la ligne plus découpée. Le XVIe siècle signale aussi l’ascension sociale, dans les pays du nord, d’une certaine bourgeoisie marchande, d’une certaine ascension des obèses en quelque sorte. Le Chanoine Van der Paele de Jan Van Eyk, le Juvénal des Ursins de Jean Fouquet et le Chancelier Rolin de Jean Perréal témoignent de cette période où l’ascendant social des hommes se mesure à leur poids : « la fin de l’homme étant de manger, la plus haute dignité appartient à celui qui mange davantage et l’office de l’art sera de perpétuer les preuves que le modèle l’emporta en richesse et autorité puisqu’il eut plus de pouvoir que d’autres de manger[14]. »
Avec la Renaissance, un nouvel intellectuel s’affirme également : « l’humaniste qui remet en cause les dogmes consacrés, lit les Anciens et commente leurs idées de manière critique. La médecine ne reste pas à l’écart de cette révolution. Elle va en faire une majeure : l’exploration du corps humain[15]. » Le corps commence son long périple réductionniste sous l’emprise d’une pensée organisée autour de la partie, devient circuit producteur d’objectivations, de définitions et de délimitations. Le fractionnement du corps par le scalpel établira une science du corps que mettront en valeur un anatomiste comme André Vésale, un chirurgien comme Ambroise Paré, un physiologiste comme Jean Fernel, et un médecin comme Paracelse. La fin du XVe siècle et le début du XVIe siècle n’annoncent pas seulement une remise en question de la médecine régnante, mais aussi une remise en cause du concept même d’éducation dans son ensemble.
Partant de ces quelques constats à propos de la représentation du corps à la Renaissance, il est plausible d’envisager l’hypothèse qu’à partir du XVIe siècle émerge définitivement l’idée d’un corps de justes proportions comme idéal de beauté, d’où la conviction qui naît à ce moment-là qu’il est possible de façonner le corps selon son propre vouloir et désir — nouvelle conception du corps fondée sur l’opposition entre déséquilibre (le gros/le mince) et équilibre (l’inspiration de la statuaire grecque antique). En même temps, cette opposition est source d’une contradiction dont nous ne sommes peut-être pas sortis : un idéal de beauté (la finesse, la minceur) pour la femme et un idéal de puissance (être bien en chair et en muscles) pour l’homme. Cette contradiction continue peut-être bien de faire confusion au sein des discours sur les régimes alimentaires et au sein des techniques suggérées de gymnastique ou de fitness.
[1] Idem.
[2] Vigarello, G, (2010), op. cit., p. 73.
[3] Hurtubise, P. (1980), « La table d’un cardinal de la Renaissance. Aspects de la cuisine et de l’hospitalité à Rome au milieu du XVe siècle », Mélanges de l’École française de Rome. Moyen-Âge, Temps modernes, t. 92, n° 1, p. 270.
[4] Hurtubise, P. (1980), op. cit., p. 263.
[5] Idem., p. 276.
[6] Mandrou, R. (1961), Introduction à la France moderne, Paris : Albin Michel, p. 30-31.
[7] Taine, H. (1990), Voyage en Italie. À Rome, Paris : Éditions Complexe, p. 82.
[8] Idem., p. 111.
[9] « […] picturam expectamus eam quae maxime prominens et datis corporibus persimilis videatur. »
[10] Bouvrande, I. (2007), « Peindre le corps à la Renaissance : l’art de colorer chez Alberti », Corps, vol. 2, n° 3, p. 73-78 [73].
[11] Vigarello, G. (2005), « S’exercer, jouer », Histoire du corps. Tome 1. De la Renaissance aux Lumières, Paris : Seuil, p. 248.
[12] Idem.
[13] Vigarello, G. (2010), Les métamorphoses du gras, Paris : Seuil, p. 48.
[14] Sendrail, M. (1967), Sagesse et délire des formes, Paris : Hachette, p. 110.
[15] Vignaux, G. (2009), L’aventure du corps, Paris : Pygmalion, p. 89.

L’ère du mouvement initié par la Renaissance
Lire l’article
Citer cet article
Fraser, P. (2025), « L’ère du mouvement initié par la Renaissance ». Une brève histoire du corps – Du corps rejeté au corps augmenté. Éditions Photo|Société, pp. 20-44.
L’idée de réappropriation, de transformation et de purification du corps par l’exercice est déjà en germe dans de nombreux ouvrages à partir du milieu du XVIe siècle. Il y a tout d’abord Rabelais et son Gargantua qui pratique l’équitation, la lutte, la natation et la gymnastique sous toutes ses formes. L’anatomiste Jean Valverde (1525-1588), dans son ouvrage De Animis et Corporis Sanitate,publié en 1552, reproduit les connaissances et savoirs antiques de Galène et d’Hippocrate à propos de l’exercice.
Jérôme de Monteux de Mérybel (1518-1559), dans son ouvrage Commentaire de la conservation de la santé et de la prolongation de la vie, consacre un chapitre entier à l’exercice qu’il intitule De l’exercice, de l’oisiveté et de leurs différences. Le juriste Pierre du Faure de Sain Jorry (1540-1600) publie, en 1592, un ouvrage portant sur les Jeux olympiques de la Grèce antique dans lequel il traite des techniques athlétiques des gymnastes. Le médecin Laurent Joubert (1529-1583) publie, en 1582, De la gymnastique et de tous genres d’exercices chez les auteurs antiques célèbres[1] dans lequel il propose une taxonomie quasi exhaustive des exercices physiques et de leurs impacts sur la santé. Simon de Vallambert (1537-1565), médecin personnel de la Duchesse de Savoie de Berry, quant à lui, en 1565, cherche à réaliser l’éducation intégrale à travers son ouvrage, en cinq tomes, intitulé De la manière de nourrir et de gouverner les enfants dès leur naissance en proposant l’activité physique et le mouvement.
Avec toutes ces publications, l’ère du mouvement est en marche. Elles fédèrent, pour la première fois, sous une taxinomia scientifique du mouvement, une certaine vision du corps en santé. Comme l’avait repéré Michel Foucault dans Les mots et les choses[2], il y a là une volonté avouée de classer le mouvement, de le décortiquer, de l’analyser, mais aussi celle d’identifier les exercices les mieux adaptés à l’entretien ou à l’amélioration de la santé, et d’agir sur le corps de façon préventive. À ce titre, Mercurialis (1530-1606), en 1569, avec la publication de son De arte gymnastica en six volumes, suggérait déjà, tout comme l’avaient reconnu Galien et Avicenne, que les exercices sont préférables aux médicaments. Il dira à ce sujet : « L’art de la gymnastique fut autrefois estimé d’un grand prix ; il est maintenant obscur et presque anéanti. J’entreprends de le remettre au jour[3] » en distinguant tout particulièrement la gymnastique médicale de la gymnastique militaire et athlétique, c’est-à-dire qu’il faut que les exercices pratiqués par les deux autres types de gymnastique puissent profiter à la gymnastique médicale et que la gymnastique profite à la santé et non au plaisir populaire ou à l’activité guerrière. Pour Mercurialis, une gymnastique médicale est avant tout une gymnastique savante, qui connaît les effets des exercices sur le corps et ses humeurs. Il y a aussi, en creux, l’idée que la gymnastique est préventive et que par un exercice soutenu et régulier il est possible d’acquérir la santé et la maintenir. Dès lors, la gymnastique ne se donne jamais comme finalité, à savoir, un corps achevé une fois pour toutes, mais bel et bien un corps dans un devenir constant qu’il faudrait atteindre. Et cette vision qu’adopte Mercurialis est peut-être la plus achevée que la Renaissance porte sur le corps. D’ailleurs, la publication, en 1567, de son célèbre De Arte Gymnastica, redéfinit systématiquement le regard porté sur le corps, d’où cette obligation d’une rééducation du corps et de l’esprit par la gymnastique de l’Antiquité réadaptée au goût du jour à des fins curatives ; le mouvement devient ce par quoi il est désormais possible de comprendre le corps, de le refaçonner, de le dynamiser.
Fait intéressant à plus d’un égard, déjà au XVIe siècle, il était question d’éviter la prise excessive de poids. Comme le souligne Laurent Joubert à propos des jeunes gens s’adonnant à la gymnastique : « les uns par leur teint rouge, les autres par leur teint foncé, étaient modérément colorés sous l’effet du soleil, le visage tout à fait mâle, montraient beaucoup de vigueur, d’ardeur et de virilité, ni trop obèses, ni au contraire trop maigres et secs, d’un poids excessivement grand, mais dotés d’un corps de justes proportions puisqu’ils éliminaient par leur sueur une masse abondante de viande molle aussi inutile que superflue[4]. » En somme, Joubert avait déjà repéré les quatre éléments qui allaient éventuellement constituer le discours de la lutte contre l’obésité : l’activité physique c’est la santé (vigueur, ardeur, virilité) ; l’activité physique façonne l’apparence d’un corps aux justes proportions (ni trop maigre ou sec), mais d’un bon poids ; l’activité physique permet de surseoir au développement de la masse adipeuse qui déforme les chairs et rend inefficace le corps, car elle élimine par la sueur une masse abondante de viande molle aussi inutile que superflue ; l’activité physique est également le discours d’un certain jugement moral porté sur le corps obèse, car il manque d’ardeur, de vigueur et de virilité puisqu’il est habité par une viande molle aussi inutile que superflue. Il suffirait dès lors de s’adonner à l’activité physique pour régler le problème, et ne pas s’y mettre serait souligner un manque de volonté.
Le jugement sur le très gros, à la Renaissance, est sans équivoque. Tous les traités de physiognomonie qui circulent à l’époque, qui prétendent juger de la qualité d’un individu par ses traits, et qui associent grosseur à luxure, contribuent largement à cette idée. Le poète et humaniste italien Pomponius Gauricus (1481-1530) ira jusqu’à dire, dans son ouvrage De Sculptura, en 1504 : « Une poitrine obèse avec les mamelons pendants dénonce le débauché, l’ivrogne, le gourmand[5]. » La représentation du corps obèse dans la peinture se confirme tout d’abord avec le peintre Andrea Mantegna (1431-1506). Il y a là des peintures peuplées de « dieux grotesques, ivrognes, bagarreurs et obscènes flanqués de filles obèses qui vocifèrent. Le réalisme s’exaspère jusqu’au grotesque le plus cru, noir sur blanc, et netteté de bas-relief[6]. » Le peintre « fait explicitement référence au modèle du putto, aussi bien d’un point de vue formel qu’iconographique, pour élaborer sa propre typologie du personnage obèse, faute de modèle préexistant. Il reprend les bourrelets qui se succèdent sur le corps potelé des putti pour les transposer sur le corps adulte. Il parvient ainsi à illustrer, dans toute son ampleur, la gêne fonctionnelle qui emprisonne les corps […] de Silène et de la femme à gauche, puisqu’ils sont en effet totalement incapables de marcher[7]. »

[1] Titre original : De gymnasis et generis exercitationum apud antiquas celebricum.
[2] Foucault, M. (1966), Les mots et les choses, Paris : Gallimard.
[3] Mercurialis, H. ([1565] 1601), De arte gymnastica, 4e éd., Venise, p. 214.
[4] Gleyse, J. (1997), L’Instrumentalisation du corps, Paris : L’Harmattan, p. 104.
[5] La première œuvre, conservée au Louvre, est un tableau réalisé en 1504 pour le studiolo d’Isabelle d’Este, la seconde un dessin conservé au British Museum qui a été gravé par l’atelier de Mantegna vers 1500 ; cf J. Martineau (éd.), Andrea Mantegna, peintre, dessinateur et graveur de la Renaissance italienne (cat. exposition : Londres / New York, 1992), Paris / Milan, Gallimard / Electa, 1992, p. 438-441 et 462-467. (Source : Pellé, A.S. (2012), « Mesurer l’excès : Albrecht Dürer et la figure obèse », Histoire de l’art, Blogue de l’APAHAU, Recherche et enseignement en archéologie et histoire de l’art, n° 70).
[6] Dagen, P. (2008), « L’œuvre obstinée de Mantegna », Culture, Le Monde, 30 septembre.
[7] Pellé, A.S. (2012), op. cit.

La Renaissance et le corps de justes proportions
Lire l’article
Citer cet article
Fraser, P. (2025), « L’arrivée de la gastronomie au XVIIe siècle ». Une brève histoire du corps – Du corps rejeté au corps augmenté. Éditions Photo|Société, pp. 15-20.
En 1432, le peintre florentin Leon Batista Alberti (1404-1472), dans son ouvrage Libri della famiglia, et plus particulièrement dans la section concernant l’usage du corps, souligne que c’est bel et bien par l’exercice qu’il est possible de conserver longtemps au corps sa santé, sa robustesse, sa jeunesse et sa beauté. La préoccupation d’un corps en santé n’est donc pas récente. Elle a ses échos qui se répercutent de siècle en siècle depuis la Renaissance. Et les propos du peintre Alberti sont particulièrement éclairants en ce qui concerne le corps du XXIe siècle, car ils démontrent que depuis longtemps déjà, les fondements de la relation contemporaine au corps ont été établis et que les préoccupations sont fondamentalement les mêmes, c’est-à-dire que le corps qui mérite considération est bel et bien celui de justes proportions. Le corps hors norme, déjà au XVe siècle, était discrédité face à ce corps socialement attendu. Alberti ne dira-t-il pas, dans son ouvrage intitulé De Pictura (1435) : « C’est pourquoi le peintre qui voudra que ses simulacres de corps paraissent vivants devra faire en sorte qu’en eux chaque membre exécute parfaitement ses mouvements. Mais il faut, dans chaque mouvement, rechercher la grâce et la beauté. Or, de tous, les plus agréables et qui semblent vivre davantage sont ceux qui s’élèvent en l’air[1]. » Au cœur du propos d’Alberti, il y a également cette idée de « la mesure et [de] la définition des limites [du corps …] C’est, qu’en effet, elles possèdent une sorte de vertu merveilleuse presque incroyable[2]. » À travers les proportions du corps et les effets d’affects de la représentation de cette beauté, avec cette glorification du corps, sa grâce, son élégance, sa découpe et ses muscles mis en mouvement sous l’effet des jeux de couleurs, Alberti lie la dignité humaine à une valorisation explicite du corps.
L’homme anatomique, Les Très Riches Heures du duc de Berry, 1416.

Avec la Renaissance, la vision du corps de la Grèce antique fait retour. Le corps est un reflet en miniature du grand ordre numérique et géométrique de l’univers. Il s’agit de révéler comment « le microcosme du corps répète les dispositifs de l’univers, retentit à ses mouvements, connaît en lui-même des rapports similaires d’harmonie ou de déséquilibre entre les fluides (les humeurs) et les parties solides qui le composent[3]. » De là, une vision occidentale commune du corps, mi-animiste, mi-chrétienne où s’équilibrent le symbolique et le pragmatique, l’imaginaire et le concret. À titre d’exemple, en 1416, la miniature de L’homme anatomique qui ouvre le livre Les Très Riches Heures du duc de Berry présente un corps qui n’existe que traversé d’influences secrètes : les signes du zodiaque ; l’empreinte postulée des planètes ; la croyance à quelque puissance magique envahissant les organes et les peaux, d’où la « cartographie toute singulière dessinée par la frêle figure, [d’où] ces parties du corps censées refléter une à une les parties du ciel, cette certitude d’emprises manifestes venues de puissances éloignées[4]. »
Le corps, au début de la Renaissance est aussi corps collectif, voué aux famines, à la peste, aux guerres récurrentes et aux violences quotidiennes. Il s’agit d’une vision commune « qui fait du corps charnel un sac d’os, à la fois vulgaire et respectable, vision qui stimule des angoisses religieuses et des actes de revanche sociale[5]. » C’est un corps dont les moindres mouvements sont périls et promesses tout comme avertissements divins. Les dérèglements du corps sont des manquements envers l’ordre naturel des choses, là où « sont tapies les sollicitations, inquiétudes et contingences du corps, de la maladie, de la souffrance et de la mort[6]. » La moindre entorse à cet ordre universel se paie dans la chair et dans l’esprit. La restauration du corps malade, quant à elle, passe par « les dispositions et les vertus naturelles des sols, des boues, des plantes et des métaux[7]. » En somme, la nature est médiatrice pour le corps, car le corps est à la fois terre, eau, air et feu, tout comme l’univers.
Vers le milieu du XVe siècle, de la soumission du corps aux forces invisibles et souterraines du monde, le corps passe graduellement, avec les avancées de la médecine, à la soumission aux aléas de son environnement dans un « décor quotidien voué à la pénurie et à l’accumulation des corps, des choses, des bêtes et des mauvaises odeurs[8] », où l’espace public est approprié par les déjections intimes, humaines ou animales, tout comme par les déjections des bouchers, des équarrisseurs et des tanneurs. Tout en étant soumis aux aléas visibles de son environnement, le corps de la Renaissance n’en est pas moins engagé dans un double processus de démantèlement et de reconstitution. Démantèlement, dans le sens où il y a un début de compréhension du fonctionnement du corps avec la dissection. Reconstitution, dans le sens où le démantèlement du corps permet de le recaler objectivement dans la grande architecture de l’univers et engage une nouvelle façon de le décrire et de l’interpréter. En somme, le corps n’est plus donné une fois pour toutes par une quelconque autorité divine : il peut être refaçonné, modifié et transformé par l’homme, discours qui traversera tous les siècles à venir et qui constituera, au XXIe siècle, le socle du discours transhumanisme. Il y a donc cette idée qui émerge qu’il serait possible de fabriquer un corps tel qu’on le désire par la gymnastique.
De Arte Gymnastica, Girolamo Mercurialis, 1569.

Deux publications majeures contribueront à ce renversement des valeurs : le De Humani Corporis Fabrica de Vésale dont les minutieuses observations anatomiques fonderont une nouvelle nomenclature du corps, et le De Arte Gymnastica de Mercurialis dont les énoncés feront de la gymnastique « une sorte de médicament, de panacée, pour bien portants ou pour convalescents[9]. » Il y aura aussi cette logique protestante qui cherche à valoriser le travail, à purifier le corps par l’activité physique pour l’éloigner d’autant de l’oisiveté. L’avocat et antiquaire Guillaume Du Choul (1496-1560) dira par ailleurs à ce sujet : « Il ne se trouve chose, qui tant entretienne la bonne santé que l’exercitation […] Il ne se trouve chose, qui rende tant hébété le corps que la paresse, qui hâte la vieillesse, et le labeur qui rend la longue jeunesse[10]. »
[1] Alberti, L.B. ([1435] 1868), De la statue et de la peinture, trad. Claudius Popelin, Paris : Levy Éditeur, p. 151.
[2] Idem., p. 72.
[3] Peter, J.P. (2011), « Du corps redécouvert à l’éveil clinicien », Aux origines de la médecine, Paris : Fayard, p. 73.
[4] Vigarello, G. (2005), « Introduction », Histoire du corps, Tome 1. De la Renaissance aux Lumières, Paris : Éditions du Seuil, coll. Points / Histoire, p. 8.
[5] Pellegrin, N. (2005), « Corps du commun, usages communs du corps », Histoire du corps. Tome 1. De la Renaissance aux Lumières, Paris : Seuil, coll. Points / Histoire, p. 123.
[6] Idem., p. 75.
[7] Idem., p. 74.
[8] Idem., p. 157.
[9] Gleyse, J. (2007), La fabrication du corps par l’exercice à l’Âge classique : discours, pratique ou transgression d’un interdit ?, IUFM de Montpellier : Université de Montpellier II, p. 10.
[10] Du Choul, G. ([1567] 1672), Discours de la religion des anciens Romains ; de la castremation et discipline militaire d’iceux ; des bains et antiques excitations Grecques et Romaines, Awesel : André de Hoogenuyse, Imprimeur de la ville, p. 21.